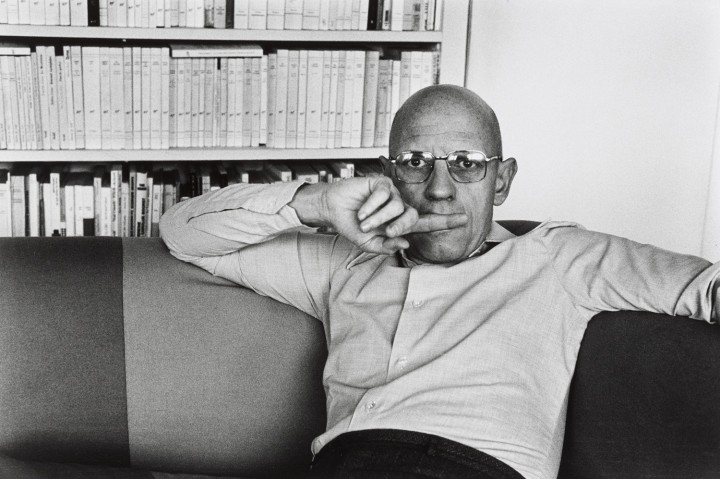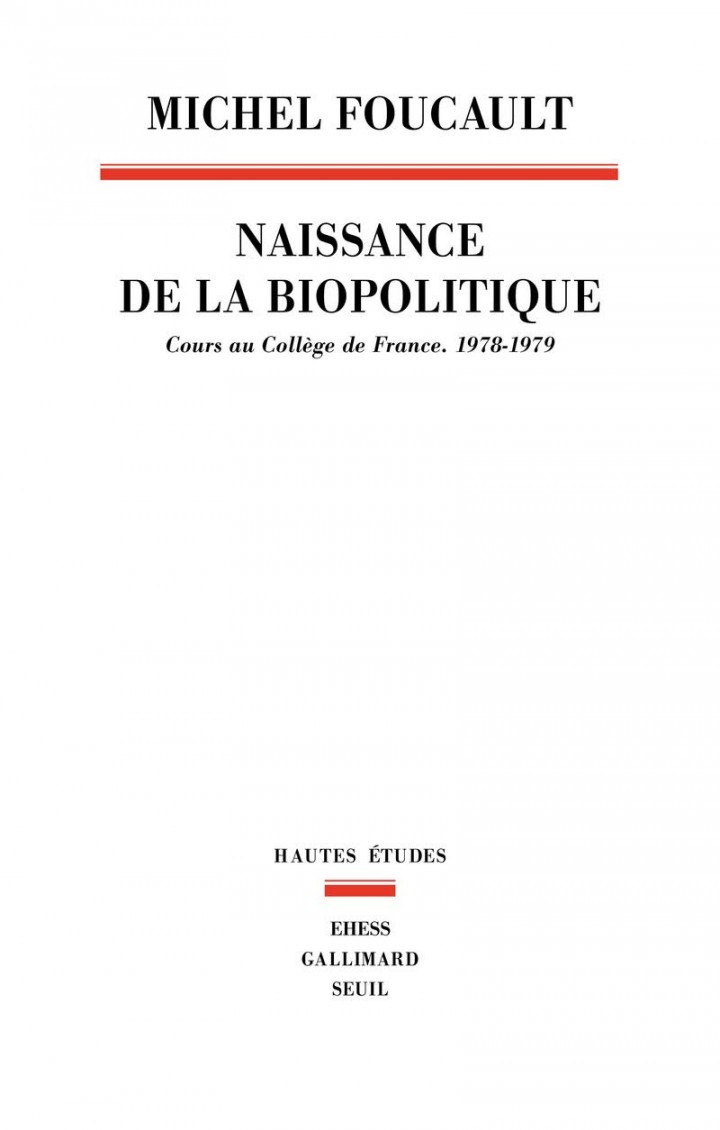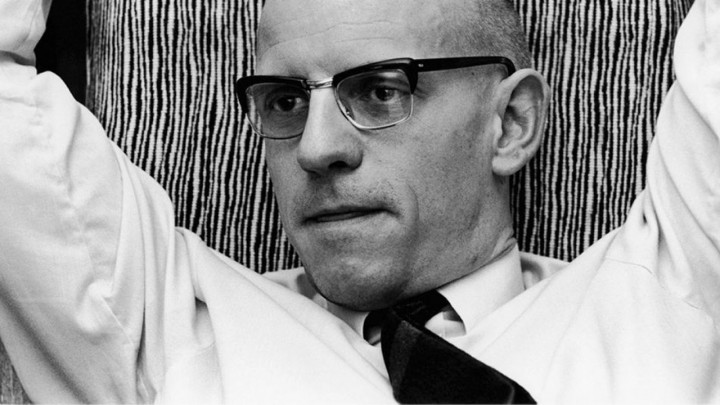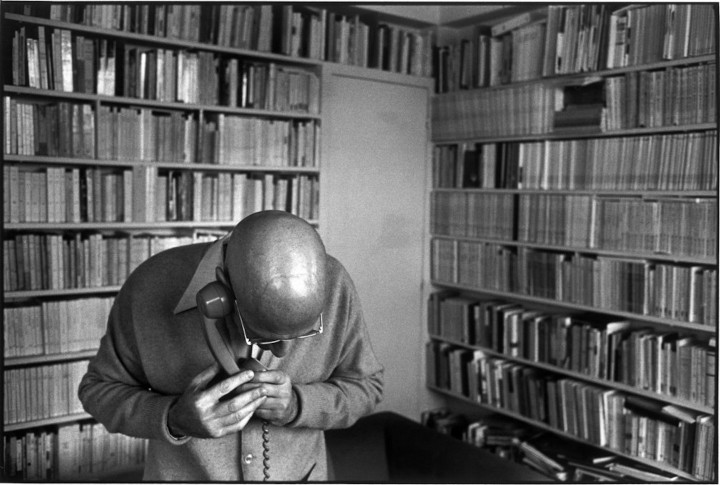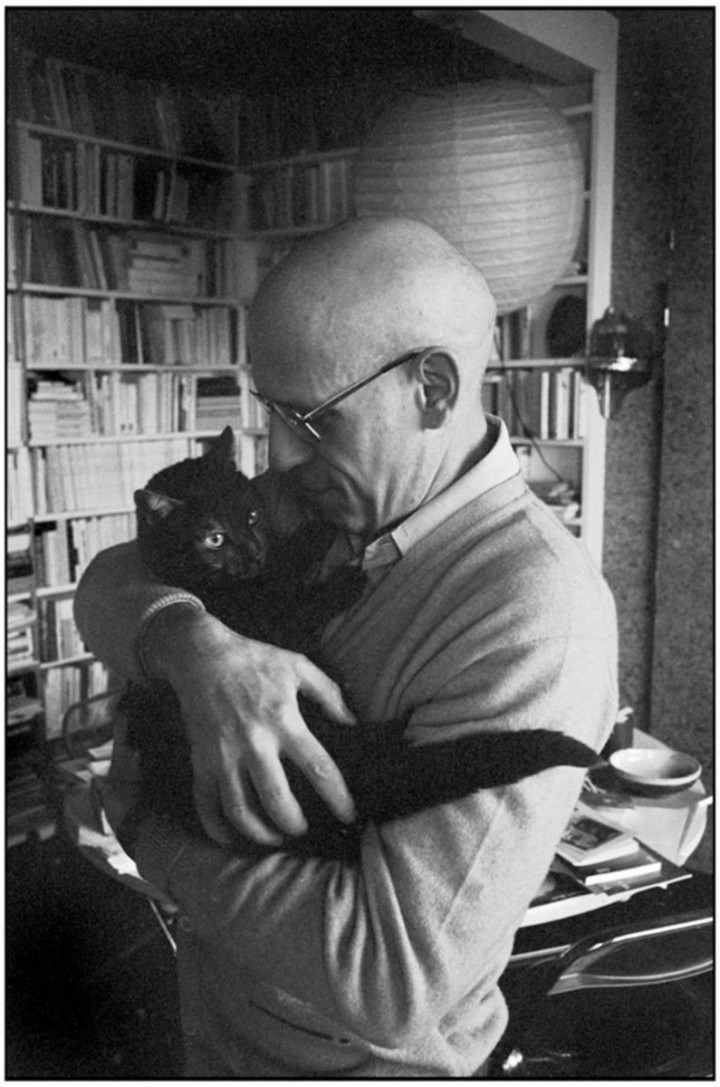Foucault - Naissance de la biopolitique (1979)
"Naissance de la biopolitique" Michel Foucault
Cours au collège de France - 1979
Abrégé résumé par César Valentine
Michel Foucault est un philosophe français (1926 - 1984).
Résumé de cours
Population et libertés individuelles :
Ce cours est finalement une introduction à la biopolitique. La biopolitique étant entendu comme la rationalisation des problèmes posés par la population : santé, hygiène, natalité, longévité, races. On ne peut pas dissocier la question de la population du libéralisme. Comment le phénomène population peut-il être pris en compte dans un système soucieux du respect des sujets de droit et de la liberté d'initiative ? Au nom de quoi, et selon quelle règle peut-on gérer la population ?
Le libéralisme : une gouvernementalité qui veut moins gouverner
Ce cours essaie d'analyser le libéralisme comme une pratique ordonnée vers des objectifs, et non comme une théorie ou une idéologie. Foucault voit le libéralisme comme une méthode de rationalisation de la gouvernementalité, rationalisation qui obéit à la règle interne de l'économie maximale : c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas sa propre fin, et n'a pas en soi de raison d'être.
Le libéralisme fait donc rupture avec les autres formes de gouvernementalité. Effectivement, la gouvernementalité cherche traditionnellement à maximaliser ses effets en en diminuant le coût. Le libéralisme rompt donc avec la raison d'État (renforcement de l'État) et l'État de police (partir du principe qu'on gouverne trop peu). Au contraire, pour le libéralisme, on gouverne toujours trop. Pour le libéralisme, il faut donc s'interroger sur les meilleurs moyens d'atteindre ses effets, mais surtout sur la légitimité même de son projet d'atteindre des effets. En somme, la question qui est posée est : pourquoi faut-il gouverner ? D'où cette nouvelle problématique : "la société", car c'est au nom de la société qu'on va poser la question de l'utilité du gouvernement.
Le libéralisme n'est pas une utopie
Le libéralisme n'est donc pas une utopie, c'est un instrument critique de la réalité, un instrument critique de la gouvernementalité. Voilà pourquoi on peut trouver le libéralisme sous des formes différentes, selon la gouvernementalité qu'il régule, ou qu'il critique.
Le libéralisme n'est pas le développement du marché
Le libéralisme n'est donc pas la conséquence du marché (il n'est pas la conséquence d'une analyse économique), le marché a plutôt servi de "test" dans la critique libérale, pour repérer les effets de l'excès de gouvernementalité.
Le libéralisme n'est pas la conséquence d'un contractualisme
Le libéralisme n'est pas non plus la conséquence d'une réflexion juridique et contractualiste. Mais c'est dans la loi que le libéralisme a cherché une régulation, et non dans la sagesse des gouvernants.
Deux voies de limitation de la puissance publique :
Foucault fait apparaître deux voies de limitation de la puissance publique :
- La voix axiomatique révolutionnaire : partir des droits de l'homme pour fonder le pouvoir souverain.
- La voix radicale utilitariste : partir de la pratique gouvernementale pour définir, en termes d'utilité, la limite de compétence du gouvernement et la sphère d'indépendance des individus.
C'est dans leurs interactions qu'il faut étudier le libéralisme européen.
Liberté et sécurité
Le libéralisme garantit la liberté, mais produit aussi la liberté. Pour fonctionner, le libéralisme a besoin de susciter la liberté, de l'entretenir et de l'encadrer en permanence. De fait, le libéralisme peut se définir comme le libre jeu des intérêts individuels compatible avec l'intérêt de tous. Donc l'incitation à "vivre dangereusement" implique des mécanismes de sécurité. Liberté et sécurité : ce sont les formes d'intervention étatique requises par cette double exigence qui constituent le paradoxe du libéralisme.
10 janvier 1979
Je voudrais ressaisir la manière dont on a tenté de conceptualiser cette pratique qui consiste à gouverner. Parler de la pratique gouvernementale c'est une manière de laisser de côté tout un ensemble de notions qui sont des universaux, comme par exemple, le souverain, la souveraineté, le peuple, les sujets, l'État, la société civile. Donc au lieu de partir des universaux pour en déduire des phénomènes concrets, je voudrais partir de pratiques concrètes pour analyser les universaux.
L'âge de la raison d'État (XVIe et XVIIe)
L'État, c'est à la fois ce qui existe, mais ce qui n'existe pas assez. Et gouverner selon le principe de la raison d'État, c'est faire en sorte que l'État devienne ce qu'il doit être : solide, permanent, riche et fort en face de tout ce qui peut le détruire.
Ce qui caractérise la raison d’Etat qui se constitue au XVIe, c'est que l'État est défini comme une réalité spécifique et autonome. L'État doit respecter des règles en rapport aux autres Etats, ainsi que les lois divines, mais il n'a plus à se préoccuper du salut de ses sujets dans l'au-delà, ni à avoir un rôle paternel comme au Moyen-Âge. Autrement dit, l'État n'est ni une maison, ni une église, ni un empire. L'État est une réalité spécifique et discontinue, il n'existe que pour lui-même, par rapport à lui-même et il n'existe qu'au pluriel c’est-à-dire entouré d’autres états. Il n'y a pas d'intégration de l'État à l'Empire.
Cette spécificité plurielle de l'État s'est formée dans des institutions précises :
- La politique économique : le mercantilisme (organisation de la production selon plusieurs principes) :
- L'État doit s'enrichir par l'accumulation monétaire
- L'État doit se renforcer par l'accroissement de la population
- L'État doit se maintenir dans un état de concurrence permanent avec les puissances étrangères
- La politique intérieure : la police
- La politique étrangère : constitution d'une armée et d'un appareil diplomatique pour maintenir la pluralité des États sans que des unifications de type impérial se fassent en Europe
Objectifs limités et illimités
L'État se donne un objectif limité dans sa politique étrangère, à la différence de ce que faisaient les souverains du Moyen-Âge. L'état n'a pas à rêver d'être un jour l'empire du dernier jour, mais il doit assurer son indépendance et ses forces pour ne pas être en état d'infériorité par rapport aux autres pays.
En revanche, cela implique que l'état de police doit avoir des objectifs illimités pour prendre en charge au maximum l'activité des individus, l'objectif étant le renforcement de l'État lui-même. Donc, objectif limité en face des autres puissances, et objectif illimité pour régler le comportement des sujets.
Le droit comme mécanisme externe de limitation du gouvernement
Il y a eu plusieurs mécanismes de limitation à cet objectif illimité de l'état de police. L’un d’eux est le droit. Le droit va servir à toute personne qui voudra limiter cette extension illimitée de la raison d'État prenant corps dans un état de police.
Donc les institutions judiciaires vont maintenant servir, non plus de multiplicateur, mais au contraire de soustracteur au pouvoir royal. De sorte que le droit, qui était intrinsèque au développement du pouvoir royal, devient dès lors extérieur et excessif par rapport à la raison d'État.
Il y a eu une perpétuelle tentative au XVIe et XVIIe de limiter la raison d'État par la raison juridique. Le droit devient donc une limitation externe, puisque la raison d'État est précisément ce qui est en dehors du droit.
Que le droit est extérieur à la raison d'État, cela veut dire :
- Que les limites qu'on essaie de poser à la raison d'État viennent de Dieu ou d'une origine lointaine.
- Que ces limites ont un fonctionnement purement limitatif puisque on objectera le droit à la raison d'État uniquement quand la raison d'État aura franchi ces limites de droit = moment où le droit peut définir le gouvernement comme gouvernement illégitime.
L'autolimitation du gouvernement (XVIIIe) : l'âge de la raison gouvernementale critique
On constate au XVIIIe une transformation importante qui annonce la raison gouvernementale moderne : la mise en place d'un principe de limitation de l'art de gouverner qui ne lui est plus extrinsèque (comme l’était le droit au XVIIe) mais qui lui intrinsèque :
- Limitation de fait : Cette limitation n'est pas une limitation de droit, mais une limitation de fait. Si le gouvernement bouscule cette limitation, il ne sera pas pour autant illégitime, usurpateur, mais ce sera un gouvernement maladroit, inadapté, il n'aura donc pas abandonné sa propre essence.
- Limitation générale : La limitation suit des principes valables à travers toutes circonstances.
- Limitation comme moyen pour réaliser les objectifs : Cette limitation est le moyen fondamental d'atteindre les objectifs du gouvernement.
- Limitation qui partage les choses à faire : Cette limitation va établir un partage entre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce partage n'est pas dans les individus, mais dans le domaine de la pratique gouvernementale. Cette limitation ne partage pas les sujets dans leur liberté, mais partage les choses à faire.
- Limitation fondée sur une naturalité : Ce ne sont pas ceux qui gouvernent qui vont décider de ce qui est à faire et ne pas faire, car le gouvernement des hommes n'est pas une pratique imposée par ceux qui gouvernent à ceux qui sont gouvernés, mais c’est une pratique qui fixe la définition et la position respectives des gouvernés et des gouvernants. Cette limitation n'est donc imposée ni par les gouvernés, ni par les gouvernants.
Avec ce principe de limitation, on rentre dans l'âge de la raison gouvernementale critique. Ce n'est plus la question du droit et donc de l’usurpation du souverain qui est posée, mais c'est la question de l'autolimitation du gouvernement, c'est-à-dire "comment ne pas trop gouverner". Ce n'est donc plus l'abus de souveraineté qu'on va critiquer, mais l'excès du gouvernement.
L'économie politique
Ce n’est pas le droit qui a permis l'émergence, au milieu du XVIIIe, d’une limitation interne de la raison gouvernementale, mais c'est l'économie politique.
Entre 1750 et 1810, l'expression "économie politique" reçoit différents sens :
- Analyse de la production et de la circulation des richesses
- Méthode de gouvernement susceptible d'assurer la prospérité d'une nation
- Réflexion générale sur l'organisation, la distribution et la limitation des pouvoirs dans une société
Les objectifs de l'économie politique
L'économie politique s’est développée dans le cadre même des objectifs du gouvernement, à la différence de la pensée juridique des XVIe et XVIIe qui s'était développée à l'extérieur de la raison d'État. Les objectifs de l'économie politique sont :
- L'enrichissement de l'État
- Croissance simultanée de la population et des subsistances.
- Maintenir un équilibre entre les États pour que la concurrence puisse avoir lieu.
L'économie politique reprend donc les objectifs que l'état de police, le mercantilisme, et la balance européenne avaient essayé de réaliser.
- Un despotisme absolu
A partir de leurs analyses économiques, les physiocrates ont conclu que le pouvoir politique devait être un despotisme sans limitation externe. Le gouvernement économique définit et contrôle lui-même son économie.
Donc là aussi, l'économie politique rappelle la raison d'État qui donnait au monarque un pouvoir absolu. - Des réflexions indexées sur les effets de la gouvernementalité
L'économie politique réfléchit sur les pratiques gouvernementales à partir de leurs effets, et non à partir d'un droit légitime.
Exemple : la question n'est plus : "qu'est-ce qui autorise un souverain à lever des impôts ?", Mais, "quand on lève un certain impôt, qu'est-ce qui va arriver ?".
Quand une mesure a des effets négatifs, on dira qu'elle est illégitime, et quand elle a des effets positifs, on dira qu’elle est légitime. - La découverte d'une nature propre à la gouvernementalité
En répondant à ce type de questions, l'économie politique découvre qu'il y a une nature propre à l'action gouvernementale. Non pas une nature originaire conditionnant l'action politique, mais une nature corrélative de l'action politique.
Exemple : les économistes diront que c'est une loi de nature que la population se déplace vers les salaires les plus élevés. - La substitution de la réussite à la légitimité
La pratique gouvernementale ne pourra réaliser ses objectifs qu’en tenant compte de ces lois de nature. Ce sont elles qui conditionneront la réussite ou l'échec. Ce n'est donc plus la légitimité ou l'illégitimité qui sont le critère de l'action gouvernementale, mais la réussite ou l'échec.
L'économie politique comme nouveau régime de vérité
De fait, si le gouvernement viole les lois de nature, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est parce qu'il méconnaît ces lois. Cela implique que les gouvernements peuvent se tromper. Le plus grand mal d'un gouvernement, ce n'est donc pas la méchanceté du prince, mais c'est son ignorance.
Avec l'économie politique, le gouvernement doit toujours faire attention de ne pas trop gouverner. Le principe du maximum/minimum se substitue à l'ancienne notion de justice équitable. C'est donc une nouvelle autolimitation de la pratique gouvernementale indexée sur le principe de la vérité de l'économie politique. Ce nouveau régime de vérité est caractéristique de l'âge de la politique.
Concrètement, ça veut dire qu'il existait jusqu'au milieu du XVIIIe des pratiques qui étaient pensées comme l'exercice de droits souverains (levées fiscales, règlements de fabrications, codification des pratiques de marché...), mais ces pratiques étaient pensées à partir de différents principes de rationalisations : enrichir le trésor, empêcher les révoltes. Or, au milieu du XVIIIe, on va établir une cohérence raisonnée entre ces différentes pratiques autour de la question des effets. C’est-à-dire qu’on va juger les pratiques gouvernementales, non pas en fonction d'un principe moral, mais en fonction de leurs effets.
Trois régimes de vérité ou trois types de rationalités dans l'art de gouverner
On peut donc observer un déplacement des questions relatives à l'art de gouverner à travers trois moments, trois différents régimes de vérité :
- Conformité : question de la conformité aux lois divines pour réaliser l'État (jusqu'au XVIe)
- Intensité : question de l'intensité de l'action gouvernementale pour réaliser l'État (la raison d'État XVIe et XVIIe)
- Autolimitation : question de l'autolimitation de l'action gouvernementale pour réaliser l'État (milieu du XVIIIe)
L'événement radical qui fait rupture et annonce le régime de l'autolimitation
Le moment qui marque ce changement, c'est un texte du marquis d'Argenson rappelant les mots du commerçant Le Gendre à Colbert quand ce dernier lui disait : "Que puis-je faire pour vous ?". Le Gendre avait alors répondu : "Ce que vous pouvez faire pour nous ? Laissez-nous faire".
Ce principe "laissez-nous faire", doit être suivi par tout gouvernement en matière économique, et est à la base du principe de l'autolimitation de la raison gouvernementale.
Naissance du libéralisme
Ce nouveau type de rationalité dans l'art de gouverner, c'est ce que l'on appelle le "libéralisme". Tous ces problèmes ont pour noyau central la population, c'est donc à partir de la population qu'une biopolitique a pu se former (Foucault ne reparlera plus de Biopolitique).
17 janvier 1979
Ce nouvel art de gouverner a pour fonction, non pas d'assurer la croissance indéfinie de l'État, sa force, sa richesse, mais de limiter de l'intérieur l'exercice du pouvoir de gouverner. Cet art de gouverner le moins possible, ne constitue cependant pas la suppression de la raison d'État, il agit au service du maintien de la raison d'État, de son développement, de son perfectionnement.
On rentre donc à la fin du XVIIIe dans une époque qui est celle du "gouvernement frugal", ou encore du "moindre État". La question de la frugalité se substitue à la question de la Constitution qui hantait la réflexion politique du XVIe et XVIIe. La question de la frugalité du gouvernement, c'est la question du libéralisme.
Ce gouvernement frugal s'est formé à partir du branchement de la raison d'État et de l'économie politique. C'est ce branchement qui va devenir un lieu et un mécanisme de formation de vérité. Ce lieu de vérité, ce n'est pas les discours des économistes, c'est le marché.
Le marché, du Moyen-Âge au XVIIe était un lieu de juridiction, un lieu de justice :
- Réglementation : Un lieu de justice car investi d'une réglementation proliférante et stricte.
- Juste prix : Un lieu de justice car le prix de vente fixé dans le marché était considéré par les théoriciens comme un prix juste. Donc un lieu de justice distributive.
- Sanction de la fraude : Un lieu de justice où ce qui devait être assuré, c'était l'absence de fraude, c'est-à-dire la protection de l'acheteur.
Or, au XVIIIe, le marché ne pouvait plus apparaître comme un lieu de juridiction, mais comme quelque chose obéissant à des mécanismes naturels. Le marché a donc été vu comme un ensemble de mécanismes spontanés qu'on ne peut entreprendre de modifier sans risquer de dénaturer.
Ces mécanismes naturels permettent la formation d'un certain prix qu'on appellera "prix naturel", "bon prix", "juste prix" ou encore métaphoriquement, le "vrai prix". Il exprime le rapport adéquat entre coût de production (= prix) et étendue de la demande (= valeur). Mais le prix naturel, ce juste prix, ne porte plus en lui ces connotations de justice.
Cette théorie du rapport prix-valeur, permet à la théorie économique de définir le marché comme étalon de vérité pour discerner dans les pratiques gouvernementales, celles qui sont correctes et celles qui sont erronées. En d'autres mots, le marché va pouvoir falsifier et vérifier la pratique gouvernementale. Le marché n'est plus un lieu de juridiction, il devient un lieu de vérification-falsification de la pratique gouvernementale. C'est le marché qui va faire que le gouvernement ne doit plus simplement fonctionner à la justice, mais doit fonctionner à la vérité.
Ce couplage au XVIIIe, entre un régime de vérité économique et une nouvelle raison gouvernementale, n'est pas le produit d'un discours scientifique économique qui aurait séduit ou contraint les gouvernants. Évidemment, le marché était depuis longtemps au cœur des pratiques gouvernementales, et encore plus au XVIe et XVIIe sous le mercantilisme de la raison d'État. Pour savoir comment le marché en est venu à être un lieu de véridiction pour la pratique gouvernementale, il faudrait croiser un grand nombre de facteurs. Autrement dit, il semble difficile de pouvoir trouver la cause de la constitution du marché comme instance de véridiction. Mais si on voulait quand-même analyser ce phénomène, il faudrait rendre intelligible ce processus, c'est-à-dire montrer en quoi il a été possible. Effectivement, ce qui permet de rendre intelligible le réel, c'est de montrer simplement qu'il a été possible.
(L’analyse politique à partir des régimes de véridiction : Foucault a toujours essayé de faire une histoire de la vérité couplée avec l'histoire du droit (comment du vrai émerge à partir du légal ?). Faire l'histoire des régimes de véridiction, ce n'est pas faire l'histoire de la vérité, ni de l'aveu, ni de l'idéologie. Il faut au contraire déterminer sous quelles conditions et avec quels effets s'exerce une véridiction, c'est-à-dire un type de formulation ayant des règles de vérifications et de falsifications.
Pour que l'analyse ait une portée politique, il faut qu'elle porte non pas sur la genèse des vérités, mais il faut déterminer le régime de véridiction à partir duquel on peut maintenant reconnaître que, dans tel ou tel champ, beaucoup de bêtises ont été dites.
Ce qui est important, ce n'est pas se rappeler des bêtises qui ont été dites, mais c'est déterminer le régime de véridiction qui a permis de dire tant de bêtises. C'est comme cela, et non en faisant une histoire du vrai et du faux, qu'une analyse historique peut avoir une portée politique).
Comment limiter la puissance publique
Le système du gouvernement frugal implique une limitation interne, donc nécessairement juridique. On ne peut pas penser la liberté de marché sans poser le problème du droit public, à savoir la limitation de la puissance publique. Donc l'autolimitation de la raison gouvernementale n'est pas une disparition du droit, mais un déplacement des problèmes. Au XVIIe c'était de savoir à quelle condition le souverain était légitime. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe, la question est devenue de savoir comment mettre des bornes juridiques à une puissance publique.
On a proposé deux voies pour répondre à cette question :
- La voie révolutionnaire (= voie juridico-déductive)
Consiste à partir du droit, c'est-à-dire :- Définir les droits naturels qui appartiennent à tout individu.
- Définir dans quelles conditions, à cause de quoi, on a accepté une limitation de droit.
- Définir les droits qu'on a abandonnés, et ceux que l’on n’a pas abandonnés, et qui restent donc sous tout gouvernement, des droits imprescriptibles.
- Déduire à partir de là, les frontières de la compétence du gouvernement.
C'est donc partir des droits de l'homme pour arriver à la délimitation de la gouvernementalité.
- La voie radicale utilitariste
Consiste à partir de la pratique gouvernementale, c'est-à-dire :- L'analyser en fonction de ses limites de fait : Histoire, tradition…
- L'analyser en fonction de ses limites souhaitables : ressources, population, économie…
- Dégager à partir de là ce qu'il serait utile et inutile pour le gouvernement de faire et de ne pas faire.
Donc, la limite de compétence du gouvernement sera définie par les frontières de l'utilité d'une intervention gouvernementale.
Donc deux voies :
- La voie axiomatique révolutionnaire
La loi est conçue comme l'expression d'une volonté collective manifestant la part de droits que les individus ont accepté de céder, et la part qu'ils veulent garder. La liberté est une construction juridique, c'est l'exercice de droits fondamentaux : tout individu détient originairement une certaine liberté dont il peut céder une part (= conception de la liberté à partir des droits de l'homme) - La voie radicale utilitariste
La loi est conçue comme l'effet d'une transaction qui partage l'intervention de la puissance publique et l'indépendance des individus. La liberté est l'indépendance des gouvernés à l'égard des gouvernants.
Ce sont donc deux chemins différents pour constituer en droit la régulation de la puissance publique. Et c'est cette ambiguïté (ces deux procédures hétérogènes qu'on a fait tenir ensemble) qui caractérise le libéralisme européen du XIXe et du XXe siècle.
Question de méthode
À la place d'une logique dialectique qui tombe dans le simplisme en voulant résoudre les contradictions dans une homogénéité idéaliste, il faut opposer une logique de la stratégie qui a pour fonction d'établir les connexions possibles entre des termes hétérogènes. Donc connexion de l'hétérogène, et non logique de l'homogénéisation du contradictoire (attaque de Foucault à l'encontre de Hegel). Essayons ainsi de voir les connexions qui ont pu faire tenir ensemble la voie des droits de l'homme et le calcul utilitaire et empirique de l'indépendance des gouvernés.
Exemple : dans l'histoire du droit de propriété, c'est la voie utilitariste qui l'a emporté. Cette voie consistait à définir la limitation juridique de la puissance publique en termes d'utilité gouvernementale. C'est cette voix qui va caractériser l'histoire de la puissance publique en Occident = problème de l'utilité individuelle et collective. Or, depuis le début du XIXe, le problème de l'utilité tend à recouvrir tous les problèmes traditionnels du droit.
Sur l'autolimitation de la raison gouvernementale
La nouvelle raison gouvernementale a donc deux points d'ancrage :
- L'échange du côté du marché
- L'utilité du côté de la puissance publique
Voilà comment la raison gouvernementale articule les principes fondamentaux de son autolimitation : il faut respecter l'échange dans le marché puisque le marché est véridiction, et il faut un principe d'utilité pour limiter la puissance publique, puisqu'elle ne doit s'exercer que là où elle est utile.
L'intérêt
La catégorie générale qui va recouvrir l'échange et l'utilité, c'est l'intérêt. L'intérêt est le principe de l'échange et le critère de l'utilité. La raison gouvernementale du XVIIIe fonctionne à l'intérêt. Le gouvernement, c'est quelque chose qui manipule des intérêts.
Dans le système précédent, le souverain, l'État, avait prise sur tout. Désormais, l'État n'a pas de prise directe sur les choses et les gens. L'État n'est légitime à entreprendre une action que dans la mesure où il y a des intérêts.
Le nouveau gouvernement n'a plus affaire à ces choses en soi que sont les individus, les choses, les richesses, les terres. Il a affaire à ces phénomènes de la politique que sont les intérêts, c'est-à-dire ce par quoi tel individu, telle chose, telle richesse intéresse les autres individus ou la collectivité.
(Entre le crime et l'autorité qui a le droit de punir, s'est interposé le tissu des intérêts qui sont désormais la seule chose sur quoi la raison gouvernementale peut avoir prise. La punition doit être calculée en fonction des intérêts de la personne lésée, de la réparation des dommages, de l'intérêt pour la société…)
Le gouvernement n'a plus à s'exercer sur des sujets, mais va s'exercer maintenant sur la trame phénoménale des intérêts. Et la question fondamentale du libéralisme devient "Quelle est l'utilité du gouvernement dans une société où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses ?"
Le problème étant de savoir si toutes les formes politiques que l'on a voulu opposer au libéralisme peuvent échapper à cette question de l'utilité d'un gouvernement, dans un régime où c'est l'échange qui détermine la valeur des choses.
24 janvier 1979
L'Europe et l'espace international dans le libéralisme
Le traité de Westphalie : une balance européenne
On se souvient que dans la raison d'État, il y avait la recherche d'une balance européenne, c'est-à-dire un certain équilibre entre les États pour qu'aucun ne l'emporte sur les autres et constitue un empire.
C'est le traité de Westphalie qui établit finalement cette balance européenne. Ce traité signé en 1648 conclut deux conflits en Europe : la guerre de Trente Ans et la guerre des Quatre-Vingts ans. Ce traité définit les États comme légitimes sur leur territoire propre. Les États reconnaissent :
- Une souveraineté extérieure : aucune autorité n'est supérieure aux autres.
- Une souveraineté intérieure : aucun État ne peut s'immiscer dans les affaires d'un autre État.
- Un équilibre des puissances : les États ont le droit de s'allier pour éviter la montée d'une superpuissance.
Par ailleurs, le mercantilisme a besoin d'un équilibre européen. En effet, pour le mercantilisme la concurrence entre États suppose que ce qui est acquis par l'un, doit être enlevé à l'autre. On ne peut s'enrichir qu'aux dépens des autres. Autrement dit, pour le mercantilisme, le jeu économique est un jeu à somme nulle : il y a un gâteau à partager, et les parts passent d'une main à l'autre. L'équilibre européen consiste précisément à éviter qu'il n'y ait qu'un gagnant.
La liberté de marché : un enrichissement mutuel
Or, au milieu du XVIIIe, dans cette nouvelle raison d'État, raison du moindre État (marché véridictionnel et utilité juridictionnelle), les choses vont être différentes. Pour les physiocrates comme pour Adam Smith, la liberté de marché doit établir naturellement les prix naturels. Le prix naturel sera profitable aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur. Donc le jeu de la concurrence à l'état libre doit permettre un profit double : maximum de profit pour le vendeur, minimum de dépenses pour l'acheteur. De sorte que l'enrichissement d'un individu, comme d'un pays, ne peut s'établir que par un enrichissement mutuel. La richesse de mon voisin m'importe pour mon enrichissement personnel. Donc soit l'Europe tout entière sera riche, soit l'Europe tout entière sera pauvre.
On entre dans l'âge de la concurrence, c'est donc une nouvelle idée de l'Europe qui se dessine. Ce n'est plus l'Europe impériale héritant de l'Empire romain. Ce n'est plus l'Europe classique de la balance entre les États, c'est une Europe de l'enrichissement collectif et du progrès économique illimité.
Le marché mondial
Mais pour qu'il y ait enrichissement réciproque de tous les pays d'Europe, il faut un marché de plus en plus étendu, c'est-à-dire qu’il faut la totalité du monde. L'enrichissement collectif implique donc une mondialisation du monde. Ce n'est bien sûr pas la première fois que l'Europe pense le monde, mais c'est la première fois que l'Europe en tant qu'unité économique pense le monde comme devant être son domaine économique.
Cette ouverture du marché mondial permet d'éviter les effets conflictuels d'un marché fini, mais elle implique une différence de statut entre l'Europe et le reste du monde : les Européens sont les joueurs et le reste du monde est l'enjeu.
Rationalité planétaire
Bien sûr, ce n'est pas le début de la colonisation, car il y avait bien longtemps qu'elle avait commencé. Mais on a là une nouvelle forme de rationalité planétaire en Europe dont on peut donner quelques signes :
- L'histoire du droit de la mer au XVIIIe : on a essayé de penser la mer comme un espace de libre concurrence, comme une des conditions nécessaires à l'organisation d'un marché mondial.
- Les projets de paix et d'organisation internationale au XVIIIe : c'est l'illimitation du marché extérieur qui est censé garantir la paix perpétuelle.
La nature comme fondement du juridique
Dans le texte de Kant "La garantie de la paix perpétuelle" écrit en 1795, Kant dit que ce n'est pas la volonté des hommes, leur entente, ou encore leurs combinaisons diplomatiques qui pourront donner cette paix perpétuelle, mais c'est la nature. La nature a mis des hommes partout sur la planète, et pour vivre ils doivent produire et échanger avec les hommes d'autres régions. À partir de là, la nature a prescrit à l'homme un certain nombre d'obligations qu'elle a dictées dans la disposition même des choses :
- La nature a voulu que les hommes aient la possibilité d'échanger des propriétés : cette propriété de nature deviendra le droit civil.
- La nature a voulu que les hommes soient répartis en régions distinctes : cette propriété de nature deviendra le droit international.
- La nature a voulu qu'il y ait entre ces États des relations commerciales : cette propriété de nature deviendra le droit commercial.
Droit civil, international et commercial, sont la reprise juridique par l'homme d'un précepte de nature. En reprenant le précepte de nature, le droit va pouvoir promettre ce que promettait originairement la nature : la paix perpétuelle. Donc la planétarisation commerciale est la garantie, ou plutôt la promesse, de la paix perpétuelle.
(Mais bien évidemment cela ne veut pas dire qu'on entre dans une époque de paix européenne. Car au XIXe siècle on entre dans la pire époque de la guerre, des protectionnismes économiques, des nationalismes politiques).
Donc pour résumer, voilà les trois traits du libéralisme au XVIIIe siècle :
- Véridiction du marché
- Limitation par le calcul de l'utilité gouvernementale
- Développement économique illimités de l'Europe par rapport à un marché mondial
Naturalisme ou libéralisme
Cependant, c'est beaucoup plus le naturalisme que le libéralisme qui caractérise ce nouvel art de gouverner. Car pour les physiocrates, cette liberté est plus une naturalité des processus économiques qu'une liberté juridique des individus. De même, chez Kant, la paix perpétuelle est garantie par la nature et non par le droit. Quand, au XVIIIe siècle, les physiocrates découvrent la naturalité de l'économie, ils ne tirent pas comme conséquence qu'il faut donner aux hommes la liberté d'agir comme ils veulent, ni que le gouvernement doit être le moins autoritaire possible, mais ils déduisent que le gouvernement doit connaître la nature de ces mécanismes économiques. Ce n'est donc pas la liberté des individus qui limite le pouvoir de l'État, mais le respect des lois économiques. Mais on peut malgré tout parler de libéralisme car la liberté est au cœur des problèmes posés par ce nouvel art de gouverner.
Le libéralisme ≠ plus de liberté
Parler de libéralisme ne veut donc pas dire qu'on passe d'un gouvernement autoritaire au XVIIe à un gouvernement plus tolérant au XVIIIe. La quantité de liberté n'a pas augmenté :
- Juger la quantité de liberté entre deux systèmes n'a pas beaucoup de sens, car il n'y a pas un type de mesure qu'on pourrait appliquer.
- La liberté ce n'est pas une surface blanche avec des cases noires plus ou moins nombreuses. La liberté est un rapport actuel entre gouvernants et gouvernés où le sentiment du manque de liberté est donné par le désir de liberté qui est demandé.
Gestionnaire de liberté
Si j'emploie le mot "libéral", c'est parce que la nouvelle raison gouvernementale est consommatrice de liberté. Elle a besoin de liberté : liberté de marché, liberté du vendeur, de l'acheteur, droit de propriété, liberté de discussion… Or, consommer de la liberté oblige d'en produire. Le nouvel art gouvernemental devient donc gestionnaire de la liberté. Il ne produit pas la liberté au sens de l'impératif "sois libre". En fait, le libéralisme formule "je vais te produire de quoi être libre". Il produit donc des conditions à la liberté, ce qui implique un rapport de production/destruction avec la liberté : produire la liberté implique d'établir des limitations, des contrôles, des obligations appuyés sur des menaces.
On a évidemment quelques exemples de cela :
- La liberté du commerce ne peut s'exercer que si on contrôle, limite, et prévient les effets de suprématie d'un pays sur les autres.
- La liberté du marché intérieur nécessite une législation anti-monopole.
- La liberté du marché du travail demande qu'il y ait suffisamment de travailleurs, qu'ils soient suffisamment qualifiés, et qu'ils soient politiquement désarmés pour ne pas faire pression sur le marché du travail.
Liberté et sécurité
La liberté dans le libéralisme, ce n'est donc pas une donnée, c'est quelque chose qui se fabrique à chaque instant. Le libéralisme ce n'est pas ce qui accepte la liberté, c'est ce qui se propose de la fabriquer à chaque instant avec l'ensemble de contraintes, de problèmes de coût que pose cette fabrication. Et le principe de calcul de ce coût de la fabrication de la liberté c'est ce qu'on appelle la sécurité. Le problème de la sécurité, c'est protéger l'intérêt collectif contre les intérêts individuels, et inversement, protéger les intérêts individuels contre l'intérêt collectif.
Les stratégies de sécurité sont l'envers et la condition même du libéralisme. Le jeu liberté/sécurité est au cœur de cette nouvelle raison gouvernementale. Le libéralisme ne peut pas manipuler les intérêts sans être en même temps gestionnaire des dangers et des mécanismes de sécurité/liberté. C'est ce jeu sécurité/liberté qui doit assurer que les individus ou la collectivité seront le moins possible exposés au danger.
Cela entraîne des conséquences :
- Culture du danger
La devise du libéralisme, c'est "vivre dangereusement". Les individus sont conditionnés à éprouver leur vie comme étant porteuse de danger. On voit apparaître toute une culture du danger au XIXe (littérature policière, intérêt journalistique pour le crime, campagnes sur la maladie et l'hygiène, crainte de la dégénérescence : dégénérescence de l'individu, de la famille, de la race, de l'espèce humaine). Pas de libéralisme sans culture du danger. - Les disciplines
Extension des procédures de contrôle, de contrainte, de coercition, comme contrepartie des libertés. La liberté économique et les techniques disciplinaires sont parfaitement liées. - Mécanismes de contrôle et d'intervention
Apparition de mécanismes de contrôle et d'intervention qui ont pour fonction de produire des libertés. Le contrôle est donc le principe moteur de la liberté. Mais les dispositifs destinés à produire la liberté risquent de produire exactement l'inverse.
31 janvier 1979
La phobie d'État
La phobie d'État est un des signes majeurs de la crise de gouvernementalité. Il y a eu critique et phobie du despotisme à la fin du XVIIIe siècle, de la même façon il y a phobie de l'État aujourd'hui. À noter que la dissidence politique du XXe siècle a été un agent de diffusion de la phobie d'État.
Questions de méthode : analyser les mécanismes du pouvoir plutôt que faire une théorie de l'État
Je veux faire l'économie d'une théorie de l'État. Cependant, cette économie d'une théorie de l'État n'est en aucun cas le gommage des mécanismes étatiques. Car que ce soit avec la folie, la médecine ou encore le système pénal, mon travail a toujours été le repérage de l'étatisation progressive des pratiques de gouvernementalité. Il ne faut pas commencer par analyser en elle-même la nature de l'État. Il ne faut pas, à partir d'un universel politique, à partir de l'essence de l'État, déduire le statut des fous, des malades, des enfants, des délinquants, car :
- L'histoire n'est pas une science déductive
- L'état n'a pas d'essence, ce n'est pas un universel
L'État n'est que l'effet d'une perpétuelle étatisation, l'effet de transactions incessantes qui modifient les centres de décisions, qui modifient les formes et les types de contrôle. L'état n'a pas d'entrailles, pas d'intérieur. Il faut donc analyser cette phobie d'État, non en arrachant à l'État le secret de ce qu'il est, mais en passant à l'extérieur, c'est-à-dire en interrogeant l'État à partir des pratiques de gouvernementalité.
Deux formes de néolibéralisme
On repère le néolibéralisme de notre époque sous deux ancrages différents :
- L'ancrage allemand : République de Weimar, nazisme et reconstruction d'après-guerre.
- L'ancrage américain : néolibéralisme qui se développe après la guerre, principalement contre l'interventionnisme fédéral.
Ces deux formes de néolibéralisme ont le même adversaire : Keynes. Et elles ont les mêmes objets de répulsion : l'économie dirigée, la planification, l'interventionnisme d'État.
Le néolibéralisme allemand entre 1948 et 1962
Dans toute l'Europe, les politiques économiques sont commandées par une série d'exigences :
- Exigence de reconstruction : reconversion d'une économie de guerre en une économie de paix, reconstitution de l'économie, intégration de nouvelles données technologiques apparues pendant la guerre.
- Exigence de planification : la planification est l'instrument majeur de cette reconstruction.
- Exigence sociale : les objectifs sociaux sont politiquement indispensables pour éviter que recommence le fascisme et le nazisme en Europe.
Ces trois exigences impliquent une politique d'intervention sur l'équilibre des prix, sur le niveau d'épargne, une politique du plein emploi. On est donc dans une politique keynésienne.
La liberté économique comme source de la légitimité de l'État
En 1948, un conseil scientifique formé auprès de l'administration allemande installée dans la bizone (zone anglo-américaine), dépose un rapport favorable à ce que le processus économique soit assuré par le mécanisme des prix. Ce rapport fut accepté à l'unanimité.
Dix jours plus tard, Ludwig Erhard, le responsable de l'administration économique de la bizone et futur chancelier, fait un discours dans lequel il reprend les conclusions du rapport. Mais il ajoute cette considération : "il faut éviter, et l'anarchie et l'État-termite, car seul un État établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple". En d'autres mots, ce libéralisme économique s'inscrit dans un principe beaucoup plus large : la limitation d'une façon générale des interventions de l'État. C'est donc la question de la légitimité de l'État qui est au centre de cette déclaration :
- Un état ne peut pas s'exercer légitimement s'il viole la liberté des individus. Il est déchu de ses droits de représentativité, mais pas pour autant de ses droits de souveraineté : il n'est plus représentatif des citoyens.
(L'État national-socialiste a violé les droits essentiels des individus, et se trouve donc illégitime à gouverner. Cette illégitimité de l’Etat nazi garantit la non-responsabilité du peuple allemand :- l'État national-socialiste ayant exercé illégitimement sa souveraineté, on ne peut pas tenir pour responsable le peuple allemand de ce qui a été fait dans le cadre législatif du nazisme.
- L'état national-socialiste étant déchu de ses droits de représentativité, on ne peut pas considérer la politique nazie comme la volonté du peuple allemand).
- Il n'est pas possible de créer un cadre institutionnel ayant pour fonction d'exercer la souveraineté, puisque l'état actuel de l'Allemagne ne permet pas de fonder un pouvoir juridique de coercition. Mais il est possible de créer un cadre institutionnel ayant pour fonction d'assurer la liberté dans le domaine économique. Si des individus acceptent librement le jeu de la liberté économique, cela vaudra adhésion au cadre institutionnel. Autrement dit, l'institution de la liberté économique va pouvoir fonctionner comme une amorce pour la formation d'une souveraineté politique.
On peut voir dans cette idée que c'est la liberté économique qui va fonder la légitimité de l'État, trois impératifs tactiques :
- Une astuce stratégique : trouver un palliatif juridique pour demander à un régime économique ce qu'on ne pouvait pas demander au droit constitutionnel.
- Une habileté à l'égard des Américains : en garantissant la liberté économique à l'Allemagne, on garantissait aux américains la certitude qu'ils pourraient choisir leurs rapports avec l'économie allemande.
- Une habileté à l'égard de l'Europe : on rassurait l'Europe avec une institution qui ne présentait pas les dangers d'un État totalitaire, c'est-à-dire l'assurance de ne pas retomber dans le nazisme.
Mais en dehors de ces impératifs de tactique immédiate, je crois qu'il y avait dans ce discours quelque chose de plus essentiel, et qui est un des traits fondamentaux de la gouvernementalité allemande contemporaine : c'est que dans l'Allemagne contemporaine, la croissance économique n'a pas comme seul effet d'assurer la prospérité de tous et de chacun, mais qu’en plus elle produit de la souveraineté politique. L'économie produit de la légitimité pour l'État qui est justement le garant de l'économie.
C'est donc un phénomène très singulier. L'économie est créatrice de droit public. Il y a comme une genèse permanente de l'État à partir de l'institution économique. Mais plus encore, la liberté économique produit un consensus permanent des partenaires de l'économie (investisseurs, ouvriers, patrons, syndicats) dans la mesure où ils acceptent ce jeu économique de la liberté.
Au XVIIIe siècle, le problème était de savoir comment limiter l'État, et comment faire place à la liberté économique. Les Allemands ont eu le problème exactement inverse : en partant d'un état qui n'existe pas, comment le faire exister à partir de cet espace non étatique qu'est celui d'une liberté économique ?
La richesse comme signe
Dans l'Allemagne protestante du XVIe siècle, l'enrichissement d'un particulier était un signe de la volonté de Dieu. La richesse était donc le signe de la protection divine. Mais chercher à s'enrichir en étant bon, ne permettait pas d'obtenir le salut. C'était devenir effectivement riche qui était précisément un signe de Dieu, signe que l'on obtiendrait le salut.
Dans l'Allemagne du XXe siècle, c'est l'enrichissement global qui va être signe quotidien (une monnaie forte, un taux de croissance satisfaisant, un pouvoir d'achat en expansion) de l'adhésion des individus à l'État. L'économie produit donc des signes politiques.
Renversement de l'axe du temps
L'histoire avait dit non à l'État allemand. C'était devenu après la Seconde Guerre mondiale un État hors-la-loi, mais il retrouve sa loi juridique et son fondement réel par le libéralisme.
Il s'instaure en Allemagne une nouvelle dimension de la temporalité qui ne sera plus celle de l'histoire, mais qui sera celle de la croissance économique.
Il y a donc trois notions au cœur du système économicopolitique allemand : renversement de l'axe du temps, permission à l'oubli, croissance économique.
L'absence de rationalité gouvernementale socialiste
Il manque au socialisme une rationalité gouvernementale, c'est-à-dire une mesure raisonnable et calculable de l'étendue des modalités et des objectifs de l'action gouvernementale.
Le socialisme se donne une rationalité historique, il propose une rationalité économique, il détient des techniques rationnelles d'interventions administratives (la santé, les assurances sociales…), mais il n'y a pas de rationalité gouvernementale du socialisme. En d'autres mots il n'y a pas de gouvernementalité socialiste autonome.
Le socialisme ne peut être mis en œuvre que branché sur des types de gouvernementalité divers. Dans la gouvernementalité libérale, le socialisme joue le rôle de contrepoids, de correctif à des dangers intérieurs. Voilà pourquoi la question "Où est le vrai socialisme ?" n'a pas de sens. Le socialisme n'a pas à être vrai, car de toute façon il est branché sur une gouvernementalité, et selon la gouvernementalité sur laquelle il est branché, il produit des effets différents.
Au libéralisme, on demande s'il est pur, c'est-à-dire qu'on lui demande quelles règles il se pose à lui-même. Au socialisme, on demande s'il est vrai, justement parce qu'il lui manque une rationalité gouvernementale intrinsèque. Et on substitue à ce problème de la rationalité gouvernementale interne, le rapport de conformité à un texte originel chargé de masquer cette absence de rationalité gouvernementale. Or, ce dont a besoin le socialisme, c'est de définir sa manière de gouverner. Il ne faut donc pas chercher à savoir si un socialisme trahit ou non un texte, mais il faut toujours lui demander de définir la nature de cette gouvernementalité nécessairement extrinsèque qui le fait fonctionner. Et d'une manière plus générale, il faudrait se demander quelle pourrait bien être la gouvernementalité adéquate au socialisme.
En tout cas, s'il y a une gouvernementalité effectivement socialiste, elle n'est pas cachée à l'intérieur du socialisme et de ses textes. On ne peut pas l'en déduire, il faut l'inventer. Le socialisme n'est donc pas l'alternative au libéralisme.
Pour conclure
Voilà le cadre historique à l'intérieur duquel le néolibéralisme allemand a pris corps. On a affaire à tout un ensemble qu'il est impossible de réduire à un calcul politique et à une idéologie. Il s'agit en fait d'une réorganisation interne de la gouvernementalité qui ne pose pas la question de savoir quelle liberté va être laissée à l'économie, mais qui pose la question de savoir comment la liberté de l'économie va pouvoir avoir un rôle d'étatisation, en fondant effectivement la légitimité d'un état.
7 février 1979
La question du XVIIIe : comment dans un état de police (où la liberté était liée à un statut, à un métier) dont la légitimité ne pouvait pas être mise en question, était-il possible de faire place à une liberté de marché ? Et la réponse donnée par le XVIIIe était que ce marché laissé à lui-même allait être un principe d'enrichissement et donc de puissance pour l'État. Donc plus d'État par moins de gouvernementalité.
La question qui s'est posée en Allemagne après la guerre était le problème inverse. À partir d'un État qui n'existe pas et qu'il faut faire exister, comment légitimer par avance cet état futur à partir d'une liberté économique qui va permettre à l’État d'exister, tout en assurant sa limitation.
Il nous faut donc à présent analyser comment la liberté économique peut être à la fois fondatrice et limitatrice, garantie et caution d'un État.
L’invariant anti-libéral au cœur de la politique économique nazie
Il existait en Allemagne, depuis le milieu du XIXe siècle, des critiques majeures au libéralisme :
- Économie protégée
L'économie libérale n'est qu'un instrument tactique entre les mains de quelques pays pour dominer le reste du monde. Le libéralisme, c'est la politique anglaise, politique adaptée à une nation maritime. L'Allemagne, avec sa position géographique, ne peut pas s'offrir une politique libérale, il lui faut une politique protectionniste. - Socialisme d'État
Il fallait aussi à l'Allemagne une politique intérieure socialiste qui réintègre le prolétariat à l'intérieur du consensus social et politique, pour que ce dernier ne soit pas une menace à l'unité nationale et à l'unité étatique. - Économie planifiée
Troisième obstacle à une économie libérale : la difficulté à sortir d'une économie planifiée dont l'Allemagne n'est pas sortie à la fin de la guerre. - Interventions de type keynésien
Il y a eu en Allemagne un dirigisme de type keynésien depuis 1925.
(Ces quatre éléments sont ce que Foucault nomme "l'invariant anti-libéral")
Ces quatre éléments (économie protégée, socialisme d'État, économie planifiée, interventions de type keynésien) étaient donc déjà présents dans l'économie allemande avant la prise de pouvoir par les nazis. Le nazisme a réuni et soudé ces quatre éléments dans un même système économique :
- Politique keynésienne du Dr Schacht relayée en 1936 par le plan quadriennal dirigé par Goering [4]
- Économie planifiée ayant un double objectif [3] :
- Assurer l'autarcie économique de l'Allemagne = protectionnisme absolu [1]
- Politique d'assistance = socialisme d'État (ce qui entraînait des effets inflationnistes que la préparation à la guerre permettait de payer) [2]
Trois leçons que les ordolibéraux ont tiré du nazisme
1. L'invariant anti-libéral
Les ordolibéraux allemands (école de Fribourg), ont défini leur champ d'adversité, à partir de l'expérience du nazisme. Selon les ordolibéraux, le nazisme est le révélateur de la relation nécessaire entre ces quatre éléments (économie protégée, socialisme d'État, économie planifiée, interventions de type keynésien). Ces quatre éléments sont économiquement liés. C'est-à-dire que se donner un de ces principes implique nécessairement à terme la présence des trois autres. Chacun de ces éléments finira par attirer les trois autres.
Les ordolibéraux ont essayé de repérer cet invariant relationnel, et ils ont conclu que la différence essentielle n'était pas entre soviétisme et capitalisme, mais entre une pratique libérale et n'importe quelle autre forme d'interventionnisme économique, que cet interventionnisme prenne la forme du keynésianisme ou celle du nazisme, car on y retrouve l'invariant anti-libéral.
2. Le national-socialisme est un invariant absolument lié à la croissance indéfinie d'un pouvoir d'État
La deuxième leçon que les ordolibéraux ont tiré du nazisme, c'est que le nazisme est la croissance indéfinie d'un pouvoir étatique. Or, c'était un coup de force théorique de dire cela, car quand on regarde l'Allemagne nazie, ce que l'on voit en première approche, c'est la mise à mort de l'État :
- La communauté du peuple : L'État, dans l'Allemagne nazie, a perdu son statut de personnalité juridique, car il ne peut être défini en droit que comme l'instrument du peuple (le Volk), ce dernier étant le vrai fondement du droit.
- Le principe du Führer : Dans le nazisme, l'État se trouve disqualifié de l'intérieur, puisque c'est le principe du führertum, c'est-à-dire de la conduction, qui est le principe de fonctionnement des appareils d'État. Chacun doit répondre avec fidélité et obéissance, ce n'est donc pas le jeu de l'autorité et de la responsabilité caractéristiques de l'administration européenne depuis le XIXe.
- L'existence du parti : Le parti nazi détient l'autorité aux dépens de l'état.
Mais pour les ordolibéraux, si l'État semble ainsi subordonné, c'est parce que les formes traditionnelles de l'État du XIXe siècle ne peuvent pas faire face à cette nouvelle demande d'étatisation que la politique nazie demandait. Pour que le système économique nazi fonctionne, il faut un sur-État, un supplément d'État, c'est-à-dire le thème du peuple, le principe d'obéissance au Führer, l'existence du parti. Ces trois choses sont bien plus des suppléments d'État, des institutions en voie d'étatisation, que la destruction de l'État bourgeois et capitaliste, comme le présentent faussement les nazis.
3. Cet invariant anti-libéral lié à la croissance de l'État a pour effet majeur une destruction de la communauté sociale
Les nazis ont fait une analyse de la société capitaliste, bourgeoise, utilitariste, individualiste (D'abord théorisée par Sombart, les nazis ont repris cette critique à leur compte) :
- Le capitalisme et la société bourgeoise ont produit la masse, c'est-à-dire des individus arrachés à leur communauté naturelle et rassemblés dans une forme plate et anonyme.
- Les individus sont privés de communication directe et immédiate les uns avec les autres, ils sont contraints à ne communiquer que par l'intermédiaire d'un appareil administratif et centralisé.
- Les individus sont réduits à l'état d'atomes, soumis à une autorité abstraite dans laquelle ils ne se reconnaissent pas.
- La consommation massive a des fonctions d'uniformisation et de normalisation.
- Les individus sont voués à ne communiquer entre eux que par le jeu des signes et des spectacles.
Mais les libéraux disent qu'en fait les nazis ne font qu'accentuer cette société de masse (masse de Nuremberg), cette société de consommation normalisante (l'idée de la Volkswagen), cette société de signes et de spectacles (le spectacle de Nuremberg). Donc tout ceci n'est que la reconduction, l'intensification de tous ces traits de la société capitaliste bourgeoise que les nazis dénonçaient, et contre laquelle ils prétendaient s'élever.
Ces éléments (société de masse, société de l'autorité abstraite, société de la consommation uniformisante, société du spectacle…) ne sont pas le produit de la société capitaliste bourgeoise, mais c'est au contraire le produit d'une société qui, économiquement, n'accepte pas ce libéralisme, et a choisi une politique protectionniste, une politique de planification, une politique où l'administration prend en charge l'existence quotidienne des individus. En somme, ces phénomènes sont liés à l'étatisme, à l'anti-libéralisme et non pas à une économie marchande.
Le nazisme comme point ultime du développement du capitalisme
Depuis le début du XXe siècle, le libéralisme a essayé de limiter ses propres conséquences par une technique d'intervention ayant comme principe une rationalité issue des sciences de la nature. Cette gestion étatique, les ordolibéraux l'appellent "l'éternel saint-simonisme". De Saint-Simon au nazisme, on trouve le cycle de rationalité suivant : rationalité → interventions → croissance de l'État → administration. Ce cycle est la genèse du nazisme à travers toute l'histoire du capitalisme depuis deux siècles. C'est à partir de cette analyse qu'est apparu le thème du nazisme comme point ultime du développement naturel du capitalisme, mais qu'est apparu aussi la possibilité de balayer dans une même critique l'Union soviétique et les USA, les camps de concentration nazis et les fiches de la Sécurité sociale.
Le marché doit surveiller l’État
Mais plus encore, puisque le nazisme montre que ce n'est pas à l'économie de marché qu'il faut attribuer les effets destructeurs, mais au contraire à l'État, il faut donc faire basculer entièrement les analyses. Et au lieu de se demander comment l'État doit limiter le marché libre pour en atténuer les effets nocifs, il faut raisonner autrement et se dire que rien ne prouve que l'économie de marché a des défauts. Car tous les défauts qu'on attribue à l'économie de marché, c'est à l'État qu'il faut les attribuer. Il faut donc demander à l'économie de marché, non pas d'être le principe de limitation de l'État, mais le principe de régulation interne de l'État. Donc au lieu d'un marché sous surveillance de l'État, un État sous surveillance du marché.
La liberté de marché doit réformer l’État
C'est dans ce retournement que les ordolibéraux ont pu, en 1948, essayer de résoudre le problème de l'Allemagne : comment légitimer un état qui n'existe pas et dont on se méfie ? C'est la liberté de marché qui peut fonder l'État, et qui en le contrôlant, donne à ceux qui se méfient de cet état, les garanties qu'il demandent.
C'est là que l'on peut situer ce qui est décisif dans le néolibéralisme actuel : le néolibéralisme actuel, ce n'est pas du tout la récurrence de vieilles formes d'économies libérales du XVIIIe et XIXe siècle. En fait, ce dont il est question, c'est de savoir si une économie de marché peut servir de principe, de forme et de modèle pour un État dont tout le monde se méfie. La question est donc de savoir si le marché peut effectivement réformer l'État et la société. C'est cela le problème capital du libéralisme actuel.
Les ordolibéraux ont opéré plusieurs transformations dans la doctrine libérale traditionnelle :
- De l'échange à la concurrence
L'échange, comme principe du marché dans le libéralisme classique, devient la concurrence dans le néolibéralisme. Dans le libéralisme classique, le marché est défini à partir de l'échange libre entre deux partenaires. C'est-à-dire que l'échange établit une équivalence entre deux valeurs. L'état, tout au plus, surveille que la liberté de ceux qui échangent soit respectée.
Or, pour les néolibéraux, l'essence même du marché est définie par la concurrence. L'essence du marché n'est donc pas l'équivalence, mais l'inégalité. Et le problème valeur/équivalence devient le problème concurrence/monopole. C'est la concurrence qui va créer les prix, et c'est les prix qui vont régler les choix.
Pour les néolibéraux, l'État ne doit pas intervenir dans la concurrence, ou uniquement pour empêcher certains phénomènes comme celui du monopole. Donc pour les libéraux du XVIIIe et du XIXe, les conséquences politiques de l'économie de marché, c'est le “laissez-faire”. - La concurrence comme principe de formalisation
Les ordolibéraux rompent avec cette tradition : ils ne veulent pas déduire du principe de concurrence le principe du laissez-faire, car c'est encore une "naïveté naturaliste". C'est considérer que le marché est une sorte de nature, quelque chose qui se produit spontanément et que l'État devrait respecter. C'est une naïveté naturaliste car la concurrence n'est absolument pas une donnée de nature. La concurrence, c'est une essence, un eidos (= intuition idéaliste et non pas intuition empirique). En d'autres mots, la concurrence est un principe de formalisation (la théorie de la concurrence parfaite n'est pas considérée par les libéraux comme une théorie positive, mais une théorie normative, un type idéal qu'il faut s'efforcer d'atteindre - F. Bilger, la pensée économique libérale, p.52). La concurrence est un jeu formel entre des inégalités, ce n'est pas un jeu naturel entre des individus.
La concurrence ne peut apparaître que sous un certain nombre de conditions artificiellement aménagées. La concurrence pure n'est donc pas une donnée primitive, elle ne peut être qu'un objectif qui suppose une politique indéfiniment active. La concurrence, c'est donc un objectif historique de l'art gouvernemental, ce n'est pas une donnée de nature à respecter. - Le gouvernement supervise le marché
La concurrence pure, qui est l'essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite par une gouvernementalité active. De sorte que le gouvernement doit accompagner de bout en bout l'économie de marché. L'économie de marché ne soustrait pas quelque chose au gouvernement comme dans la théorie libérale classique. Il faut gouverner pour le marché plutôt que gouverner à cause du marché. Le néolibéralisme abandonne le laissez-faire au profit d'une vigilance et d'une intervention permanente. C'est donc un renversement du libéralisme classique.
14 février 1979
Quand on parle du néolibéralisme on obtient généralement trois types de réponses :
- Économiquement, c'est la réactivation de vieilles théories économiques
- Sociologiquement, c'est l'instauration, dans la société, de rapports strictement marchands
- Politiquement, c'est une couverture pour une intervention généralisée et administrative de l'État
Ces trois types de réponses font apparaître le néolibéralisme comme étant toujours la même chose mais en pire :
- Le laissez-faire : c'est Adam Smith à peine réactivé.
- La société marchande et spectaculaire : c'est la société marchande dénoncée dans le livre 1 du capital par Marx.
- L'univers concentrationnaire et le goulag : c'est la généralisation du pouvoir d'État.
Ces trois types de critiques ne font que réactualiser le même type de critique depuis plus de 200 ans. Or, le néolibéralisme est quelque chose d'autre que le laissez-faire, la société marchande et le goulag maquillé.
Ceci apparaît clairement dans le "Colloque Walter Lippmann". Le problème du libéralisme du XVIIIe, début du XIXe, c'était de faire le partage entre les domaines où on pouvait intervenir et les domaines où on ne pouvait pas intervenir. Pour les néolibéraux, le problème est de savoir comment on doit intervenir, c'est le problème du style gouvernemental.
Pour repérer comment les néolibéraux définissent le style de l'action gouvernementale, prenons trois exemples : le monopole, l'action économique conforme, la politique sociale.
1. Le monopole
Dans la conception classique de l'économie, il est admis que laisser se développer la concurrence crée des monopoles, et que les monopoles limitent, voire annulent la concurrence. Il serait donc logique de dire qu'à terme, la concurrence en vienne à se supprimer elle-même.
Cette thèse implique donc que pour sauver la concurrence de ses propres effets, il faut intervenir sur les mécanismes économiques qui déterminent le phénomène monopolistique. Mais les néolibéraux vont démontrer que le phénomène de monopole ne fait pas partie de la logique économique de la concurrence. En d'autres mots, les néolibéraux disent que le monopole ne se forme pas spontanément dans le processus économique, le monopole n'est pas le produit d'une économie de la concurrence :
- Analyse historique :
Le monopole est un phénomène archaïque qui a pour principe l'intervention du gouvernement dans l'économie. S'il y a monopole, c'est parce que le gouvernement a accordé aux corporations des privilèges en échange de services financiers sous la forme de fiscalités dérivées ou masquées. En somme, la fiscalité a développé un pouvoir centralisé, entraînant lui-même la création de monopole. - Analyse politique :
L'économie nationale favorise la constitution de monopole : le morcellement du marché à l'échelle nationale crée de petites unités économiques et favorise ainsi la constitution de monopoles qui ne subsisteraient pas dans une économie mondiale. - Analyse économique :
Les néolibéraux admettent que dans le capitalisme, l'augmentation du capital fixe constitue un support favorisant la constitution de monopole. Cependant, ils montrent que la question du monopole n'est pas pertinente :- Cette tendance vers la concentration n'aboutit pas fatalement au monopole. Pour que se constitue un monopole, il faut l'appui de l'État.
- Les monopoles ne sont pas des phénomènes stables en eux-mêmes, car il y a trop de contingence dans le marché.
- Si un monopole veut conserver son pouvoir, il devra appliquer un prix proche du prix de la concurrence, c'est-à-dire qu'il fera comme s'il y avait concurrence et ne dérèglera donc pas le marché.
Ces analyses permettent aux néolibéraux de se libérer du problème du monopole. Il n'y a pas à intervenir dans le processus économique puisque la structure régulatrice de la concurrence ne se déréglera jamais. Mais il faut en revanche établir un cadre institutionnel anti-monopolistique pour empêcher que des processus externes (gens, pouvoirs publics) interviennent et créent des monopoles.
2. Les actions conformes
Le gouvernement libéral doit intervenir de deux façons :
- Par des actions régulatrices :
Le gouvernement doit intervenir sous la forme d'actions régulatrices sur les processus économiques, et plus précisément, non pas sur les mécanismes du marché, mais sur les conditions du marché. C'est-à-dire que le gouvernement doit repérer et intensifier les trois tendances fondamentales du marché :- Tendance à la réduction des coûts.
- Tendance à la réduction du profit de l'entreprise.
- Tendance ponctuelle à des augmentations de profits, soit par une réduction des prix, soit par une amélioration de la production.
- Donc :
- Les objectifs :
L'objectif premier est la stabilité des prix pour contrôler l'inflation. Le maintien du pouvoir d'achat et du plein emploi sont des objectifs secondaires. - Les instruments :
Politique du crédit, baisse modérée des impôts pour agir sur l'épargne ou l'investissement. Mais jamais d'instruments employés par la planification (fixation des prix, soutien à un secteur de marché, création systématique d'emploi, investissements publics).
- Les objectifs :
De plus, quel que soit le taux de chômage, le gouvernement ne doit pas intervenir directement comme si le plein emploi devait être un idéal politique et un principe économique. Ce qu'il faut sauver avant tout, c'est la stabilité des prix. (Le chômeur n'est pas une victime sociale, c'est un travailleur en transit entre une activité non rentable et une activité plus rentable).
- Par des actions ordonnatrices :
Ce sont des actions qui interviennent sur les conditions structurales du marché, ce que les ordolibéraux appellent "le cadre". Un texte de Eucken datant de 1952 permet de comprendre ce qu'est une politique de cadre. Le texte propose des interventions gouvernementales qui ne sont pas directement économiques, mais qui ont pour objectif d'intégrer l'agriculture à l'économie de marché :- Population : il faut diminuer la population agricole par des interventions qui permettront une migration.
- Technique : il faut intervenir au niveau du perfectionnement technique.
- Éducation : il faut intervenir sur la formation des agriculteurs.
- Régime juridique : modifier les lois sur l'héritage relatives au fermage et à la location des terres. Et d'une manière plus générale faire intervenir la législation dans l'agriculture.
- Disponibilité des sols : modifier l'allocation, l'étendue, la nature et l'exploitation des sols disponibles.
- Climat : il faut intervenir sur le climat.
L'idée est donc de modifier les bases matérielles, culturelles, techniques, juridiques, c'est-à-dire modifier le cadre. C'est donc une intervention gouvernementale discrète sur les processus économiques, mais une intervention massive sur les données sociales. C'est la reconstitution d'un ordre concurrentiel régulateur de l'économie.
3. Politique sociale
Dans une économie de bien-être, une politique sociale a comme objectif une répartition relativement équitable des biens consommables :
- La politique sociale est pensée comme un contrepoids aux processus économiques sauvages qui en eux-mêmes sont considérés comme induisant à terme des effets d'inégalité ou des effets destructeurs.
- La politique sociale doit avoir comme instrument majeur une socialisation de certains éléments de consommation, c'est-à-dire une consommation socialisée : consommation médicale, culturelle…
- La politique sociale pose comme principe que plus la croissance est forte, plus la politique sociale doit être active.
Les ordolibéraux ont contesté ces trois principes :
- La politique sociale ne peut pas être définie comme ce qui compensera les effets des processus économiques. Elle ne peut pas constituer un tel objectif dans un système qui fonctionne par un jeu de différenciation propre aux mécanismes de concurrence et non par des processus d'égalisation.
C'est pourquoi une politique sociale qui aurait pour objet premier l'égalisation, ne peut être qu'anti-économique. Donc les transferts sociaux de revenus (prendre aux riches pour donner aux pauvres) ne doivent même pas chercher à maintenir un pouvoir d'achat pour les plus pauvres, mais seulement leur assurer le minimum vital. - La société ne va pas garantir les individus contre les risques, elle va plutôt faire en sorte qu'ils aient des revenus assez élevés pour qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes contre les risques. Donc l'instrument de la politique sociale ne sera pas l'égalisation, mais la capitalisation pour toutes les classes sociales, l'assurance individuelle et la propriété privée.
C'est donc une individualisation par la politique sociale. On n'assure pas les individus contre les risques, mais on leur accorde un espace économique dans lequel ils peuvent affronter les risques. - Conclusion : la forme fondamentale de la politique sociale n'est donc pas de compenser la politique économique. La forme fondamentale de la politique sociale, c'est la croissance économique. C'est la croissance économique qui doit permettre l'augmentation des revenus, qui permettra à son tour l'assurance individuelle, la propriété privée et la capitalisation.
Deux points à retenir :
- C'est à partir du refus de cette politique sociale que s'est développé l'anarcho-capitalisme américain.
- Dans les pays qui s'ordonnent au néolibéralisme, cette politique sociale soutient que c'est à l'individu de se protéger contre les risques. C'est donc une politique sociale privatisée.
Ce qui forme l'armature du néolibéralisme :
- L'objet de l'action gouvernementale, c'est l'environnement social :
Le gouvernement n'a pas à intervenir sur les effets du marché, n'a pas à avoir des politiques de bien-être, il doit intervenir sur la société elle-même pour que les mécanismes concurrentiels jouent leur rôle régulateur. Ce n'est donc pas un gouvernement économique, c'est un gouvernement de société (un libéralisme sociologique ?).
Le principe régulateur de la société n'est donc pas l'échange des marchandises, mais le mécanisme de la concurrence. Il ne s'agit pas de discipliner la société à partir de la forme marchande, ce n'est donc pas un retour au modèle de la société de masse, mais une société soumise à la dynamique concurrentielle. Ce n'est pas une société de supermarché, mais une société d'entreprise. L'homo-economicus n'est pas l'homme de l'échange, l'homme consommateur, c'est l'homme de l'entreprise et de la production.
L'objectif ultime de l'action gouvernementale :- Permettre à chacun l'accès à la propriété privée
- Réduction des gigantismes urbains, développement des industries non-prolétariennes (artisanat, petit commerce).
- Reconstruction de la société à partir des communautés naturelles, des familles, des voisinages. décentralisation des lieux d'habitation et de production.
On peut entendre ce programme de rationalisation comme une espèce de retour rousseauiste à la nature, une politique de la vie. L'objet de cette politique de la vie n'est pas de mettre l'individu en contact direct avec la nature, mais de constituer une trame sociale dans laquelle les unités de base auraient la forme de l'entreprise (la propriété privée est une entreprise, une maison individuelle est une entreprise).
En somme, ce sont le marché, la concurrence et l'entreprise qui sont censés donner forme à la société. Donc les critiques se trompent quand elles pensent que l'objectif actuel de la politique gouvernementale est une société uniformiste, une société de masse, de consommation, de spectacle. Nous n'en sommes plus là. L'objectif actuel de la politique gouvernementale, c'est d'obtenir une société indexée, non pas sur la marchandise et sur l'uniformité de la marchandise, mais sur la multiplicité et la différenciation des entreprises.
- Une société d’entreprise implique une société judiciaire :
Cet art libéral de gouverner entraîne une modification profonde de l'institution juridique. Effectivement, plus vous multipliez les entreprises, plus vous multipliez les occasions de contentieux, et plus vous multipliez la nécessité d'un arbitrage juridique. Donc une société d'entreprise implique une société judiciaire, c'est-à-dire encadrée par une multiplicité d'institutions judiciaires.
21 février 1979
Au cours précédent, nous avons vu que les ordolibéraux ont insisté sur deux points :
- La formalisation de la société sur le modèle de l'entreprise.
- La nécessité de redéfinir l'institution juridique dans une société régulée à partir de l'économie concurrentielle de marché.
C'est ce deuxième point dont nous allons parler aujourd'hui : le problème du droit.
Présentation du colloque Walter Lippmann
Voilà en résumé ce que dit Louis Rougier en présentant le colloque Walter Lippmann en 1939 : “Il n'y a aucune raison de penser que les institutions actuelles soient le plus à même de protéger la liberté des transactions. Être libéral ce n'est donc pas être conservateur et maintenir des privilèges résultants de la législation passée. C'est au contraire être essentiellement progressiste, car il faut perpétuellement adapter l'ordre légal aux découvertes, aux progrès et aux exigences de la conscience contemporaine.
Être libéral, ce n'est pas comme le "manchestérien" laisser les voitures circuler dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Ce n'est pas, comme le "planiste", fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire : c'est imposer un "code de la route", tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu'au temps des diligences. Nous saisissons aujourd'hui mieux que les grands classiques en quoi consiste une économie vraiment libérale.
L'économie libérale est soumise à un double arbitrage : l'arbitrage spontané des consommateurs, et l'arbitrage réfléchi de l'État qui assure la liberté des marchés et leur efficience”.
Dans ce texte de Louis Rougier, on trouve un certain nombre d'éléments. Pour les ordolibéraux, ce n'est pas l'économie qui détermine un ordre juridique. Il faut parler d'un ordre économico-juridique, c'est-à-dire que l'économique est un ensemble d'activités réglées = le système. Le système, c'est un ensemble de processus économiques qui ont été rendus possible par un cadre institutionnel.
Historiquement, les processus économiques et le cadre institutionnel se sont appelés et modifiés l'un l'autre. Le capitalisme n'a pas été un processus d'en dessous qui a bousculé les anciens droits. L'histoire du capitalisme ne peut être qu'une histoire économico-institutionnelle. Cette analyse du capitalisme, et du rôle qu'a pu y jouer l'institution juridique, est un enjeu politique. Cet enjeu, c'est le problème de la survie du capitalisme.
Effectivement, si on réduit dans une perspective marxiste l'histoire du capitalisme à la logique économique du capital, il n'y a alors qu'un capitalisme puisqu'il n'y a qu'une logique du capital. Et par conséquent, les impasses actuelles du capitalisme sont des impasses historiquement définitives. En somme, s'il n'y a qu'un seul capitalisme, il n'y a bientôt plus de capitalisme du tout. Mais si au contraire "le capital" n'est qu’un processus à l'intérieur d'un capitalisme économico-institutionnel, alors le capitalisme historique que nous connaissons n'est pas la seule figure possible de la logique du capital. En d'autres mots, en inventant un nouveau fonctionnement institutionnel on peut obtenir d'autres types de capitalismes et dépasser des effets, des contradictions, des impasses caractéristiques de la société capitaliste, effets qui ne sont pas dus à la logique du capitalisme, mais qui sont dus à une figure économico-juridique défaillante.
On a donc deux grands problèmes qui ont dominé la théorie économique et l'histoire économique. Deux questions à résoudre pour savoir si le capitalisme pouvait ou non survivre :
- Domaine de la théorie économique
Il fallait se pencher sur la théorie de la concurrence et déterminer si la concurrence était ou n'était pas contradictoire, et si le marché concurrentiel était susceptible de s'annuler par des phénomènes de monopole. - Domaine de l’histoire économique
Il s'agit de savoir si on peut repérer dans l'histoire du capitalisme un ensemble économico-institutionnel qui rend compte de la singularité du capitalisme et des impasses que l'on constate maintenant.
Si on admet donc que le capitalisme auquel nous avons affaire est constitué par un ensemble économico-institutionnel, il est alors possible d'intervenir sur cet ensemble pour inventer un nouveau capitalisme.
Cette transformation du capitalisme ne peut donc pas intervenir sur les lois du marché, puisque la théorie économique montre que les mécanismes du marché régulent l'économie générale. Par conséquent, il faut agir sur les institutions afin qu'elles permettent au marché de jouer librement. Donc un minimum d'interventions économiques et un maximum d'interventions juridiques. Il faut, dit Eucken, "passer à un droit économique conscient" :
- Conscient de l'analyse historique qui montre comment l'institution et l'économie se conditionnent réciproquement.
- Conscient des modifications à introduire dans ce complexe économico-juridique.
L’État de droit
Pour arriver à l'ordre de l'économie, il faut appliquer à l'économie "l'État de droit" (= le règne de la loi). La notion d'État de droit apparaît dans la théorie politique à la fin du XVIIIe, début du XIXe. L'État de droit se définit à cette époque par opposition à deux choses :
- Par opposition au despotisme : Dans le despotisme, la volonté du souverain est le principe de l'obligation de chacun à l'égard de la puissance publique.
- Par opposition à l'état de police : L'état de police est un gouvernement entièrement administratif et une administration qui est toute puissante. C'est-à-dire que l'autorité administrative peut, avec une liberté totale, appliquer aux citoyens toutes les mesures qu'elle juge utile en vue des fins poursuivies. En d'autres mots, dans l'état de police, la fin justifie les moyens.
En rapport à ces deux types de gouvernements, l'État de droit va représenter l'alternative positive :
- La loi est le principe de la puissance publique : la puissance publique ne peut agir que dans le cadre de la loi.
- Distinction entre les mesures légales et les mesures administratives : il y a une différence de nature entre les lois qui sont souveraines, et les décisions particulières de la puissance publique.
C'est à partir de ces deux aspects de l'État de droit que les libéraux vont se demander comment rénover le capitalisme. L'idée est donc d'introduire les principes de l'État de droit dans la législation économique pour obtenir un État de droit économique.
Appliquer le principe de l'État de droit dans l'économie, cela veut dire que la législation économique ne pourra être que formelle. Ce qui est formel, c'est ce qui est énoncé de façon déterminée, et sans équivoque. Donc l'État de droit ou encore une législation économique formelle, c'est le contraire d'un plan, le contraire de la planification. Effectivement, qu'est-ce qu'un plan ?
- Un plan économique a une finalité (croissance, réduction des inégalités…)
- Un plan, c'est la possibilité d'introduire à tout moment des corrections si l'effet désiré n'est pas atteint.
- Dans un plan, la puissance publique a le rôle de décideur sur l'ensemble des processus économiques.
- Dans un plan, on suppose que la puissance publique a une conscience claire de l'ensemble des processus économiques.
Or, dit Hayek, l'État de droit doit être tout le contraire. Les mesures doivent rester formelles, c'est-à-dire qu'elles ne doivent jamais se proposer une fin particulière (exemple : vouloir faire baisser l'écart des revenus). Une loi dans l'ordre économique doit rester formelle :
- Elle doit dire aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire.
- Elle doit être conçue a priori sous forme de règles fixes non corrigibles.
- Elle doit définir un cadre stable permettant aux agents économiques de prendre des décisions en toute liberté.
- Elle doit lier l'État, autant que les autres, à la loi. Par conséquent, chacun saura comment l'État se comportera.
- Elle rend impossible qu'il y ait un sujet universel de savoir économique qui dominerait l'ensemble des processus.
En somme, l'État doit être aveugle aux processus économiques. L'économie est un jeu dont personne ne connaît l'issue, et qui donne les mêmes règles à chacun. Il faut penser l'économie comme un jeu, et les institutions juridiques qui encadrent l'économie comme les règles du jeu. Donc l'État de droit c'est une règle de jeu économique et non pas un contrôle économico-social voulu. En d'autres mots, l'État de droit consiste à tracer un cadre rationnel à l'intérieur duquel les individus se livreront à leurs activités personnelles.
"Dans l'État de droit, le gouvernement se borne à fixer les conditions dans lesquelles les ressources existantes peuvent être employées. C'est aux individus de décider à quelle fin ils veulent les employer. Dans le planisme centralisé, c'est le gouvernement qui ordonne l'emploi des moyens de production à des fins déterminées" (Hayek "Road of Serfdom").
Loi et ordre
L'État n'intervient dans l'ordre économique que sous la forme de la loi, et c'est grâce à cette loi que va pouvoir apparaître un ordre économique qui s'auto-régule.
Donc pour résumer :
- Il n'y a pas "le" capitalisme avec sa logique et ses impasses, il y a "un" capitalisme économico-institutionnel, économico-juridique.
- Il est possible d'imaginer un autre capitalisme, qui aurait pour principe une réorganisation du cadre institutionnel en fonction du principe de l'État de droit, et qui balaierait l'interventionnisme que les États se sont donné le droit d'imposer dans l'économie protectionniste du XIXe et l'économie planifiée du XXe.
Croissance de la demande judiciaire
Et enfin, troisième aspect du texte de Rougier, la croissance de la demande judiciaire : dans cette société libérale, le vrai sujet économique c'est l'entreprise, c'est-à-dire une certaine manière de se comporter (concurrence, objectif, tactique…). Or, multiplier les entreprises entraîne une multiplication des frictions, et ces frictions entraînent un interventionnisme judiciaire sous la forme d'instances d'arbitrage. En somme, plus la loi devient formelle, plus l'intervention judiciaire se multiplie.
L'ordolibéralisme projette donc une économie de marché concurrentielle et un interventionnisme social. Et c'est cet interventionnisme social qui implique une rénovation institutionnelle afin de revaloriser l'unité "entreprise" comme agent économique fondamental. On voit donc naître un nouvel art de gouverner.
Condamnation historique du capitalisme
Pour les ordolibéraux, il n'y a pas de contradiction interne dans la logique du capital, et donc d'un point de vue économique le capitalisme est parfaitement viable. Mais à partir de cette analyse, Schumpeter émet une nouvelle critique qui est une sorte de condamnation historico-politique du capitalisme : Pour Schumpeter, historiquement, le capitalisme ne peut pas se dissocier de tendances monopolistiques car le processus de concurrence entraîne une organisation de plus en plus monopolistique. C'est un phénomène social qui provoque une tendance à la centralisation étatique. (C'est une condamnation en termes de fatalité historique, et non pas en termes de contradiction du capitalisme). Cette sorte de passage au socialisme est inévitable (définition du socialisme par Schumpeter : système dans lequel une autorité centrale va pouvoir contrôler les moyens de production et la production elle-même). Ce passage au socialisme aura un coût politique car il faudra surveiller étroitement la structure politique pour éviter le totalitarisme. Cette surveillance pourra tout au mieux adoucir les effets du totalitarisme, mais cette perte de liberté sera somme toute inévitable. Donc condamnation historique du capitalisme.
Réponse à la condamnation historique du capitalisme
Les ordolibéraux répondent à cette critique : ce coût politique, cette perte de liberté, n'est pas acceptable contrairement à ce que dit Schumpeter. En fait, une économie planifiée se paye nécessairement au prix d'une perte de liberté, et aucune correction ne pourra corriger cela. Cette perte de liberté est inévitable car la planification comporte des erreurs économiques fondamentales. Et le rattrapage de ces erreurs ne peut être obtenu que par la suppression des libertés fondamentales.
Ainsi, pour éviter cette erreur de la planification, il faut corriger cette tendance à la centralisation mise en lumière par Schumpeter. Cette tendance à la centralisation est le produit des conséquences sociales du processus économique, et il faut justement la corriger par une intervention sociale.
C'est précisément l'État de droit qui sera censé protéger le cadre institutionnel de l'économie. C'est l'État de droit qui va permettre d'empêcher les tendances centralisatrices qui sont effectivement immanentes à la société capitaliste et non à la logique du capital. C'est donc l'État de droit qui peut protéger la pureté de la logique du capital et faire fonctionner un marché concurrentiel. C'est l'État de droit qui peut empêcher ces phénomènes de monopole, de centralisation, qu'on a vus dans la société moderne.
Il faut donc un formalisme dans le champ institutionnel et une économie réglée sur la concurrence pure. C'est selon les ordolibéraux, la seule façon pour que le libéralisme puisse fonctionner.
7 mars 1979
Si j'ai parlé aussi longuement du néolibéralisme, c'était pour plusieurs raisons :
1. Des raisons de méthode
Poursuivre le cours de l'an dernier, et donner un contenu concret à l'analyse des relations de pouvoir (le pouvoir n'est pas un principe en soi, ni une valeur explicative fonctionnant d'entrée de jeu). Le terme de pouvoir désigne un domaine de relations. En étudiant la gouvernementalité, c'est-à-dire la manière dont on conduit la conduite des hommes, je n'ai fait que proposer une grille d'analyse pour ces relations de pouvoir.
Je voulais voir si cette grille de la gouvernementalité valable pour l'analyse de micro pouvoir (la conduite des fous, des malades, des délinquants, des enfants), était également valable pour l'analyse d'une politique économique de tout un corps social.
2. Des raisons de moralité critique
La récurrence de ces thèmes laisse penser à une phobie d'État. Dans toute cette thématique de la critique de l'État il y a deux éléments importants :
- L'idée que l'État possède en lui-même une sorte de puissance d'expansion, une tendance intrinsèque à croître, si bien qu'il finirait par prendre totalement en charge son extérieur, sa cible, son objet : la société civile.
- Les différentes formes d'État (État administratif, Providence, bureaucratique, fasciste, totalitaire) s'engendrent les unes les autres à partir d'un tronc commun : l'étatisme.
Or, ces deux idées sont une espèce de lieu commun critique qu'on pourrait dire inflationniste. Effectivement, c'est une critique inflationniste car :
- Interchangeabilité des analyses :
Admettre qu'il y a une continuité entre les différentes formes d'État rend possible d'appuyer les analyses les unes sur les autres, et fait perdre à chacune sa spécificité.
(Exemple : en quelques glissements, on peut passer d'une analyse de la Sécurité sociale et de son appareil administratif, à l'analyse des camps de concentration) - Disqualification par le pire :
Ces analyses permettent de pratiquer une disqualification générale par le pire, car quel que soit l'objet de l'analyse, on peut toujours le renvoyer au pire. Donc cette critique rend possible la disqualification du meilleur par le pire. - Réduction de l'actualité :
Ces analyses permettent d'éviter qu'on paie le prix du réel et de l'actuel. Elles opèrent une réduction de l'actualité, car au nom de ce dynamisme d'État on peut toujours retrouver le grand fantasme de l'État dévorateur. Bref, quand on soupçonne un profil fantasmatique de l'État, toute analyse de l'actualité devient inutile.
Enfin, c'est une critique inflationniste car elle n'opère pas sa propre critique. En d'autres mots, c'est une critique qui ne cherche pas à savoir d'où vient cette phobie d'État qui circule actuellement dans beaucoup de formes de pensées.
Or, cette critique de l'État comme ayant une dynamique propre qui le pousse à ne jamais s'arrêter dans son amplification et dans sa prise en charge de la société civile tout entière, on la trouve parfaitement formulée dans les pensées néolibérales des années 1930 - 1945. Cette critique de l'État visait à se démarquer de la critique keynésienne, à critiquer les politiques interventionnistes (New Deal, Front populaire), à critiquer l'économie nazi, l'Union soviétique et le socialisme.
Il y a plusieurs thèses contre cette critique inflationniste de l'État :
1. La thèse que l'État-providence n'a pas la même origine que l'État totalitaire
En fait, l'État dit totalitaire n'est pas l'exaltation de l'État, mais au contraire l'amoindrissement de l'autonomie de l'État par rapport au "parti". Le régime totalitaire ce n'est pas la continuité de l'État administratif, de l'État policier. Le principe des régimes totalitaires se trouve dans une gouvernementalité non étatique, dans une gouvernementalité de parti. La gouvernementalité de parti est à l'origine historique des régimes totalitaires (nazisme, fascisme, stalinisme).
2. La thèse que la décroissance de l'État résulte de la croissance d'autre chose
On analyse actuellement la décroissance de la gouvernementalité d'État de deux façons :
- Par la croissance de la gouvernementalité de parti
- Par la croissance de la gouvernementalité libérale
Il ne faut pas s'imaginer qu'on décrit un processus réel, actuel, et nous concernant, quand on dénonce l'étatisation ou la fascisation. Tous ceux qui participent à la grande phobie d'État vont dans le sens du vent, car depuis des années on parle d'une décroissance de l'État et de l'étatisation.
La fascisation n'est pas le produit d'une croissance de l'État, mais au contraire d'une décroissance de la gouvernementalité d'État remplacée par une gouvernementalité de parti.
Il y a un processus historique qui rend actuellement l'État intolérable et problématique. Et c'est pour ça que je voulais étudier le modèle néolibéral allemand, car il fait partie de notre actualité et la structure.
La diffusion du modèle néolibéral allemand en France
Cette diffusion s'est faite d'une façon lente et hypocrite avec trois caractères :
- Elle s'est faite à partir d'une gouvernementalité fortement étatisée, dirigiste et administrative.
- Elle s'est faite dans un contexte de crise économique qui a été à la fois la raison et le frein de son introduction.
- Ceux qui ont mis en œuvre ce modèle allemand sont en même temps les gestionnaires de l'État dans ce contexte de crise.
La diffusion du modèle néolibéral allemand aux États-Unis
- La diffusion du modèle allemand aux États-Unis est plus flou car la politique libérale a été une constante aux États-Unis. Mais il y a cependant de nombreuses relations entre le modèle allemand et le modèle américain.
- Le modèle allemand se développe aux États-Unis aussi dans un contexte de crise économique mais moins aiguë qu'en France. En revanche, il se développe à l'intérieur d'une crise politique où les problèmes de l'influence, de l'intervention et de la crédibilité du gouvernement fédéral se trouvaient posés depuis déjà longtemps.
- Ce néolibéralisme allemand au lieu d'être la propriété exclusive des membres du gouvernement, comme c'est le cas en France, se présente en partie comme une sorte de grande alternative économico-politique qui prend la forme de tout un mouvement d'opposition politique à l'intérieur de la population.
Cela rend la diffusion du modèle allemand radicalement différente en France et aux États-Unis. Il faut donc traiter les deux phénomènes indépendamment.
Le néolibéralisme en France et l'existence du modèle allemand
À la suite de la grande crise des années 1930 tous les gouvernements devaient prendre en considération ces éléments économiques : le plein emploi, la stabilité des prix, la balance des paiements, la croissance du PIB, la redistribution des revenus et des richesses, la fourniture des biens sociaux.
La formule allemande néolibérale se donnait comme objectifs premiers la stabilité des prix et la balance des paiements, tandis que tous les autres éléments venaient en conséquence de ces deux premiers objectifs.
Les français se sont au contraire donnés comme objectifs premiers : le plein emploi (≠ la stabilité des prix) et la fourniture des biens sociaux (≠ la balance des paiements). Cela impliquait une croissance volontariste, forte et maintenue pour que les autres objectifs (stabilité des prix et balance des paiements) soient assurés.
Dans les années 1970-1975, sous l'effet de la crise économique, la France se demande comment passer à une économie néolibérale, comment insérer le modèle allemand, c'est-à-dire comment effectuer l'intégration totale de l'économie française à une économie de marché intérieure, européenne et mondiale.
Or, ce qui est en question maintenant, en 1979, ce n'est pas simplement un peu plus de libéralisme contre un peu moins de dirigisme, mais c'est une politique qui serait globalement néolibérale. Je voudrais analyser cette politique sous l'aspect de la politique sociale dans le gouvernement actuel (1979). Pour dire deux mots d'histoire, la politique sociale définie au lendemain de la Libération avait pour origine deux problèmes :
- Le maintien du plein emploi comme objectif économique et objectif social prioritaire.
- Éviter les effets d'une dévaluation rendue nécessaire par une politique de croissance.
Les techniques pour arriver à ces deux objectifs c'était le modèle de guerre, c'est-à-dire le modèle de la solidarité nationale : on ne demande pas aux gens la raison de leur détresse financière, ni à quelle catégorie économique ils appartiennent.
C'est ce modèle qui explique que les politiques sociales anglaises et françaises ont été des politiques de consommation collectives, et de redistribution permanente des revenus.
Mais la question qui se pose, c'est de savoir si une politique qui se présente comme une politique sociale, ne va pas être en même temps une politique économique. Est-ce que la politique sociale ne va pas entraîner toute une série d'effets économiques qui risquent de dérégler le système économique et le système social lui-même ? À cette question, des réponses contraires ont été données.
Sur la Sécurité sociale
Mais trente ans plus tard, en 1976, des élèves de l'ENA font un rapport sur trente ans de Sécurité sociale et constatent les faits suivants :
- La Sécurité sociale a des incidences économiques considérables sur le coût du travail. Le travail étant plus coûteux, il y a moins d'embauches donc une augmentation du chômage.
La Sécurité sociale a également des incidences sur la concurrence internationale puisque les pays ont des régimes différents de sécurité. Plus un pays a une couverture sociale complète, plus sa main d'œuvre est chère. Donc là aussi, facteur de chômage.
Et enfin, l'élévation du coût du travail va accélérer les concentrations industrielles, le développement de monopoles et de multinationales. - Le plafonnement des cotisations introduit des effets sur la distribution des revenus. Les revenus profitent aux plus riches au détriment des plus pauvres.
La Sécurité sociale a donc introduit des effets économiques. Or, selon les ordolibéraux allemands, la Sécurité sociale doit rester économiquement neutre.
Cette idée d'une politique sociale neutre du point de vue économique se trouve déjà au commencement du néolibéralisme en France. En 1972, Giscard d'Estaing, le ministre des Finances, dit que les fonctions économiques de tout État moderne sont :
- Redistribution : redistribution relative des revenus (l'État transfère des plus riches aux plus pauvres).
- Allocation : allocation sous forme de production de biens collectifs (l'État produit des biens collectifs : éducation, santé, autoroute).
- Régulation : régulation des processus économiques, assurant la croissance et le plein emploi (l'État régularise et soutient la croissance et le plein emploi par sa politique conjoncturelle).
On retrouve les objectifs traditionnels de la politique économique française, qui à cette époque-là ne pouvaient pas être remis en question. Mais ce qui est remis en question, c'est le lien entre ces trois fonctions économiques de l'État. Dans une politique saine, on ne devrait pas mélanger économique et social : il faudrait un impôt économique et un impôt social. On retrouve ici l'idée que les mécanismes sociaux doivent avoir une limitation afin de ne jamais intervenir dans le processus économique.
La question est alors de savoir comment opérer ce décrochage. Pour cela, Giscard d’Estaing fait appel à un principe du néolibéralisme : l'économie se développe comme un jeu entre des partenaires, et l'État a pour fonction essentielle de définir ces règles de jeu économiques. Le jeu doit être le plus actif possible et profiter par conséquent au plus de gens possible. Il y a simplement une règle supplémentaire : il doit être impossible que l'un des partenaires du jeu économique perde tout et ne puisse plus continuer à jouer. Donc en quelque sorte une clause de sauvegarde du joueur, sorte de contrat social à l'envers.
Dans le contrat social, font partie de la société ceux qui le veulent. Mais dans l'idée d'un jeu économique personne n'a tenu à faire partie originairement de ce jeu. C'est alors à la société de faire que personne ne soit exclu de ce jeu. Le seul point de contact entre l'économie et le social, c'est donc la règle de sauvegarde qui fait qu'aucun joueur ne sera exclu.
L’impôt négatif
C'est dans la continuité de ce principe que s'inscrit l'impôt négatif (ce n'est pas un impôt que l'on paye, c'est un impôt que l'on reçoit : type RSA). L'impôt négatif est une idée du néolibéralisme américain. C'est l'idée que pour qu'une prestation sociale soit efficace socialement sans être perturbatrice économiquement, elle ne doit jamais se présenter sous forme de consommation collective. Car, disent les défenseurs de l'impôt négatif, les consommations collectives profitent finalement aux plus riches puisqu'ils participent le moins à leur financement. L'idée est alors de substituer aux allocations globales, une allocation qui assurerait des ressources supplémentaires à ceux qui n'atteignent pas le seuil de consommation jugé décent par la société.
On abandonne ici l'idée que la société doit à chacun de ses membres les mêmes services, comme la santé ou l'éducation. Et c'est surtout la réintroduction d'une distorsion entre les pauvres et les riches, les assistés et les non-assistés.
Je voudrais faire plusieurs remarques à propos de cet impôt négatif :
- L'impôt négatif vise à atténuer les effets de la pauvreté et non ses causes.
- Pour les uns, l'aide sociale doit être motivée par les causes de la pauvreté. Dans cette perspective traditionnelle on se demande pourquoi la personne a besoin d'une assistance et on cherche par conséquent à modifier les raisons pour lesquelles elle en a besoin.
- Pour les tenants de l'impôt négatif, l'aide sociale ne doit être motivée que par les effets de la pauvreté. Peu importe cette fameuse distinction entre les bons pauvres et les mauvais pauvres. On se moque de savoir pourquoi quelqu'un tombe au-dessous du niveau du jeu social. Qu'il soit drogué, chômeur volontaire, on s'en moque éperdument. La seule chose importante, c'est que l'individu soit tombé en dessous d'un certain niveau, et le problème est de lui accorder une subvention, tel que le mécanisme par lequel on la lui accorde l'incite encore à repasser au niveau du seuil. Mais s'il n'en a pas envie ça n'a aucune importance, il restera assisté.
"L'impôt négatif est totalement incompatible avec les conceptions sociales qui veulent savoir pourquoi il y a pauvreté avant d'y venir en aide. Accepter l'impôt négatif, c'est donc accepter une conception universaliste de la pauvreté fondée sur la nécessité de venir en aide à ceux qui sont pauvres sans chercher à savoir à qui en revient la faute, c'est-à-dire fondée sur la situation et non sur l'origine" (Stoléru "Vaincre la pauvreté") - Cet impôt négatif est une manière d'éviter tout ce qui pourrait avoir des effets de redistribution générale des revenus. Si on appelle politique socialiste une politique qui tend à modifier les écarts entre les différents revenus, alors l'impôt négatif est le contraire même d'une politique socialiste. Le seul problème, c'est la pauvreté "absolue", c'est-à-dire le seuil de consommation jugé décent.
"La frontière entre pauvreté absolue et pauvreté relative, c'est celle entre capitalisme et socialisme" (Stoléru "Vaincre la pauvreté")
Il faut faire deux remarques sur le terme pauvreté absolue :- Chaque société a un seuil différent de pauvreté absolue.
- Avec ce terme on réintroduit cette catégorie du pauvre et de la pauvreté, que toutes les politiques sociales, toutes les politiques de bien-être, depuis la fin du XIXe siècle avaient essayé de faire disparaître. Toutes ces politiques voulaient ne pas connaître la catégorie du pauvre. C'était dans l'éventail de la pauvreté relative, dans le jeu d'écart entre les plus riches et les plus pauvres que se situait la politique. Là, on a une politique qui va définir un certain seuil absolu pour la société, qui va partager les pauvres et les non pauvres, les assistés et les non-assistés.
- L'impôt négatif assure une sécurité générale, mais par le bas. Au-dessus du seuil chacun devra être en quelque sorte une entreprise. Mais on va avoir, du côté du plancher économique, une population en perpétuelle mobilité. Donc, pour une société qui a renoncé à l'objectif du plein emploi, cette population sera utilisable si les besoins économiques le nécessitent ou sera renvoyée à son statut d'assisté si besoin.
Avec ce système-là, on a la constitution d'une politique économique qui n'est plus centrée sur le plein emploi. Mais cela implique un fond de population flottante dans lequel des mécanismes d'assurance permettront à chacun de subsister en attendant de trouver un emploi si les conditions de marché l'exigent.
La population assistée
Le capitalisme du XIXe s'est développé avec une population paysanne qui était un réservoir de main d'œuvre. Dès lors que cette population paysanne ne peut plus assurer ce réservoir, l'économie constitue ce réservoir sur un tout autre mode : la population assistée. La population est assistée sur un mode libéral, c'est-à-dire moins bureaucratique et disciplinaire que dans un système centré sur le plein emploi et qui mettrait en œuvre des mécanismes comme ceux de la Sécurité sociale. Dans le système libéral, on laisse finalement aux gens la possibilité de travailler s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, et on se donne surtout la possibilité de ne pas les faire travailler, si on n’a pas intérêt à les faire travailler.
Or, ce projet est la radicalisation des thèmes généraux de l'ordolibéralisme allemand : l'objectif principal d'une politique sociale n'est pas d'assurer tout ce qui peut arriver à la population, mais c'est sans rien toucher au jeu économique et en laissant par conséquent la société se développer comme une société d'entreprise, mettre en place un certain nombre de mécanismes d'intervention pour assister ceux qui en ont besoin au moment seulement où ils en ont besoin.
14 mars 1979
Le néolibéralisme américain
Trois éléments de contexte du développement du néolibéralisme américain :
- L'existence du New Deal, et la critique du New Deal à partir de 1933, donc critique de la politique keynésienne.
Premier texte du néolibéralisme américain écrit en 1934 par Simons, père de l'école de Chicago "un programme positif pour le laissez-faire". - Le plan Beveridge : un pacte social dans lequel on promettait, à ceux-là même à qui on demandait de faire la guerre, une organisation économique et sociale qui assurerait leur sécurité. Donc un pacte de sécurité au moment où il y avait demande de guerre (Simons a écrit des articles contre ces programmes sociaux).
- La croissance, depuis 1945, de l'administration fédérale à travers les programmes économiques et sociaux (programmes sur la pauvreté, l'éducation, la ségrégation). En d'autres mots, l'interventionnisme d'État.
C'est tout cela qui a constitué l'adversaire de la pensée néolibérale. Ce contexte est similaire au néolibéralisme en France qui s'est défini par opposition au Front populaire (coalition des partis de gauche qui exerçait le pouvoir en France de juin 1936 à avril 1938. Sous la présidence de Léon Blum, ce gouvernement imposa des réformes sociales : semaine de 40 heures, congés payés, nationalisation des chemins de fer…), aux politiques keynésiennes de l'après-guerre, et à la planification.
Il y a cependant un certain nombre de différences massives :
- Dès ses débuts au XVIIIe siècle, le libéralisme américain n'a pas été un principe modérateur de la raison d'État comme ce le fut en France, mais il a été le principe fondateur de l'État.
- Aux Etats-Unis, le libéralisme a été au centre de toutes les discussions politiques du XIXe, tandis qu'en Europe c'était l'unité de la nation, son indépendance ou bien l'État de droit qui étaient au centre des débats.
- Au milieu du XXe siècle, les politiques interventionnistes sont apparues comme une menace par leurs objectifs sociaux, impérialistes et militaires, entraînant leurs critiques aussi bien à droite qu'à gauche. À droite au nom d'une tradition libérale hostile au socialisme, à gauche au nom de la lutte contre le développement d'un État impérialiste et militaire. On trouve donc le néolibéralisme mis en œuvre à droite et à gauche.
Les Français veulent défendre le service public, les Américains veulent défendre leurs libertés. Aux États-Unis, le libéralisme n'est pas une alternative politique comme ça l'est en France, mais c'est une revendication globale, un foyer utopique.
Hayek fait remarquer que le socialisme doit beaucoup de son dynamisme à ses utopies. Et il propose de créer des utopies libérales, afin que le libéralisme ne soit pas seulement une alternative technique de gouvernement, mais bien plus un style général de pensée, d'analyse et d'imagination.
La conception néolibérale américaine :
La théorie du capital humain
L'économie politique classique a toujours indiqué que la production de biens dépendait de trois facteurs : la terre, le capital, le travail. Or, les néolibéraux soulignent que le travail est toujours resté inexploré.
Les néolibéraux ne discutent jamais avec Marx peut-être pour des raisons de snobisme économique. Marx a critiqué la logique du capitalisme en montrant qu'elle rend le travail "abstrait" : le travail concret transformé en force de travail sur le marché et rétribué comme salaire, ce n'est pas le travail concret, c'est un travail amputé de toute sa réalité humaine. Et Marx montre que la mécanique économique du capitalisme ne retient du travail que la force et le temps. Le capitalisme fait du travail un produit marchand et n'en retient que les effets de valeur produite.
Or, pour Marx, cette "abstraction" est la faute du capitalisme lui-même, alors que pour les néolibéraux, cette abstraction du travail n'est pas le fait du capitalisme réel mais vient de la manière dont on a pensé la production capitaliste dans l'économie classique. Et c'est justement parce que l'économie classique n'a pas pu produire cette analyse du travail que Marx a pu produire ses analyses.
Avec cette critique que les néolibéraux font de l'abstraction du travail dans le discours économique, s'opère une mutation épistémologique essentielle dans les analyses néolibérales. Les néolibéraux prétendent changer ce qui avait constitué le champ de référence général de l'analyse économique.
La théorie classique de l'économie, d'Adam Smith jusqu'au début du XXe siècle, faisait l'analyse des mécanismes relationnels entre des choses ou des processus (capital, investissement, production). Et dans ces analyses, le travail se trouvait inséré seulement à titre de rouage. Or, l'analyse néolibérale va soutenir que l'économie doit produire l'analyse des comportements humains. L'analyse doit dégager quel a été le calcul qui a fait qu'étant donné des ressources rares, un individu a décidé de les affecter à telle fin plutôt qu'à telle autre.
L'économie n'est plus l'analyse des processus, c'est l'analyse d'une activité, l'analyse de la rationalité interne, l'analyse de la programmation stratégique de l'activité des individus. Du coup, faire l'analyse économique du travail, ça ne consiste pas à se demander combien le travail s'achète, ou quelle valeur le travail ajoute. Le problème fondamental sera de savoir comment celui qui travaille utilise les ressources dont il dispose. Il va ainsi falloir étudier le travail comme conduite économique calculée par celui même qui travaille. C'est-à-dire faire pour la première fois que le travailleur soit dans l'analyse économique non pas un objet, l'objet d'une offre et d'une demande sous la forme de force de travail, mais un sujet économique actif.
Nouvelle théorie néolibérale du travail
Les gens travaillent pour un salaire, et du point de vue du travailleur, le salaire ce n'est pas le prix de vente de sa force de travail, c'est un revenu. Or un revenu, c'est le produit d'un capital, et inversement, le capital c'est ce qui peut être source de revenus futurs. Le salaire est donc le revenu d'un capital. Et ce capital qui fournit un salaire, c'est l'ensemble de tous les facteurs physiques et psychologiques du travailleur. Ainsi, du côté du travailleur, le travail comporte un capital, c'est-à-dire une aptitude, une compétence.
Conséquences de cette décomposition du travail en capital et en revenu
Le capital ainsi défini (le capital c’est les facultés du travailleur) est indissociable de celui qui le détient. L'aptitude à travailler ne peut pas être séparée de celui qui est compétent à faire ce travail. Ce n'est donc pas une conception de la force du travail, c'est une conception du capital-compétence. De sorte que le travailleur apparaît comme étant pour lui-même une sorte d'entreprise.
Le néolibéralisme apparaît ainsi comme étant le retour à l'homo-economicus, mais avec un déplacement considérable, puisque dans la conception classique l'homo-economicus c'est l'homme de l'échange, c'est l'un des deux partenaires dans le processus de l'échange, ce qui implique donc une théorie de l'utilité à partir d'une problématique des besoins.
Mais dans le néolibéralisme, l'homo-economicus n'est pas un partenaire de l'échange, c'est un entrepreneur, un entrepreneur de lui-même (il est entrepreneur de lui-même, il est son propre capital, il est son propre producteur, il est la source de ses revenus). L'homme de la consommation n'est pas simplement dans un processus d'échange, car dans la mesure où il consomme, c'est aussi un producteur. L'homme de la consommation produit sa propre satisfaction, et le salaire est perçu comme le revenu qui est affecté au capital humain.
En d'autres mots l'individu est une compétence-machine. La question est donc de former du capital humain, de former des compétences-machines. Il faut faire des investissements éducatifs, mais aussi repenser l'hygiène publique, jusqu'à l'analyse des phénomènes de migration.
Cependant il ne faut pas imaginer que ces analyses ne servent que des intérêts politiques immédiats. Si c'était le cas, il serait simple de les dénoncer comme servant des intérêts illégitimes. En effet, ces analyses permettent d'expliquer des phénomènes qui avaient été jusqu'alors expliqués à moitié, comme par exemple le phénomène de l'innovation. Par innovation il faut entendre :
- La fabrication d'un bien nouveau
- La découverte de nouvelles techniques
- La découverte de nouvelles sources de matières premières
- La découverte de nouveaux marchés
- La découverte de nouvelles ressources de main-d'œuvre
Les néolibéraux disent qu'on ne peut pas faire confiance à la hardiesse du capitalisme, ou en d'autres mots à la stimulation permanente de la concurrence, pour expliquer ce phénomène de l'innovation. En fait, disent les néolibéraux, l'innovation est le revenu du capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des investissements que l'on a faits au niveau de l'homme lui-même. Ils montrent qu'on ne peut pas rendre compte de la croissance fulgurante de certains pays simplement à partir des variables de l'analyse classique (c'est-à-dire la terre, le capital et le travail entendu en nombre de travailleurs et en nombre d'heures). Seule une analyse fine de la composition du capital humain peut rendre compte de la croissance effective de ces pays.
La politique de croissance ne sera donc plus simplement indexée au capital physique et au nombre de travailleurs, mais elle va être centrée sur la modification du capital humain. De sorte que l'individu doit être le principal souci des politiques économiques, mais aussi des politiques sociales, culturelles, éducationnelles.
De la même façon, à partir de ce problème du capital humain, on peut repenser les problèmes du non-démarrage de l'économie du tiers-monde, comme l'insuffisance d'investissement du capital humain.
Mais on peut aussi repenser l'histoire du décollage économique de l'Occident au XVIIe siècle, non plus comme étant dû à l'accumulation du capital physique, mais comme étant dû à l'existence d'une accumulation accélérée de capital humain.
C'est donc à la fois un nouveau schéma historique, mais aussi toute une programmation nouvelle des politiques de développement économique.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'éliminer les connotations politiques (c'est-à-dire que toutes ces analyses auraient comme objectif un contrôle absolu sur les individus), mais de montrer comment ces connotations politiques doivent leur densité à l'efficacité même de l'analyse.
(Il faut que les individus soient libres, et cultivés pour rendre la société riche)
21 mars 1979
Politique économique du champ social
Dans le libéralisme allemand, le marché était défini comme étant un principe de régulation économique indispensable au processus économique. La tâche du gouvernement, c'était de mettre en place une politique qui devait prendre en charge les processus sociaux pour que le mécanisme de marché se déploie le plus librement possible. Cette politique sociale consistait en un certain nombre d'objectifs : éviter la centralisation, favoriser les entreprises moyennes, soutenir l'artisanat et le petit commerce, multiplier l'accès à la propriété, tâcher de substituer les assurances individuelles aux couvertures sociales, régler les problèmes multiples de l'environnement.
Il y a dans cette idée d'une politique sociale, une équivoque économico-éthique autour même de la notion d'entreprise. Car faire une politique sociale ça veut dire deux choses :
- Généraliser la forme "entreprise" à l'intérieur du corps social. C'est-à-dire démultiplier le modèle économique (le modèle offre et demande, le modèle investissement-profit) pour en faire un modèle des rapports sociaux, un modèle de l'existence même.
- Utiliser le modèle de l'entreprise comme modèle social, c’est-à-dire s’en servir de support à la reconstitution de toute une série de valeurs morales et culturelles. Ces valeurs morales et culturelles sont des valeurs "chaudes", et se présentent comme le contraire du mécanisme "froid" de la concurrence.
Ce schéma de l'entreprise a pour but que l'individu ne soit plus aliéné par rapport à son milieu de travail, au temps de sa vie, à sa famille, et à son milieu naturel. Il s'agit de reconstituer autour de l'individu des points d'ancrage qui forment une politique vitale (vitalpolitik).
Le retour à l'entreprise, c'est donc une politique économique du champ social tout entier, mais c'est en même temps une politique vitale qui aura pour fonction de compenser ce qu'il y a de froid, de calculateur, de mécanique, dans le jeu de la concurrence proprement économique. C’est donc une société pour le marché, et qui compense en même temps les effets du marché. Les ordolibéraux ajoutent que la concurrence est un principe d'ordre dans le domaine de l'économie de marché, mais qu'on ne peut pas utiliser la concurrence comme modèle pour la société tout entière, car moralement et sociologiquement, la concurrence est un principe plutôt dissolvant qu'unifiant. Il faut donc un cadre politique et morale qui comporte :
- Un état qui soit capable de se maintenir au-dessus des différents groupes concurrentiels.
- Assurer une communauté non désagrégée.
- Garantir une coopération entre les hommes.
Néolibéralisme américain : la généralisation radicale de la forme du marché
Par rapport à cette ambiguïté de l'ordolibéralisme allemand, le néolibéralisme américain se présente avec une radicalité complète : il s'agit toujours de généraliser la forme économique du marché, mais cette fois dans le corps social tout entier. Cette généralisation illimitée de la forme du marché comporte un certain nombre d'aspects :
1. Analyse des comportements non économiques
Dans le néolibéralisme américain, l'économie fonctionne comme principe d'intelligibilité des rapports sociaux et des comportements individuels. Ce qui veut dire que l'analyse en termes d'offre et de demande, va servir de schéma que l'on peut appliquer à des domaines non économiques. Cette grille d'analyse va faire alors apparaître dans les domaines non économiques, un certain nombre de relations intelligibles.
(Exemple, la relation mère-enfant : la mère passe du temps avec son enfant, lui donne des soins, de l'affection, suit son éducation, ses progrès, fait attention à son alimentation. Tout cela est pour les néolibéraux un investissement qui va constituer le capital humain de l'enfant. Ce capital produira du revenu, c'est-à-dire le salaire de l'enfant quand il sera adulte. Et pour la mère qui a investi, le revenu sera psychique, elle aura de la satisfaction à voir que ses soins ont réussi. On peut donc analyser en termes d'investissement, de coût de capital, de profit du capital investi, de profit économique et de profit psychologique, tout ce rapport formatif entre la mère et l'enfant).
2. Critique économique du gouvernement
La grille économique va permettre de tester l'action gouvernementale, de jauger sa validité. Il s'agit de filtrer l'action de la puissance publique en termes de jeu d'offre et de demande. Il s'agit en somme de produire une critique marchande de la gouvernementalité.
Dans le libéralisme classique on demandait au gouvernement de respecter le laissez-faire. Dans le néolibéralisme on retourne le principe du laissez-faire en un ne-pas-laisser-faire le gouvernement. Le libéralisme classique cherchait à établir une juridiction administrative en face de la démesure de l'action gouvernementale. Le néolibéralisme constitue une sorte de tribunal économique permanent en face du gouvernement.
Analyse néolibérale de la criminalité
À la fin du XVIIIe siècle, les théoriciens ont analysé le système pénal à travers un calcul d'utilité. L'idée était d'avoir le coût de la pratique judiciaire le plus bas possible. Les législateurs du début du XIXe siècle ont finalement choisi la solution légaliste. L'idée était que la loi serait la solution la plus économique pour punir les gens :
- Définition du crime comme infraction à une loi
- Fixation des peines par la loi
- Gradations des peines proportionnelles à la gravité des crimes
- Application au crime, d'une loi qui détermine à l'avance la peine que le criminel doit subir
La loi a été retenue à la fin du XVIIIe siècle comme principe d'économie dans le pouvoir pénal : l'homo penalis, l'homme qui est pénalisable. C'est donc une mécanique simple et économique.
Mais au XIXe siècle, cette économie conduit à un effet paradoxal : la loi ne sanctionne que des actes, mais la punition n'a de sens que si on punit l'individu. Et c'est dans cette équivoque entre crime et criminel que l'on s'est mis à distinguer les criminels selon des types de caractères. Et quand la criminologie se constitue à la fin du XIXe siècle, toute une anthropologie du crime pénètre le savoir, et parasite les sentences par des mesures individualisantes répondant à de nouvelles normes issues de l’anthropologie du crime.
L'analyse des néolibéraux consiste à s'en tenir à un homo economicus, et voir comment le crime peut être analysé à partir de là. Les néolibéraux appellent crime : “toute action qui fait courir à un individu le risque d'être condamné à une peine”. Cette définition peut nous sembler étrange, mais pourtant le code pénal lui-même ne donne aucune définition substantielle, aucune définition morale du crime. Dans le code pénal, le crime c'est ce qui est puni par la loi.
Donc dans le code pénal, le crime est défini du point de vue de l'acte. Définition objective, opératoire, faite du point de vue du juge. Au contraire, avec la définition des néolibéraux, on se place du point de vue de celui qui commet le crime : le crime c'est cette chose qui fait que le criminel risque d'être puni.
Ce déplacement du point de vue est de même type que celui qui était opéré à propos du capital humain et du travail : ne plus penser du point de vue du processus économique, mais du point de vue de celui qui prend la décision de travailler. On passe donc là aussi du côté du sujet individuel, mais sans y additionner un savoir psychologique et anthropologique. La seule analyse qui opère, est une analyse économique. Ça veut dire que l'individu est gouvernementalisable seulement dans la mesure où il est un agent économique.
Le criminel est comme n'importe qui, et cette réalité du crime et du criminel disparaît donc pour le système pénal : le système pénal n'a affaire qu'à des conduites, il aura donc à réagir à une offre de crime. La punition est le moyen utilisé pour limiter les crimes, et par conséquent pour limiter les externalités négatives.
"Si le crime permet à l'individu qui le commet de maximiser son utilité propre, il génère cependant, au niveau de la collectivité, des externalités négatives. Le niveau global de cette activité doit donc être limité. L'une des façons de limiter les externalités négatives résultant des crimes, est d'arrêter les criminels et de leur infliger des peines" (F. Jenny "la théorie économique du crime").
La théorie classique articulait les différents effets attendus de la punition : réparation civil, amendement de l'individu, prévention. Mais les néolibéraux vont concevoir la punition différemment, la loi n'est qu'un interdit :
- Institutionnalisation de la loi : Cette interdiction est une réalité institutionnelle.
- L’application de la loi (enforcement of law) : Cette interdiction reçoit une force réelle par l'ensemble des instruments qu'on va lui donner (punitions, zèle des détectives, rapidité des juges à juger, élasticité de la peine). Donc l’application de la loi, c'est l'ensemble des instruments qui s'oppose à l'offre du crime.
Or, l'offre du crime n'est ni neutre ni indéfiniment extensible, et ceci pour deux raisons :
- Il y a certaines tranches de comportements criminels qui cèdent très facilement à une très légère intensification de l’application de la loi. Et puis il y a certaines tranches de comportements qui ne céderont pas, même avec une intensification extrême de l’application de la loi.
- Cette application de la loi a un coût, il comporte donc des inconvénients politiques, sociaux… Donc la politique pénale ne va pas avoir le même objectif que les réformateurs du XVIIIe siècle, à savoir la disparition totale du crime. Elle va au contraire être conçue comme une simple intervention censée limiter le crime. Mais le coût de cette intervention ne devra jamais dépasser le coût de la criminalité.
La société est donc productrice de comportements conformes, elle n'a pas l'objectif de supprimer définitivement le crime, mais seulement d'obtenir un équilibre entre l'offre de crime et la réponse de la loi.
La société n'a pas un besoin indéfini de conformité, donc elle n'a pas besoin d'un système disciplinaire écrasant : elle se trouve bien avec un certain taux d'illégalisme, et se trouverait mal de vouloir le réduire indéfiniment.
Le problème de la drogue
Tant que la loi ne cherchait qu'à réduire l'offre de la drogue, cela voulait dire démanteler les réseaux de raffinage et de distribution. Or ce type de politique a eu comme effets :
- Augmentation du prix unitaire de la drogue.
- Création de monopoles de gros vendeurs, avec comme effet une montée des prix rendue possible par l'effacement de la concurrence.
- Augmentation de la criminalité, car le drogué est prêt à tout pour acheter sa drogue.
Il ne faut donc pas limiter l'offre de drogue, mais la déplacer : obtenir les prix d'entrées les plus élevés pour dissuader les nouveaux consommateurs et ceux qui ne sont pas complètement addicts. Et obtenir les prix les plus bas pour ceux qui seront prêts à tout pour acheter leur drogue, afin que leur consommation de drogue soit le moins criminogène possible. Donc de là, toute une politique pénale obéissant à une rationalité économique.
Conséquences :
- Gommage anthropologique du criminel, mais interprétation économique d'un type de comportement. Autrement dit, toutes les distinctions qu'il y avait entre criminels, criminels d'occasions, pervers et pas pervers, récidivistes, n'ont aucune importance. Car aussi pathologique que soit le sujet, il est "responsive" à ces changements dans les gains et les pertes. De sorte que l'action pénale doit être une action sur le jeu des gains et des pertes possible. Il faut agir sur le milieu de marché.
- Ce qui apparaît n'est pas le projet d'une société disciplinaire ayant des mécanismes normatifs. On a au contraire l'idée d'une société dans laquelle il y aurait optimisation des systèmes de différence, dans laquelle il y aurait une tolérance accordée aux individus et aux pratiques minoritaires. Donc non pas une action sur les joueurs du jeu, mais sur les règles du jeu. Pas une intervention sur les individus, ou une intervention de type environnementale.
28 mars 1979
Avec l'extension du champ d'application de l'homo economicus, on arrive à l’idée que l'économie est l'analyse des conduites rationnelles, et inversement, que toute conduite rationnelle relève d'une analyse économique. Mais cette définition déjà très extensive, n'est pas la seule. Il y a des définitions encore plus radicales. Becher, qui fait partie des néolibéraux américains les plus radicaux, soutient que l'analyse économique peut s'étendre même au-delà des conduites rationnelles. Ces économistes soutiennent que l'analyse économique est efficace du moment que la conduite d'un individu n'est pas aléatoire par rapport au réel. En d'autres mots, toute conduite qui accepte la réalité doit pouvoir relever d'une analyse économique. Sous cet angle-là, l'économie est donc la science de la systématicité des réponses aux variables du milieu.
Cette définition présente un certain nombre d'intérêts, comme intégrer à l'économie les techniques comportementales. Ces méthodes ne consistent pas à faire l'analyse de la signification des conduites, mais à savoir comment un jeu de stimuli va pouvoir, par des mécanismes de renforcement, entraîner des réponses dont la systématicité pourra être notée, et à partir de laquelle on pourra introduire d'autres variables de comportement. On voit donc bien que la psychologie peut entrer dans cette définition de l'économie.
Cette définition que donne Becher, malgré son caractère isolé, permet de pointer un paradoxe : l'homo economicus du XVIIIe on le laissait faire. Mais chez Becher, l'homo economicus, on le manipule en agissant sur son milieu.
Ce paradoxe permet de repérer un problème central : est-ce que l'homo economicus est ce qui se manifeste comme libre en face de toutes les législations du gouvernement, où est-ce que l'homo economicus est un certain type de sujet qui est éminemment gouvernable selon le principe de l'économie ?
C'est bien cette deuxième hypothèse que je voudrais suivre, c'est-à-dire l'homo economicus comme élément de base de la nouvelle raison gouvernementale au XVIIIe siècle.
L'homo economicus comme élément de base de la nouvelle raison gouvernementale au XVIIIe siècle
Il n'y a pas de théorie de l'homo economicus, ni même d'histoire de cette notion. Pour comprendre l'apparition de l'homo economicus, je partirai de l'empirisme anglais et de la théorie du sujet.
Avec Locke, apparaît un sujet qui n'est pas défini par sa liberté, ni par l'opposition de l'âme et du corps, ni par un noyau de concupiscence marqué par la chute. Chez Locke, le sujet apparaît comme sujet de choix individuels à la fois irréductibles et intransmissibles :
Irréductibles : le choix entre le pénible et le non-pénible constitue un irréductible qui ne renvoie à aucun raisonnement. C'est une butée dans l'analyse. La peine est une fin dernière qui n'est jamais rapportée à un autre objet.
Intransmissibles : on ne peut pas forcer un individu à changer de préférence. C'est mon propre sentiment de pénible ou d'agréable qui va être le principe de mon choix.
L’intérêt
Ce principe d'un choix atomistique et inconditionnellement référé au sujet lui-même, c'est cela que l'on appelle l'intérêt. La philosophie empirique anglaise fait donc apparaître quelque chose de nouveau : l'idée d'un sujet d'intérêt. L'intérêt apparaît pour la première fois comme une forme de volonté, à la fois immédiate et absolument subjective.
La problématique de l'homo economicus, va être donc de savoir si cette forme de volonté qu'on appelle l'intérêt, peut être considérée de même type que la volonté juridique :
Premièrement : Au milieu du XVIIIe siècle, le contrat est posé comme étant le résultat d'un intérêt. En somme, le contrat protégerait les intérêts. Mais Hume fait remarquer que si on respecte le contrat, ce n'est pas parce qu'il y a contrat, mais parce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait contrat. Donc l'apparition du contrat n'a pas substitué un sujet de droit au sujet d'intérêt, car rien n'oblige à continuer à obéir à un contrat qui ne présente plus d'intérêt.
Donc le sujet d'intérêt continue à exister pendant que la loi existe. Le sujet d'intérêt déborde en permanence le sujet de droit, il est donc irréductible au sujet de droit, il en est la condition de fonctionnement en permanence. En somme, pas de sujet de droit sans sujet d'intérêt.
Deuxièmement : le sujet de droit et le sujet d'intérêt n'obéissent pas à la même logique. Le sujet de droit a, à l'origine, des droits naturels qu'il a accepté de céder, mais on ne demande jamais au sujet d'intérêt de renoncer à son intérêt.
- Dialectique du sujet de droit (dialectique de la renonciation) :
- Partage du sujet
- Existence d'une transcendance du deuxième sujet par rapport au premier
- Rapport de renonciation
- Rapport de limitation
- Dialectique du sujet d'intérêt (dialectique de la multiplication spontanée) :
- Mécanique égoïste
- Mécanique multiplicatrice
- Mécanique sans transcendance
- Mécanique où les volontés et intérêts hétérogènes s'accordent spontanément et involontairement
Donc le marché et le contrat fonctionnent exactement à l'inverse l'un de l'autre. Ce sont deux structures hétérogènes. Il y a donc hétérogénéité formelle entre le sujet économique et le sujet de droit. Mais ils entretiennent aussi une différence essentielle dans leur rapport au pouvoir politique. Effectivement, l'intérêt proprement individuel de quelqu'un qui se trouve dans une société présente deux caractères :
- C'est un intérêt qui dépend d'une infinité de choses : chacun est dépendant par rapport au cours des choses et au cours du monde (L'individu est lié au monde sous la forme de la dépendance).
- Son intérêt est lié à toute une série d'effets positifs qui fait que ce qui lui est profitable va se trouver profitable aux autres (L'individu est lié aux autres sous la forme de la production).
L'homo economicus se trouve donc dans un double involontaire :
- L'involontaire des accidents qui lui arrivent
- L'involontaire du profit qu'il produit pour les autres
Il se trouve aussi dans un double indéfini :
- Le monde ne peut pas être totalisé, il y a trop de contingence.
- Le profit qu'il va produire pour les autres est un indéfini.
La main invisible
L'homo economicus doit donc le caractère positif de son calcul à tout ce qui échappe à son calcul. On arrive là, bien sûr, au fameux texte du chapitre 2 livre 4 de "La richesse des nations", dans lequel Adam Smith parle de la main invisible. La main invisible est cette étrange mécanique qui fonde la rationalité des choix égoïstes de l'homo economicus.
Concernant la main invisible d'Adam Smith, on a l'habitude de dire qu'elle relève d'un optimisme économique plus ou moins réfléchi, ou encore, qu’elle est le reste d'une pensée théologique de l'ordre naturel. Or, Adam Smith insiste bien sur quelque chose : pour que le profit soit collectif, il faut absolument que chacun des acteurs soit aveugle à cette totalité. L'obscurité est absolument nécessaire à tous les agents économiques. On a l'habitude d'insister sur le côté "main", sur un "quelque chose" de providentiel, mais l'élément de l'invisibilité est aussi important. C'est une invisibilité qui fait qu'aucun agent économique, mais aussi qu'aucun agent politique, ne doit et ne peut chercher immédiatement le bien collectif. Autrement dit, le monde de l'économie doit être, et ne peut être qu'obscur au souverain et ceci de deux façons :
- Le pouvoir ne doit pas faire obstacle au jeu des intérêts individuels : Puisque la mécanique économique implique que chacun suive son propre intérêt, le pouvoir politique n'a pas à intervenir, il faut laisser faire chacun.
- Le pouvoir ne peut pas faire obstacle au jeu des intérêts individuels : il est impossible que le souverain puisse avoir sur le mécanisme économique un point de vue qui totalise chacun des éléments et permette de les combiner.
L'Homo économicus : l'ilot de rationalité
La rationalité économique se trouve donc entourée par, et fondée sur l'inconnaissabilité de la totalité du processus. L'homo economicus est le seul îlot de rationalité possible à l'intérieur du processus économique. Et c'est le caractère incontrôlable du processus économique qui fonde la rationalité du comportement atomistique de l'homo economicus, c'est-à-dire de son point de vue irréductible.
L'économie est une discipline athée, une discipline sans Dieu, sans totalité. C'est donc une discipline qui commence à manifester l'inutilité et l'impossibilité du point de vue du souverain sur la totalité de l'État qu'il a à gouverner. Le monde politico-juridique et le monde économique apparaissent dès le XVIIIe siècle, comme des mondes hétérogènes et incompatibles. L'homme de droit dit au souverain : j'ai des droits, je t'en ai confié certains, tu ne dois pas toucher aux autres. L'homo economicus dit au souverain : tu ne dois pas parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas, et tu ne sais pas parce que tu ne peux pas savoir. Il dit donc au souverain qu'il est impuissant.
L'économie politique se présente donc comme critique de la raison gouvernementale. Pour l'économie, il n'y a pas de souverain économique. C'est ce problème-là qui va être posé à travers tout le monde moderne. Et tout ce qui va apparaître comme planification, économie dirigée, socialisme, socialisme d'État, va être la tentative de trouver un point par où on puisse définir une souveraineté économique.
À plus courte échelle et dans son contexte immédiat, la théorie de la main invisible est la récusation de l'état de police, de la raison d'État.
L'économie politique chez les physiocrates
La théorie de la main invisible s'oppose très exactement à ce que disaient peu de temps avant les physiocrates.
- Les physiocrates soutenaient qu'il ne fallait absolument pas que l'État intervienne sur la mécanique des intérêts. C'est donc une critique sévère de toute cette réglementation administrative. Mais ils ajoutent aussitôt que le souverain est copropriétaire de toutes les terres du pays. Il y a donc adéquation entre le souverain et les agents économiques puisque le souverain est copropriétaire des terres.
- L'existence d'un Tableau économique qui permet de suivre le circuit de la production, donne au souverain la possibilité de connaître tout ce qui se passe à l'intérieur de son pays, et le pouvoir de contrôler les processus économiques. Donc si le souverain laisse libre les agents économiques, c'est parce qu'il sait ce qu'il se passe et comment il faut que ça se passe. Il accepte donc rationnellement le principe de la liberté des agents économiques. Il y a donc adéquation entre le savoir du souverain et la liberté des individus.
- Puisque le souverain sait tout ce qui se passe, il devra expliquer aux différents agents économiques ce qu'ils doivent faire pour maximiser leur profit. Donc ce savoir économique, dont le principe se trouve dans le tableau économique dressé par les physiocrates, sera commun aux agents économiques et au souverain. Il y a donc là aussi adéquation entre le souverain et les agents économiques.
Donc chez les physiocrates, le principe du laissez-faire peut coïncider avec l'existence d'un souverain. Souverain d'autant plus despotique, que sa seule loi sera celle d'un savoir bien dressé qu'il partagera avec les agents économiques.
La main invisible d'Adam Smith, c'est tout le contraire. Il ne peut pas y avoir de despotisme au sens physiocratique du terme, parce qu'il n'y a pas d'évidence économique. Donc dès la théorie d'Adam Smith et la théorie libérale, la science économique ne s'est jamais présentée comme devant être la programmation complète de la rationalité gouvernementale. L'économie politique est bien une science, mais elle ne peut pas être la science du gouvernement. On doit gouverner en écoutant les économistes, mais il ne faut pas que l'économie soit la rationalité gouvernementale elle-même.
C'est donc à partir de la théorie de la main invisible que va se poser un nouveau problème : de quoi va s'occuper le gouvernement si ce n'est pas le processus économique qui constitue de plein droit son objet ? Ce sera la théorie de la société civile.
4 avril 1979
Il y a donc une différence entre l'homo economicus et le sujet de droit. L'homo economicus ne se contente pas de limiter le pouvoir du souverain comme le fait le sujet de droit. Jusqu'à un certain point, il destitue le souverain, dans la mesure où il fait apparaître chez lui une incapacité essentielle à dominer la totalité du domaine économique.
Jusqu'au XVIIe siècle, il y avait au-dessus du souverain, les dessins de Dieu. Il y a maintenant, vers la fin du XVIIIe, au-dessous du souverain, les labyrinthes du champ économique.
Par rapport à cela, il y avait très schématiquement deux solutions possibles :
- Limiter l'activité de la gouvernementalité tout en maintenant la raison d'État : Si l'activité économique échappe au souverain, il faut fixer à son pouvoir une sorte de frontière : il pourra toucher à tout sauf au marché.
- Maintenir la sphère d'activité de la gouvernementalité, mais modifier la nature même de l'activité gouvernementale : Le souverain doit respecter le marché dans la mesure où il détient la connaissance du marché. Cette reconnaissance le place dans un rapport de passivité et de surveillance vis-à-vis du marché. Il passe donc, vis-à-vis du marché, de l'activité politique à la passivité théorique.
La société civile
Mais en fait, aucune des deux solutions n'a eu de suite réelle dans l'histoire, ça ne pouvait rester qu'une sorte de virtualité théorique.
Gouverner des individus qui sont à la fois des sujets de droit et des acteurs économiques, ne peut se faire que par l'émergence d'un nouveau domaine. Pour que la gouvernementalité conserve son caractère global, pour qu'elle n'ait pas à se soumettre à une raison scientifique et économique, et pour qu'elle n'ait pas à se scinder en deux branches, le juridique et l'économique, il faut donner à l'art de gouverner un nouveau domaine de référence : la société civile.
La société civile, c'est cette tentative pour limiter, autant par le droit que par la domination d'une science économique, la pratique gouvernementale (Pratique gouvernementale qui doit prendre en charge l'hétérogénéité de l'économique et du juridique). La société civile n'est donc pas une idée philosophique, c'est un concept de technologie gouvernementale.
La société civile, qu'on appellera très vite "la société", ce qu'on appelait à la fin du XVIIIe siècle "la nation", c'est ce qui va permettre au gouvernement de s'auto-limiter tout en restant :
- Un gouvernement omniprésent
- Un gouvernement auquel rien n'échappe
- Un gouvernement qui obéit aux règles de droit tout en respectant la spécificité de l'économie
Ce sera donc un gouvernement qui gèrera la société, qui gèrera le social.
L'homo economicus et la société civile sont deux éléments indissociables de la gouvernementalité libérale. La société civile a toujours été référée comme étant cette réalité qui s'impose et qui échappe au gouvernement. Il faut être très prudent quant au degré de réalité que l'on accorde à cette société civile, elle n'est pas un donné historico-naturel. La société civile, c'est quelque chose qui fait partie de la technologie gouvernementale moderne. La société civile, c'est comme la folie, c'est comme la sexualité, c'est ce que j'appellerais des réalités de transaction, des réalités transactionnelles (c'est-à-dire que le sens de la société civile est lié au contexte où cette notion intervient).
Quelques remarques sur la société civile
Chez Locke, la société civile, c'est l'ensemble des individus liés entre eux par un lien juridique et politique. Mais la notion de société civile a complètement changé au cours du XVIIIe siècle.
Pour saisir ce qu'est la société civile, je prendrai le texte de Ferguson, traduit en français en 1783 sous le titre "Essai sur l'histoire de la société civile". C'est le texte le plus fondamental quant à la caractérisation de la société civile. Le mot "société civile" chez Ferguson a à peu près le même sens que le mot "nation" chez Adam Smith. La société civile de Ferguson, c'est en effet l'élément concret à l'intérieur duquel fonctionnent les hommes économiques d'Adam Smith.
La société civile, dans le texte de Ferguson, a quatre caractères :
1. La société civile comme constante historico-naturelle
Avant la société civile, rien n'existe ou, si quelque chose existe, ça nous est absolument inaccessible. Il n'est donc pas utile de se poser la question de la non-société. L'histoire humaine a toujours existé par groupe. La société est aussi ancienne que l'individu. La nature humaine est historique et sociale. Le lien social est sans préhistoire, cela veut dire qu'il est permanent et indispensable. En somme, le social fait partie du naturel, la société civile est donc une constante historico-naturelle pour l'humanité.
2. La société civile assure la synthèse spontanée des individus
Comme on vient de le voir, la société civile n'est pas le produit d'un contrat. Que la société civile assure la synthèse spontanée des individus, cela veut dire qu'il n'y a pas de contrat explicite, pas de renonciation à des droits. La synthèse s'opère par une sommation des satisfactions individuelles dans le lien social lui-même. Ce qui lie les individus dans la société civile, c'est toute une série d'intérêts désintéressés : l'instinct, la sympathie, la bienveillance, la répugnance pour d'autres individus, la répugnance pour le malheur des individus… Donc première différence entre sujets économiques et sujets sociaux : il y a dans la société civile tout un jeu d'intérêts désintéressés, beaucoup plus large que l'intérêt lui-même.
La seconde différence c'est qu'entre les sujets économiques, le lien est non local. La multiplication des profits se fait par la synthèse spontanée des égoïsmes. Il n'y a pas de territorialité, il n'y a pas de regroupements singuliers dans l'espace du marché. En revanche, la société civile est un ensemble limité, singulier parmi d'autres ensemble, ce n'est pas l'humanité en général. C'est la société civile qui fait que l'individu embrasse le parti d'une tribu ou d'une communauté. La société civile n'est pas humanitaire, elle est communautaire.
Le lien d'intérêt économique va jouer un rôle très curieux dans cette société civile. D'une part, il lie les individus entre eux par la convergence spontanée des intérêts. D'autre part, en rendant plus incisif l'intérêt égoïste des individus, il tend à défaire perpétuellement ce que le lien spontané de la société civile a noué. Autrement dit, le lien économique n'est possible que par la société civile, mais paradoxalement le lien économique défait la société civile. Donc plus on va vers un état économique, plus la société civile se défait, et plus l'homme est isolé par le lien économique qu'il a avec tout le monde et n'importe qui.
3. La société civile comme matrice permanente de pouvoir politique
Dans la société civile, il y a formation spontanée de pouvoir. Il n'y a pas besoin du renoncement à certains droits, ni de l'acceptation de la souveraineté. Le pouvoir se forme spontanément par les différences qu'il y a entre les individus. Les différences entre les individus induisent immédiatement des divisions du travail dans la production et dans les prises de décisions. Les uns réfléchissent, les autres obéissent.
Ce n'est qu'après avoir fait beaucoup de fautes que les hommes ont décidé de donner des règles au gouvernement lui-même. La structure juridique du pouvoir vient toujours après le fait du pouvoir lui-même. On ne peut donc pas concevoir un homme sans pouvoir. Le pouvoir est caractéristique de la société civile. La société civile est donc subordination spontanée.
4. La société civile est le moteur de l'histoire
La société civile est donc synthèse spontanée et subordination spontanée. Or, L'égoïsme de l'homo economicus, à savoir l'intérêt, prend place dans cette structure comme principe de dissociation. Donc dans ce milieu spontané et cet équilibre spontané de la société civile, l'intérêt est un lien tout aussi spontané, mais dissociatif. C'est donc l'intérêt qui crée le déséquilibre dans la société civile par le fait même de la mécanique économique.
Selon Ferguson, les sociétés civiles passent par trois phases :
- La phase de la sauvagerie : dans la société sauvage, il n'y a pas d'agriculture ni d'élevage, donc pas de propriété. Il y a cependant un commencement de subordination et de gouvernement.
- La phase de la barbarie : dans la société barbare il y a agriculture et élevage, il y a donc un début de société privée, mais elle n'est pas encore garantie par des lois. Les rapports sont ceux de maître à serviteur, de famille à esclave, de patron à client.
- La phase de la civilisation : c'est la société que nous connaissons, et qui est garantie par des lois.
L'intérêt, principe de transformation historique
C'est donc à partir du jeu économique rendu possible par la société civile, que se produisent les transformations historiques. Le principe d'association dissociatif est aussi un principe de transformation historique. Le paradoxe est donc que ce qui fait l'unité du tissu social est en même temps le principe du déchirement perpétuel du tissu social : l'intérêt, le jeu économique. Unité et déchirement sont liés.
Un second paradoxe est que ce qui fait l'unité du tissu social et en même temps le principe de la transformation historique. Unité et transformation sont liées.
L'histoire de l'humanité est donc la forme parfaitement logique et déchiffrable qui naît d'initiatives aveugles et d'intérêts égoïstes. Donc encourager ces initiatives aveugles, ces intérêts égoïstes, créera un profit de plus en plus grand pour la collectivité tout entière : une transformation perpétuelle de la société civile. Et ce qui va permettre aux intérêts égoïstes de jouer le mieux possible, c'est le jeu économique.
Avec une analyse comme celle-ci, on est là à un croisement important puisque :
- Ce qui caractérise la société civile, ce sont les relations sociales qui ne sont ni économiques, ni juridiques, et qui sont pourtant collectives et politiques.
- La société civile, c'est l'articulation de l'histoire sur le lien social. L'histoire n'est pas le développement logique d'une structure juridique donnée au départ, elle n'est pas non plus la dégénérescence d'une transparence originaire. L'histoire est la formation perpétuelle de nouvelles relations sociales, de nouvelles structures économiques et par conséquent de nouveaux types de gouvernements.
- La société civile permet de montrer une relation interne et complexe entre le lien social et l'autorité du gouvernement.
Ces trois éléments démarquent la notion de société civile :
- Ouverture d'un domaine de relations sociales non juridiques (se démarque de Hobbes)
- Articulation de l'histoire sur le lien social sous une forme saine (se démarque de Rousseau)
- Appartenance organique du gouvernement au lien social et du lien social à la forme d'autorité (se démarque de Montesquieu)
On entre dans un tout autre système de pensée politique corrélée à l'émergence du problème économique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la question était de savoir comment retrouver à l'origine de la société la forme juridique qui limiterait l'exercice du pouvoir. Au contraire, dans cette nouvelle analyse politique, on a affaire à une société qui existe avec des phénomènes de pouvoir, et le problème va simplement être de savoir comment régler le pouvoir et comment le limiter. C'est ainsi que va se poser cette question politique toujours d'actualité : Comment l'État peut fonctionner par rapport à une société déjà donnée ?
(Il ne faut pas confondre société et gouvernement. La société est produite par nos besoins, mais le gouvernement est produit par nos faiblesses. La société encourage la relation, le gouvernement crée des différences. La société est un patron, le gouvernement est un punisseur. En toutes circonstances, la société est une bénédiction. Le gouvernement n'est au mieux qu'un mal nécessaire, au pire il est intolérable" Thomas Paine, père fondateur des États-Unis).
Avec cette idée de société civile on a une redistribution de cette raison gouvernementale. Le problème qu'on voit apparaître à partir du XVIe siècle est le suivant : comment peut-on régler et mesurer l'exercice du pouvoir chez celui qui gouverne ? Pendant longtemps on a pensé que le souverain devait être sage. Et cette sagesse du souverain on essayait de la trouver en réglant le gouvernement à la vérité : vérité du texte religieux, vérité de l'ordre du monde. C'était ce principe de vérité qui devait régler l'exercice du pouvoir.
À partir du XVIe XVIIe siècle, l'exercice du pouvoir ne se fait plus selon la sagesse mais selon le calcul. Le gouvernement n'est plus réglé sur la vérité mais sur la rationalité. Ce réglage du gouvernement sur la rationalité a pris deux formes :
- Rationalité du souverain : Cela posait la question de la légitimité de la rationalité du souverain qui surplombait les processus économiques.
- Rationalité des gouvernés : L'autre voie, ça a été de régler le gouvernement, non pas sur la rationalité du souverain, mais sur la rationalité de ceux qui sont gouvernés en tant que sujets d'intérêts. C'est donc la rationalité des gouvernés qui doit servir de principe de réglage à la rationalité du gouvernement. C'est cela qui caractérise la rationalité libéral.
La naissance de la politique
C'est là la transformation importante que j'ai essayé de localiser. Ce qui ne veut pas dire que la rationalité de l'individu souverain soit pour autant abandonnée. D'une façon générale, toutes les politiques nationalistes, étatiques, vont être des politiques dont le principe de rationalité sera indexé à l'intérêt de l'individu souverain, ou de l'État souverain.
De la même façon, le gouvernement réglé à la vérité n'a pas non plus disparu : le marxisme est un type de gouvernementalité indexé à une rationalité, non pas des intérêts individuels, mais d'une histoire entendue comme vérité.
Et ce sont ces différents arts de gouverner (art de gouverner à la vérité, art de gouverner à la rationalité de l'État souverain, art de gouverner à la rationalité des agents économiques), qui, en se chevauchant les uns les autres, vont faire l'objet du débat politique depuis le XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est que la politique, sinon le jeu de ces différents arts de gouverner et le débat qu'ils suscitent ? C'est là, me semble-t-il, que naît la politique.
Video(s)
Photo(s)