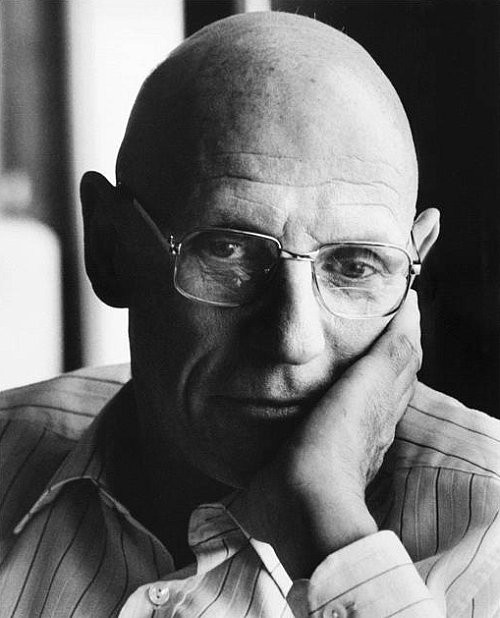Foucault - "Il faut défendre la société" (1976)
“Il faut défendre la société” Michel Foucault
Cours au Collège de France - 1976
Abrégé résumé par César Valentine
Dans ce cours, Foucault expose les différents discours de la “guerre des races”, sorte de contre-histoire du discours historique dominant, ce dernier fonctionnant comme une justification et un renforcement du pouvoir. Il montre ainsi comment la guerre pour le pouvoir s’est faite, à partir du XVIIe siècle, par et à travers l’histoire, et comment au XIXe siècle l'État a récupéré et transformé le discours de la “guerre des races” en un racisme sur la population pour légitimer son action par l’impératif “il faut défendre la société”.
“Il faut défendre la société” peut alors s’entendre de deux façons : comme le discours de l'État exerçant une violence sur la population, mais aussi comme une revendication des individus contre l'État.
A propos de l’archéologie :
- Partout où elle passe, l’archéologie dérange les récits du passé » François-Xavier Fauvelle
- L'archéologie a comme conséquence au terme de ses découvertes, la reconnaissance de la méconnaissance
- L'archéologie donne tort à ceux qui voudraient que les fouilles ne servent qu'à confirmer ou illustrer les sources écrites
7 janvier 1976
Pendant la première moitié des années 70, Foucault fait des recherches voisines les unes des autres, mais qui ne forment pas un ensemble cohérent. Ces recherches touchent ainsi l'histoire du droit pénal, l'évolution de la psychiatrie, la question de l'inquisition au Moyen-Âge, la monnaie grecque, l'histoire du savoir de la sexualité. Or, ce travail à ce point discontinu et d'apparence hétérogène, que Foucault nomme l’archéologie, n'est pas un fait isolé propre à Foucault. Depuis le début des années soixante, on voit dans le champ de la philosophie beaucoup de discours offensifs visant à détruire ou à remettre en question des savoirs institutionnalisés. Ces recherches s'attaquent à des savoirs tels que la psychiatrie, la morale sexuelle traditionnelle, ou encore l'appareil judiciaire. Depuis le début des années soixante, les grandes figures du savoir deviennent critiquables. Beaucoup d’événements ont concouru à cette pensée critique, dont l’un d’eux est la guerre du Vietnam.
Foucault remarque qu'il y a depuis le début des années soixante “un caractère local de la critique” (Dits et écrits, II, p.163). C’est-à-dire que cette critique a la particularité d'être autonome et non-centralisée, donc une activité critique qui ne passe pas par les voies de l’institution pour établir sa validité. Cette critique locale s'est effectuée par des “retours de savoir“. Par “retours de savoir” il faut entendre qu’un certain savoir perdu se retrouve. Ce retour des savoirs prend une forme insurrectionnelle contre le savoir institutionnel et centralisé.
Ce “retour des savoirs”, c’est la libération de savoirs non-disponibles. Ces savoirs sont non-disponibles pour plusieurs raisons. D’une part, ce sont des contenus historiques qui ont été perdus ou effacés par l’histoire officielle. Or, c'est précisément les contenus historiques qui permettent de retrouver les luttes masquées par l'histoire officielle. C'est la critique qui retrouve ces contenus historiques, et les recode en rendant illégitime l’histoire officielle. Mais plus encore, la critique historique retrouve les luttes, c’est-à-dire les futurs inaccomplis du passé et par là permet d’éclairer notre actualité. Cette activité critique est le produit d’une érudition, c’est bien l’érudition qui rend possible ce retour des savoirs car il faut effectuer un travail de lecture et de comparaison d’archives.
D'autre part, par “retour des savoirs”, il faut entendre ce que Foucault appelle le “savoir des gens”. Le savoir des gens est un savoir non-disponible car il n’est pas reconnu par l'institution comme ayant une valeur scientifique. Or, depuis le début des années soixante, apparaissent ces discours non-qualifiés et donc disqualifiés. Les gens ne se sont pas mis d’un coup à parler, mais soudainement on les entend parler. Et c’est donc aussi par le savoir des gens que se fait la critique d’une histoire officielle.
Selon Foucault, la force de la critique qui a eu lieu après le début des années soixante vient de la rencontre des savoirs retrouvés par l'érudition et des savoirs disqualifiés par la hiérarchie des connaissances. Ce qui a permis la rencontre de ces deux types de savoir, c'est qu'il s'agissait dans les deux cas du savoir historique des luttes. C’est donc la redécouverte de ces luttes qui a produit une multitude de recherches généalogiques (Cependant, Foucault remarque que ces généalogies de la lutte n’ont été possibles que parce que la hiérarchie des connaissances est devenue plus flexible, plus perméable : on a par exemple laissé de la place aux gens dans les médias). La généalogie, c'est donc la rencontre des connaissances érudites et de la mémoire des gens . Et c’est de cette rencontre que se constitue un savoir historique des luttes, savoir qui permet, à son tour, les luttes elles-mêmes.
Mais la généalogie n’est pas pour autant une forme de science plus pertinente que la science officielle, "les généalogies sont des anti-sciences" (Dits et écrits, II, p.165), elles ne sont que l'insurrection des savoirs contre l'institution et le discours scientifique. Pour le dire autrement, la généalogie, c’est la tentative de briser ou de renverser la hiérarchie des savoirs. Hiérarchie présente dans la pédagogie, l'institution, l'économie, la psychanalyse, la politique. (À noter qu’un discours qui devient un discours marqué de scientificité, acquiert par là du pouvoir. Un discours qui est reconnu comme scientifique est un discours qui va gagner un corps et va avoir des effets. De sorte que le “corps” du discours dans la modernité, c’est la scientificité. On peut en déduire qu’avec la reconnaissance du savoir des gens, les gens eux-mêmes gagnent un “corps”, c’est-à-dire deviennent le lieu de production d’effets).
L'archéologie, étant l’activité qui consiste à retrouver des “blocs de savoir historique”, est par essence une théorie de la discontinuité. Mais ceux qui ont voulu faire de Foucault un penseur de la discontinuité se sont trompés, car la finalité même de l’archéologie est la généalogie, c’est-à-dire l’unité des discontinuités retrouvées par l’archéologie. L’archéologie n’est que la méthode de travail, mais la finalité est la généalogie. La généalogie vise toujours en dernier lieu notre propre actualité en cherchant à comprendre comment ces discontinuités discursives ont déterminé notre présent, le but étant de libérer notre savoir du savoir hiérarchique. (On peut d’ailleurs voir trois périodes chez Foucault. Le premier Foucault jusqu’au milieu des années 70 fait de l’archéologie, le second Foucault à la fin des 70 fonde une généalogie, et le dernier Foucault cherche à fonder une éthique à partir de sa généalogie).
En 1975, Foucault annonce qu'on ne peut plus faire de la généalogie de la même manière car le combat n'est plus le même que dans les années soixante, les rapports de force ont changé. Deux dangers guettent les généalogies : la récupération par l’institution, et la création d’une idéologie. À mesure que les savoirs généalogiques se sont multipliés, la hiérarchie des connaissances est devenue plus perméable. Il y a une tendance de l’institution à récupérer et intégrer en pacifiant ce que l'archéologie met en lumière. Cette intégration et cette pacification des généalogies à l’intérieur du discours unitaire de l’institution désamorce la force de contestation des généalogies et rend donc ces dernières caduques. D'autre part, si les généalogistes eux-mêmes veulent protéger ces fragments d'histoire qu’ils ont mis en lumière, ils s'exposent alors à bâtir un autre type de discours unitaire, ce qui, à terme, ne ferait que remplacer une idéologie par une autre.
Ainsi, plutôt que de chercher à unifier toutes les généalogies dispersées sous un métadiscours qui deviendrait alors une idéologie, Foucault veut seulement chercher à comprendre l'enjeu de l’actualité. Or, l’actualité est marquée par l'opposition entre ces savoirs dispersés (retrouvés par le croisement des généalogies et du savoir des gens) et l'institution. C’est à partir de cette lecture de l’actualité que Foucault a cherché à élaborer une éthique basée sur le souci de soi, éthique que sa mort brutale en 1984 laissera inachevée.
L'enjeu des généalogies est toujours le même, il questionne le pouvoir économique surgi à la fin de la seconde Guerre mondiale : peut-on faire l'analyse des pouvoirs à partir de l'économie ? Foucault montre qu'il y a un point commun entre la conception libérale du pouvoir politique et la conception marxiste : "l'économisme dans la théorie du pouvoir" (p.169). Dans la théorie juridique classique du pouvoir, le pouvoir est un droit que l'on peut transférer, aliéner, et la souveraineté politique se constitue par cette aliénation du pouvoir propre aux individus. L'opération juridique qui modélise cette aliénation, c'est l'échange contractuel. Il y a donc, derrière cette théorie du pouvoir, l'idée d'une analogie entre pouvoir et richesse (biens), c'est-à-dire que le pouvoir est pensé selon le modèle de l'échange, de la circulation des biens. Dans la conception marxiste du pouvoir, il y a ce que Foucault appelle “la fonctionnalité économique du pouvoir”, c'est-à-dire que le pouvoir est pensé comme ce qui maintient les rapports de production et la domination de classe. En d'autres mots, la finalité du pouvoir politique c'est l'économie, c'est-à-dire le capital.
Donc l'enjeu de l'archéologie pose plusieurs problèmes :
- Le pouvoir a-t-il comme finalité de servir l'économie ? (= Subordination fonctionnelle).
- Le pouvoir est-il similaire à une marchandise ? C'est-à-dire un pouvoir qui se possède, qui se cède, qui se perd, qui se récupère, bref quelque chose qui circule (= isomorphie formelle).
Or, Foucault essaie de dégager un autre rapport qui unirait le pouvoir et l'économique. Pour faire une analyse non économique du pouvoir, il faut poser plusieurs choses :
- Le pouvoir ne se donne pas mais s'exerce, c'est-à-dire que le pouvoir est un acte, c'est ce qui réprime. L'analyse du pouvoir doit donc être l'analyse des mécanismes de répression.
- Le pouvoir n'est pas le maintien des relations économiques, le pouvoir est un rapport de force. Il ne faut donc pas faire l'analyse du pouvoir en termes de contrat, mais en termes de combat.
Foucault montre qu'on peut tirer trois conclusions de ces remarques :
- Les rapports de pouvoir en tant que rapports de force peuvent être localisés historiquement sous la figure de la guerre. Et la politique reconduit la défaite des vaincus, mais sous la forme d'une guerre silencieuse, c'est-à-dire dans l'institution, dans les inégalités économiques, dans le langage, dans les corps (p.171).
- Les luttes politiques ne sont que la continuation de la guerre elle-même.
- La décision finale ne peut venir que de la guerre, donc d'une épreuve de force. De sorte que la fin du politique serait la dernière bataille.
Donc Foucault remarque que dès qu'on essaie d'analyser le pouvoir sans s'appuyer sur les modèles économistes, on est devant deux hypothèses massives : le mécanisme du pouvoir, c'est la répression ; et l'origine des rapports de pouvoir, c'est l'affrontement.
Ce qui conduit à opposer deux grands types d'analyse du pouvoir :
- Le modèle contrat-oppression (= schéma juridique)
Le pouvoir comme droit originaire que l'on cède et qui circule sous la forme du contrat. Donc un pouvoir qui, lorsqu'il ne respecte pas le contrat, risque de devenir une oppression (XVIIIe siècle). Le pouvoir est ici un abus et fait intervenir l'opposition du légitime et de l'illégitime. - Le modèle guerre-répression
Le pouvoir comme ce qui trouve son origine dans la guerre. De sorte que la répression est la poursuite d'un rapport de domination. Le pouvoir est ici un effet et fait intervenir l'opposition entre lutte et soumission.
Dans ses recherches, Foucault a essayé de dégager le schéma guerre-répression. Mais alors qu'il donne son cours “Il faut défendre la société”, il reconsidère ce schéma, jusqu'à soutenir en 1977 qu'il faut l'abandonner, l'étude des généalogie révélant que les mécanismes du pouvoir sont autre chose que de la répression.
14 janvier 1976
De 1970 à 1975, Foucault étudie les mécanismes du pouvoir à travers les règles de droit qui délimitent le pouvoir, et à travers les effets de vérité que ce pouvoir produit. Il cherche à localiser le type de pouvoir qui a la capacité de produire des discours de vérité. La question l'intéresse car il estime qu'il y a un type de discours qui a des effets puissants sur l'ensemble de la société : le discours vrai. Le discours vrai est ce qui dans une société fait le partage entre ceux qui prennent la parole et ceux qui ne peuvent pas, et entre ce qui va recevoir une écoute et ce qui ne va pas être écouté. Et de 1970 à 1975, Foucault s'intéresse aux règles de pouvoir et au pouvoir des discours vrais.
Un principe général a guidé ses recherches, c'est le fait que depuis le Moyen-Âge, la pensée juridique a été l'instrument et la justification du pouvoir royal. Foucault remarque que ce dont il est question, au cœur même de tout l'édifice juridique occidental, c'est du pouvoir royal. Soit le droit cherchait à montrer comment le roi était le corps vivant de la souveraineté, à montrer la légitimité du roi à être roi. Soit le droit cherchait à limiter le pouvoir de la souveraineté en le soumettant à des règles de droit, c'est-à-dire en faisant de la soumission du souverain à des règles, le principe même de sa légitimité à exercer son pouvoir. Or, faire de la souveraineté le problème central du droit, c'est permettre au discours du droit de masquer la domination, pour faire apparaître à la place le droit légitime de la souveraineté et l'obligation légale de l'obéissance du souverain.
Le droit a donc cherché à faire disparaître le fait de la domination. Foucault veut inverser cette analyse traditionnelle du droit, et montrer que le droit est l'instrument de la domination. Mais plus encore, que le droit (et d'une manière générale l'ensemble des appareils étatiques) met en œuvre des rapports de domination et non des rapports de souveraineté.
La souveraineté est un pouvoir central qui exerce une domination globale sur les sujets. La domination est un jeu de pouvoir qui traverse l'intérieur de la société, et qui assujettit les individus les uns aux autres. Le droit ne fixe donc pas une légitimité, mais assujettit. Donc ce que cherche à faire Foucault, c'est de remplacer dans l’analyse le couple souveraineté-obéissance, par le couple domination-assujettissement.
Pour produire cette analyse, Foucault définit sa méthode selon cinq axes :
- Repérer les instruments du pouvoir dans ses formes les plus locales : les supplices, l'emprisonnement. Et ne pas chercher à faire une analyse du pouvoir en tant qu'objet conceptuel.
- Étudier le pouvoir à travers ses pratiques réelles, et ne pas chercher à repérer une intentionnalité propre au pouvoir.
- Étudier le pouvoir comme quelque chose qui circule entre les individus, et non comme quelque chose qui s'applique à eux. En d'autres mots, le pouvoir ce n'est pas quelque chose qu'on possède comme un bien, mais une force qu'on met en œuvre. Donc le pouvoir constitue l'individu, et Foucault le dit en ces termes : “l'individu est un effet du pouvoir”, et il est, par suite, un relais du pouvoir. L'individu n'est donc pas un être neutre contre lequel viendrait frapper le pouvoir (il n’y a pas “le pouvoir”, il y a “des jeux de pouvoir”).
- Ce n'est pas parce que le pouvoir traverse tous les individus qu'il est la chose la mieux partagée. Il faut partir des mécanismes de pouvoir les plus discrets, faire leur histoire, et voir comment ces mécanismes de pouvoir sont étendus par des mécanismes de plus en plus généraux. Car ce n'est pas la domination globale qui se pluralise et se répercute juste en bas. Ce sont toujours des mécanismes de pouvoir au niveau les plus bas, qui s'étendent et qui sont récupérés par des pouvoirs généraux qui les reprennent à leur compte.
Il y a des conjonctures qui font que des mécanismes de pouvoir, dont les agents sont, non pas l'institution mais la famille, les médecins, le plus bas degré de la police, deviennent soudain profitables d'un point de vue économique et utile d'un point de vue politique. C'est dans ce genre de conjoncture que l'État en vient à investir et recoder ces mécanismes de pouvoir (la bourgeoisie du XIXe siècle ne s'est pas intéressée aux fous, mais au pouvoir qui portait sur les fous). - A la base des processus de pouvoir, il n'y a pas d'idéologie, mais des instruments et des techniques d'observation, c'est-à-dire des appareils de vérification. Ce savoir qui se forme en même temps que les mécanismes de pouvoir n'est pas une idéologie.
Foucault veut donc analyser les formes de domination, et non pas la souveraineté, donc analyser les processus de l'assujettissement, et les dispositifs de savoir, et pas le fonctionnement de l'État et de son idéologie. Pour analyser le pouvoir, il faut cesser de s'appuyer sur la théorie juridico-politique de la souveraineté, car elle nous empêche de faire une véritable analyse du pouvoir. La théorie de la souveraineté produit une analyse du pouvoir allant du pouvoir du souverain jusqu'aux individus ayant le moins de pouvoir. C'est-à-dire que la souveraineté a été décrite comme couvrant tout le corps social, de sorte que l’analyse du pouvoir était toujours construite autour du couple souverain-sujet.
Or, au XVIIIe siècle, on voit apparaître une nouvelle mécanique de pouvoir incompatible avec le couple souverain-sujet : le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est un pouvoir non-souverain. Il porte sur les corps et non sur les produits du travail lui-même (p.180). Le pouvoir disciplinaire cherche le minimum de dépense et le maximum d'efficacité, alors que la souveraineté pense un pouvoir absolu et une dépense absolue du pouvoir. C’est, selon Foucault, le pouvoir disciplinaire qui a permis la mise en place du capitalisme industriel.
Mais le pouvoir disciplinaire n’a pas pour autant évincé et remplacé l'édifice juridique de la souveraineté. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit, car la théorie de la souveraineté a continué à exister comme idéologie du droit, et cela pour deux raisons :
- La théorie de la souveraineté a été au XVIIIe et XIXe siècles un instrument critique contre la monarchie et contre ce qui s'opposait au développement de la société disciplinaire.
- La théorie de la souveraineté a permis de masquer les mécanismes du pouvoir disciplinaire par un système de droit, afin d'effacer la domination qu'exerçait la discipline, et faire croire aux individus qu'ils exerçaient leurs droits souverains précisément à travers la souveraineté de l'État.
Pour le dire autrement, l'édifice juridique de la souveraineté a permis une démocratisation de la souveraineté alors même que les droits des individus se trouvaient dans l'incapacité de fonctionner correctement, précisément à cause des mécanismes de coercition disciplinaire. En somme, la théorie de la souveraineté a servi à cacher les mécanismes de domination du pouvoir disciplinaire.
On a donc du XIXe siècle à nos jours, une organisation du droit articulée autour du principe de la souveraineté du corps social, et en même temps une forte coercition disciplinaire. Or, la coercition disciplinaire ne peut pas se transcrire dans le principe de la souveraineté du corps social. C'est précisément entre un droit de la souveraineté et une coercition disciplinaire que se joue l'exercice du pouvoir (entre l'unité du droit et la multiplicité des disciplines).
Le discours de la discipline est étranger à celui de la loi. Les disciplines portent un discours de la règle, pas de la règle juridique, mais de la règle naturelle, c'est-à-dire de la norme. Les disciplines définissent un code qui n'est pas celui de la loi, mais celui de la normalisation, et ont donc comme horizon théorique les sciences humaines. Ce qui a donc rendu possible le discours des sciences humaines, c'est l'affrontement de deux mécanismes hétérogènes : l'organisation du droit autour de la souveraineté et la coercition disciplinaire. Cet envahissement du droit par les techniques disciplinaires, c'est ce que Foucault appelle la société de normalisation.
Mais l'incompatibilité entre la normalisation disciplinaire et le système juridique de la souveraineté, a rendu nécessaire une sorte de discours-arbitre scientifiquement neutre. C'est, selon Foucault, précisément du côté de la médecine qu'on voit apparaître cet arbitrage.
Donc, contre cette montée d'un pouvoir lié au savoir scientifique, le seul recours que nous ayons, c'est le retour à un droit organisé autour de la souveraineté. De fait, quand les magistrats veulent s’opposer aux mécanismes disciplinaires, ils invoquent le droit formel et bourgeois, qui n'est rien d'autre que le droit de la souveraineté.
Or, Foucault affirme qu'on ne peut continuer à fonctionner ainsi, et qu'il faut sortir de cette impasse. Car, dit-il, ce n'est pas en recourant à la souveraineté contre la discipline qu'on pourra limiter les effets du pouvoir disciplinaire, car souveraineté et discipline sont au fondement même des mécanismes de pouvoir dans notre société. Donc pour lutter contre les disciplines, il ne faut pas rehausser l'ancien droit de la souveraineté, mais créer un nouveau droit anti-disciplinaire et affranchi du principe de la souveraineté. Voilà pourquoi la notion de répression est incorrecte : elle est encore une notion juridico-disciplinaire.
21 janvier 1976
Pour une théorie de la domination et non de la souveraineté
Donc, le modèle juridique de la souveraineté n'est pas adapté pour analyser les rapports de pouvoir. La théorie de la souveraineté cherche à constituer un cycle :
- Le cycle du sujet au sujet : la théorie de la souveraineté cherche à montrer comment un sujet devient sujet dans un rapport d'assujettissement au pouvoir (= la théorie de la souveraineté présuppose le sujet).
- Le cycle du pouvoir et des pouvoirs : la théorie de la souveraineté cherche à montrer comment la multiplicité des pouvoirs politiques ne peut fonctionner qu'à partir de cette unité de pouvoir fondée par la théorie de la souveraineté (= la théorie de la souveraineté vise à fonder l'unité du pouvoir).
- Le cycle de la légitimité et de la loi : la théorie de la souveraineté cherche à montrer comment le pouvoir du souverain se constitue selon une légitimité plus fondamentale que toutes les lois (= la théorie de la souveraineté est toujours plus légitime que la loi).
Donc, la théorie de la souveraineté assujettit le sujet, fonde l'unité du pouvoir, et oblige à respecter sa légitimité. Le projet général de Foucault est de sortir de cette analyse, et d’analyser les rapports de domination et non l'élément de la souveraineté. Faire une théorie de la domination plutôt qu'une théorie de la souveraineté, ça veut dire :
- Ne pas partir du sujet, mais partir de la relation de domination dans ce qu'elle a d'effectif. Donc, ne pas chercher à savoir pourquoi le sujet accepte de se laisser assujettir, mais chercher à montrer comment ce sont les relations d'assujettissement qui fabriquent des sujets.
- Ne pas chercher une sorte de souveraineté source des pouvoirs, mais montrer comment les grands appareils de pouvoir s'appuient les uns sur les autres.
- Ne pas chercher la source de la légitimité de la souveraineté, mais chercher les instruments techniques qui permettent d'assurer les rapports de domination.
Donc, plutôt que de faire la genèse du souverain, il faut chercher à montrer la fabrication des sujets :
- Plutôt que de partir du sujet, il faut prendre le point de vue des effets d'assujettissement que produisent les techniques.
- Plutôt que de partir de l'unité du pouvoir, il faut prendre le point de vue de l'hétérogénéité des techniques.
- Plutôt que de partir de la loi, il faut prendre le point de vue des techniques.
Avec une telle analyse, le rapport de pouvoir semble un rapport de guerre, et les appareils d'État semblent n'être que la reconduction permanente d'une guerre primitive. Ce que l'on peut traduire par "la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens".
La guerre comme relation sociale permanente
Avec le développement des États, les institutions de guerre se sont concentrées de plus en plus entre les mains d'un pouvoir central, ce qui a eu plusieurs conséquences :
- Seuls les pouvoirs étatiques possèdent assez de ressources pour engager des guerres. Il y a donc étatisation de la guerre.
- La guerre s'est effacée du corps social, pour n'exister qu'aux frontières, c'est-à-dire avec les autres pays.
- L’État se dote d'institutions militaires à la fin du Moyen-Âge.
Le paradoxe, c'est que lorsque la guerre s'est trouvée expulsée aux frontières de l'État, à la fin des guerres civiles et religieuses du XVIe siècle, un nouveau discours est apparu : le premier discours historico-politique sur la société. Ce discours entend la guerre comme une relation sociale permanente.
Ce discours a été immédiatement ambigu puisqu’en Angleterre il a été un instrument de lutte des bourgeois contre la monarchie, en France il a été utilisé dans des luttes politiques aristocratiques contre la monarchie absolue, et on le retrouve à la fin du XIXe siècle chez des biologistes eugénistes et racistes.
Contrairement à la théorie philosophico-juridique, ce discours dit que l'État ne met pas fin à la guerre, mais poursuit la guerre par des moyens politiques : C’est toujours la guerre qui a présidé à la naissance des États. Donc, la loi naît de batailles avec des vainqueurs et des vaincus. Mais la loi et l'État ne sont pas pacification, car sous la loi, la guerre continue dans les mécanismes du pouvoir. En somme, c'est la guerre qui est le moteur des institutions et de l'ordre. Il faut donc déchiffrer la guerre sous la paix. Il n'y a pas de sujet neutre, on est toujours l'adversaire de quelqu'un.
Le discours de la guerre perpétuelle : premier discours historico-politique
Ainsi, à la description pyramidale que le Moyen-Âge donnait du corps social, s'oppose une nouvelle conception binaire de la société. Il y a deux catégories d'individus, comme deux armées qui se font la guerre. Et sous les mensonges qui essaient de nous faire croire que le corps social est commandé par des nécessités de nature et des exigences fonctionnelles, il faut retrouver la guerre, parce que la guerre n'est pas terminée, et nous ne pourrons pas terminer la guerre par une pacification, par une réconciliation, nous ne pourrons la terminer que par une victoire.
Ce discours est important car c'est le premier discours historico-politique depuis le Moyen-Âge. Effectivement, le sujet qui parle ne cherche pas à occuper la position du juriste ou du philosophe, c'est-à-dire la position du sujet universel. Dans cette lutte, il est forcément d'un côté ou de l'autre : il a des adversaires. Il tient le discours du droit, mais ce qu'il réclame, ce sont ses droits ("c'est nos droits" dit-il : le droit de sa famille, de sa race, de sa supériorité, de l'antériorité). C'est un droit ancré dans une histoire et décentré par rapport à une universalité juridique.
De même, le sujet parle d'une vérité, mais ce n'est plus la vérité universelle du philosophe. Cette vérité est toujours en perspective, à partir de sa position de combat, à partir de la victoire cherchée. L'appartenance de la vérité à la paix était constitutive de la philosophie grecque, alors que dans ce type de discours, on dira d'autant mieux la vérité que l'on est dans un camp. C'est l'appartenance à un camp qui va permettre de dénoncer les illusions par lesquelles on vous fait croire que le monde est ordonné et pacifié. De sorte que "Plus je me décentre, plus je vois la vérité. Plus je me bats, plus effectivement la vérité va se déployer devant moi". Et inversement, la vérité n'est cherchée que dans la mesure où elle pourra devenir une arme dans le rapport de force. Donc, la vérité est un plus de force, et elle ne se déploie qu'à partir d'un rapport de force.
Le rôle de celui qui parle n'est donc pas le rôle du législateur ou du philosophe. Il s'agit plutôt de poser un droit singulier :
- Le sujet qui parle est un sujet qui est en guerre.
- Ce discours renverse les valeurs traditionnelles de l'intelligibilité, car il postule une explication par le bas. C'est le hasard, la confusion et la violence qui sont l'ordre de la société et son principe de déchiffrement. C'est donc à la fureur de rendre compte du calme et de l'ordre (contre l'étonnement philosophique grec, Nietzsche prône la stupeur). Et c'est au-dessus de cette violence que le pouvoir va bâtir une rationalité croissante, et maintenir la victoire sous la forme de rapports de domination par des stratégies et des ruses.
Dans ce schéma d'explication, la raison est du côté de la ruse, de la méchanceté et de l’illusion, du côté des vainqueurs. La vérité est du côté de la déraison et de la brutalité, du côté des vaincus. C'est donc tout le contraire du discours explicatif du droit et de l'histoire jusque-là. - Ce discours se développe dans la dimension historique. Il ne s'agit pas de juger les gouvernements injustes en les référant à un certain schéma idéal (comme la loi naturelle, la volonté de Dieu, les principes fondamentaux), il s'agit, au contraire, de découvrir sous les formes du juste, tel qu'il a été institué, le passé oublié des luttes réelles. Il faut donc retrouver sous la stabilité du droit, l'infini de l'histoire ; sous l'équilibre de la justice, la dissymétrie des forces.
- C'est un discours qui prend aussi appui sur des formes mythiques traditionnelles (l'âge perdu des grands ancêtres, l'imminence des temps nouveaux, la venue du nouveau royaume). C'est ainsi qu'on va retrouver le thème de la guerre perpétuelle, le grand espoir du jour de la revanche, l'attente du nouveau chef, du nouveau guide, du nouveau Führer.
Donc, ce discours de la guerre perpétuelle n'est pas que l'invention d'intellectuels, mais joint les pulsions mythiques, ainsi que les revanches populaires.
C'est donc le premier discours historico-politique de l'Occident. Dans ce discours, la vérité fonctionne comme arme pour une victoire partisane. C’est un discours critique, mais aussi un discours mythique : celui des amertumes et des fous espoirs.
A noter que pour les philosophes et les juristes, c'est un discours extérieur, ce n'est même pas le discours de l'adversaire car on ne discute pas avec lui, donc c'est un discours forcément disqualifié.
Ce discours a commencé à la fin du XVIIe siècle à propos de la double contestation, populaire et aristocratique, du pouvoir royal. Puis il a proliféré jusqu'au XXe siècle.
On peut d’ailleurs comprendre la dialectique hégélienne comme la pacification par l'ordre philosophique de ce discours amer et partisan de la guerre fondamentale.
Pour mener cette étude, il faut :
- Écarter les fausses paternités : ce discours historico-politique n'est ni celui du Prince de Machiavel ni celui de la souveraineté absolue de Hobbes.
- Situer son émergence : au XVIIe siècle en Angleterre dans les revendications populaires et petites bourgeoises (les puritains et les niveleurs), en France chez les aristocrates contre Louis XIV.
- Montrer sa spécificité au XIXe siècle :
- La lutte des races (théorie qui s'articule sur les mouvements nationalistes européens)
- La lutte des classes (elle s'articule à partir de la théorie de la guerre sociale. La guerre sociale efface le conflit de race pour se définir comme lutte de classe)
Le discours de la lutte des races était au XVIIe siècle un instrument de lutte, mais va devenir au XXe siècle, le discours du pouvoir. Ce discours dira alors que le pouvoir représente la race titulaire de la norme, et que cette race doit mener la guerre contre les races qui dévient de cette norme, car elles sont un danger pour le patrimoine biologique. C'est donc un discours biologico-raciste d'élimination, de ségrégation et de normalisation de la société. Ce discours qui disait originellement "nous devons nous défendre contre la société", va à présent dire "il faut défendre la société contre les périls biologiques de cette sous-race que nous constituons malgré-nous".
La thématique raciste va alors, non plus apparaître comme instrument de lutte d'un groupe social contre un autre, mais va servir à la stratégie globale des conservatismes sociaux. Il va donc apparaître un racisme d'État, ce qui est un paradoxe par rapport à la forme première de ce discours. Le racisme d'État, c'est un racisme qu'une société va exercer sur elle-même, sur ses propres éléments. Ce racisme interne de la purification permanente sera l'une des dimensions fondamentales de la normalisation sociale.
28 janvier 1976
Le discours raciste n’a été qu’un épisode particulier et localisé de ce grand discours de la guerre. Le discours raciste, c'est la reprise à la fin du XIXe siècle du discours de la guerre des races en des termes socio-biologiques à des fins de conservatisme social et de domination coloniale.
Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, avant qu'il ne se retourne en un discours raciste, ce discours de la guerre des races a fonctionné comme une contre-histoire, car le discours historique a longtemps fonctionné comme une justification et un renforcement du pouvoir.
Des premiers analystes romains jusqu'au XVIIe siècle, l'histoire a eu un double rôle, celui de lier et d'éblouir :
- La force de la loi : lier juridiquement les hommes par la continuité du pouvoir
- L'éclat de la gloire : fasciner les hommes par l'intensité des exploits du pouvoir
On retrouve cette double fonction (lier et éblouir) du discours historique comme intensification du pouvoir, déjà au Moyen-Âge :
- La généalogie
On raconte l'Antiquité des royaumes, les exploits des héros fondateurs et l'ancienneté du droit. Le but est de cautionner la valeur du présent et de transformer la quotidienneté en quelque chose d'héroïque et de juste. - La mémoire
Il y a un enregistrement permanent de l'histoire dans les annales et les chroniques tenues au jour le jour : ça montre que tout ce que font les souverains n'est jamais inutile ou petit. Tout ce qu'ils font mérite d'être dit et d’être gardé en mémoire. Chaque geste d'un roi est un exploit. L'histoire rend mémorable, et on rend indéfiniment présent cette mémoire dans des monuments. - L'exemple
Mise en circulation des exemples. L'exemple, c'est la loi vivante, il permet de juger le présent à une loi plus forte que lui.
Ces deux fonctions, lier et éblouir, correspondent aux deux aspects du pouvoir dans les religions, les rituels et les mythes. L'aspect juridique : le pouvoir lie par l'obligation, par le serment. Et l'aspect magique : le pouvoir éblouit, pétrifie.
L'histoire c'est le discours du pouvoir :
- Le discours des obligations par lesquelles le pouvoir soumet (il lie les individus)
- Le discours de l'éclat par lequel le pouvoir fascine, terrorise (il immobilise les individus)
On peut donc dire que l'histoire a été longtemps dans notre société l'histoire de la souveraineté. Et c'est précisément au XVIIe siècle que le discours historique ne va plus être le discours de la souveraineté, ni le discours de la race, mais va devenir le discours des races, c'est-à-dire de la lutte des races à travers les nations et les lois. C'est la première histoire anti-romaine que l'Occident a connue. Cette histoire est anti-romaine pour plusieurs raisons :
- Dans cette histoire de l'affrontement des races, l'identification entre la nation et son souverain que l'histoire de la souveraineté faisait apparaître, disparaît. Désormais, la souveraineté ne lie pas, elle asservit. Et au principe d'homogénéité qui disait que l'histoire des forts emporte avec elle l'histoire des faibles, va se subsister un principe d'hétérogénéité : l'histoire des uns n'est pas l'histoire des autres. En d'autres mots, la victoire des uns, c'est toujours la défaite des autres. Ce qui est loi et obligation du côté du pouvoir, devient du côté du nouveau discours abus et violence.
La loi apparaît alors comme une réalité à double face : triomphe des uns, soumission des autres. - L'histoire de la lutte des races est une contre-histoire. Elle dissocie l'unité de la loi souveraine mais, plus encore, elle brise la continuité de la gloire. La lumière du pouvoir n'éblouit pas le corps social tout entier, mais ne l'éclaire que d'un côté et le laisse dans l'ombre de l'autre. Et la contre-histoire va précisément parler à partir de cette ombre, et être le discours de ceux qui n'ont pas de gloire.
Ce discours va être une prise de parole irruptive, un appel, à la différence du chant ininterrompu du pouvoir : "nous n'avons pas, derrière nous, de continuité. Nous n'avons pas, derrière nous, la grande et glorieuse généalogie où la loi et le pouvoir se montrent dans leur force et dans leur éclat. Nous sortons de l'ombre, nous n'avions pas de droits et nous n'avions pas de gloire, et c'est précisément pour cela que nous prenons la parole et que nous commençons à dire notre histoire". Et ce contre-discours va alors énumérer les défaites bien plus que les victoires. - Ce nouveau discours de la guerre des races est plus du côté mythico-religieux de la Bible que du côté politico-légendaire romain. Il ne faut pas oublier que la Bible a été, dès la moitié du Moyen-Âge, la grande forme dans laquelle se sont articulées les objections religieuses, morales, politiques, au pouvoir des rois et au despotisme de l'Eglise. La Bible a été l'arme de la misère et de l'insurrection. Elle a été la parole qui soulève contre la loi injuste des rois, et contre la gloire de l'Eglise. Il n'est donc pas étonnant que cette contre-histoire se soit articulée sur la grande forme biblique de la prophétie et de la promesse.
Dans l'histoire de type romain, la mémoire avait comme fonction d'assurer le non-oubli (= maintien de la loi et de l'éclat du pouvoir). Au contraire, la nouvelle histoire va chercher à déterrer quelque chose qui a été caché (les lois se trompent, les rois se masquent, les historiens mentent). Ce n'est donc plus une histoire de la continuité, mais une histoire du déchiffrement. - Cette histoire de la lutte des races est aussi une contre-histoire, car elle dit que le pouvoir est injuste tout simplement parce qu'il n'est pas à nous.
Le discours historique de type romain justifie le pouvoir et fonde l'ordre. Au contraire, ce nouveau discours historique de type biblique déchire la société et ne parle de droit que pour déclarer la guerre aux lois.
Cette contre-histoire est celle de la servitude, de la prophétie, du savoir secret à retrouver, et aussi celle de la déclaration simultanée des droits et de la guerre. On est ainsi passé d'une organisation ternaire de la société, à une perception binaire : d'un côté les injustes, de l'autre les justes. On pourrait presque dire que l'Antiquité se termine quand apparaît le grand discours sur l'histoire de la lutte des races.
Quelques remarques :
- Il serait faux de croire que ce discours de la lutte des races appartient totalement aux opprimés. C'est un discours qui a un grand pouvoir de circulation, une grande aptitude à la métamorphose (mouvements populaires à la fin du Moyen-Âge, aristocratie au XVIIe siècle, projet post-révolutionnaire au XIXe siècle, disqualification des sous-races colonisées à la fin du XIXe et au XXe.)
- Dans ce discours de la guerre des races, le mot "race" n'a pas un sens biologique, il désigne un certain clivage historico-politique. Il y a deux races lorsque deux groupes n'ont pas à l'origine la même langue ou la même religion, ou encore lorsqu'ils ne forment une unité qu'au prix de guerres. Et enfin, il y a deux races lorsqu'il y a deux groupes qui, malgré leur cohabitation, ne se sont pas mélangés à cause de différences qui sont dues aux privilèges, aux coutumes, à la répartition des fortunes, et au mode d'exercice du pouvoir.
- On peut situer les moments féconds, dans la Constitution du savoir historique en Europe, aux interférences entre l'histoire de la souveraineté et l'histoire de la guerre des races. (≈ période de crise avant un changement de paradigme).
- C'est du côté de l'histoire-revendication que s'est placé le discours révolutionnaire. Effectivement, que signifierait le projet révolutionnaire sans ce déchiffrement des injustices et des violences, et sans la volonté de réactiver cette guerre dans un savoir précis, savoir qui fonctionne comme élément tactique à l'intérieur de la guerre réelle que l'on mène.
On a donc quitté au XVIIe siècle une société dont la conscience historique était encore de type romain, pour entrer dans une société de type moderne. C'est-à-dire une société dont la conscience historique n'est pas centrée sur la souveraineté et le problème de sa fondation, mais sur la révolution, ses promesses et ses prophéties d'affranchissement futurs.
Sur le racisme
C’est ainsi qu’au milieu du XIXe siècle, le discours est devenu un nouvel enjeu. La lutte des races s’est trouvée remplacée par la lutte des classes. Et en même temps que s’est formée une contre-histoire de type révolutionnaire, il s'est formé une autre contre-histoire de type biologico-médical. Et c'est ainsi que l'on voit apparaître le racisme :
- Le thème de la guerre historique sera remplacé par le thème biologique de la lutte pour la vie. Non plus la bataille au sens guerrier, mais la lutte au sens biologique : différenciation des espèces, maintien des races les mieux adaptées…
- Le thème de la société binaire partagée entre deux races va être remplacé par le thème d'une société biologiquement moniste menacée par un certain nombre d'éléments hétérogènes.
- Le thème de l'État injuste va se transformer en thème de l'État protecteur de l'intégrité, de la supériorité et de la pureté de la race. En d'autres mots, l'idée de la pureté de la race va se substituer à l'idée de la lutte des races.
Le racisme, c'est le discours révolutionnaire, mais à l'envers. Ça a été une manière de retourner l'arme qu'était le discours de la race au profit de la souveraineté de l'État. L'État a fait de ce discours raciste, une alternative et un barrage à l'appel révolutionnaire.
Ce racisme a subi au XXe siècle deux transformations :
- La transformation nazie : transformation dramatique et théâtrale de la lutte des races
- La transformation soviétique : transformation scientiste de la lutte des races
Pour conclure, le discours de la lutte des races nous a détachés d'une conscience historico-juridique centrée sur la souveraineté, et nous a faits entrer dans une forme d'histoire où la question du pouvoir ne peut plus être dissociée de celle des servitudes. Ce qui caractérise notre conscience historique, c'est cette question :"qu'y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit l'appel ou la peur de la révolution ?".
4 février 1976
Mon problème est de savoir comment est apparu en Occident une analyse critique, historique et politique de l'État.
Sur Hobbes
C'est avec Hobbes que la guerre est apparue comme principe d'analyse des rapports de pouvoir. Hobbes ne place pas seulement la guerre de tous contre tous à la naissance de l'État, mais il la voit menacer encore après la constitution de l'État. Il pose ainsi deux questions :
- Qu'est-ce que cette guerre que l'État est destiné à faire cesser ?
La guerre primitive de tous contre tous est une guerre d'égalité. Elle naît de l'égalité de tous. S'il y avait des différences marquées entre les hommes, il n'y aurait pas de guerre. Soit le rapport de force serait fixé à jamais par une guerre initiale, soit le rapport de force resterait virtuel par la peur de se battre des faibles. Donc la différence pacifie. Mais puisqu'il n'y a pas de grandes différences entre les hommes, le faible ne renonce jamais et le fort n'est jamais assez fort pour ne pas être inquiet.
Dans l'état de guerre primitive de Hobbes, ce qui s'affronte ce ne sont pas des armes, mais des représentations, des signes, des ruses. On n'est pas réellement dans la guerre, mais dans ce que Hobbes appelle "l'état de guerre". Et cet état de guerre n'est pas un stade que l'homme abandonnerait le jour où l'État naîtrait, c'est au contraire un fond permanent. - Comment cet état de guerre va-t-il engendrer l'État ?
Ce qui fait entrer dans l'ordre de la souveraineté, c'est la volonté de préférer sa vie à la mort. Pour qu'il y ait souveraineté, il suffit que soit présente une certaine volonté radicale qui fait qu'on veut vivre quoi qu’il en coûte. Cette volonté est liée à la peur. La souveraineté ne se forme jamais par en haut, c'est-à-dire par une décision du plus fort, du vainqueur, ou des parents. La souveraineté se forme toujours par en dessous, par la volonté de ceux qui ont peur. Peu importe qu'on soit vaincu ou non, peu importe que ce soit une souveraineté d'acquisition ou une souveraineté d'institution, car la souveraineté est toujours formée par la volonté de ceux qui ont peur. De sorte que la Constitution de la souveraineté ignore la guerre, car, qu'il y ait guerre ou pas, cette constitution se fait de la même façon.
En fait, ce que Hobbes a voulu éliminer, c'est l'utilisation politique d'un certain savoir historique concernant les guerres, les pillages, les dépossessions, ainsi que les effets de ces guerres dans les lois et dans les institutions. L'invisible adversaire du Léviathan, c'est la conquête. Et Hobbes semble dire : "conquête ou accord, c'est la même chose, c'est vous qui avez constitué la souveraineté qui vous représente. Ne vous ennuyez plus avec vos recasements historiques, au bout de la conquête vous trouverez encore le contrat : la volonté apeurée des sujets".
Donc Hobbes peut paraître scandalisé, mais en fait il rassure, car il tient toujours le discours du contrat et de la souveraineté, c'est-à-dire le discours de l'État. Bien sûr, on lui a reproché de trop donner à cet État, mais pour le discours philosophico-juridique, il vaut mieux trop donner à l'État que ne pas lui donner assez.
L'historicisme politique est l’adversaire du discours philosophico-juridique
Dans le discours de la guerre des races, ce qu'on trouve en substance, c'est que toute forme de pouvoir peut être analysée en termes de domination. Toute loi, tout type de pouvoir, doivent s'analyser comme le mouvement indéfini des rapports de domination des uns sur les autres. Et, par conséquent, la révolte se justifie comme une sorte de nécessité de l'histoire. C'est précisément "l'historicisme politique" qui est le grand adversaire de Hobbes, et qui est, d’une manière générale, l'adversaire de tout discours philosophico-juridique qui fonde la souveraineté de l'État. L'historicisme politique, c'est ce discours radical qui dit que dès qu'on a affaire à des rapports de pouvoir, on n'est pas dans le droit et on n'est pas dans la souveraineté, on est dans la domination.
L'historicisme politique a rencontré deux obstacles : au XVIIe siècle le discours philosophico-juridique, et au XIXe siècle le matérialisme dialectique.
Ce que je voudrais faire, c'est l'histoire et l'éloge de ce discours de l'historicisme politique.
11 février 1976
Du début du Moyen-Âge à la Renaissance, un récit a circulé en France, il faisait des Français les descendants des Francs, et les Francs les descendants des Troyens, c'est-à-dire des fuyards de Troie au moment de l'incendie de la ville, au même titre que les Romains. Ce récit racontait qu'ils s'étaient d'abord réfugiés en Germanie, puis qu'ils avaient finalement fondé en France leur patrie.
Ce discours a une fonction précise qui n'est pas de raconter les origines, mais plutôt de dire le droit du pouvoir. Ce discours, c'est une leçon de droit public. Dire que les Francs sont comme les Romains, des fuyards de Troie, dire que la France est comme cousine de Rome, c'est dire des choses qui sont politiquement et juridiquement importantes :
- C'est dire que le jour où l'État romain a disparu, c'est la France qui en a hérité. La France succède à l'Empire. Cela veut dire deux choses :
- Le roi de France hérite, sur ses sujets, des droits et des pouvoirs qui étaient ceux de l'empereur romain sur les siens.
- La France a des droits égaux à ceux de Rome. Elle est tout aussi impériale que les autres descendants de l'Empire romain, donc elle ne peut pas être subordonnée à l'Empire allemand et ses grands rêves de monarchie universelle.
- De plus, pour que les Gaulois n'apparaissent pas comme étant toujours sous la subordination d'un Empire, il fallait que la Gaule romaine de la colonisation soit supprimée. Donc que la France soit comme une autre Rome, à la fois Rome et indépendante de Rome.
On dit que ce sont les guerres de Religion qui ont bousculé ces vieilles mythologies et qui ont introduit le thème de la dualité nationale, mais je ne crois pas que ce soit exact. Il existait une thèse germanique qui était l'équivalent de la thèse troyenne qui circulait en France : les Allemands ne sont pas romains mais Germains, mais parce qu'ils ont hérité de la forme impériale, ils sont les successeurs naturels de Rome. Les Francs qui ont envahi la Gaule sont des Germains, et même s'ils sont maintenant en France ils restent des Germains. Par conséquent, ils demeurent à l'intérieur de l'Empire Germain. Et parce qu'ils ont vaincu les Gaulois, ils exercent en tant que Germains, eux aussi, le pouvoir impérial. De fait, la France est sous la subordination de la monarchie universelle des Habsbourg, à la fois par le droit de conquête et par l'origine germanique des Francs.
La discours de François Hotman
Cette thèse va être réintroduite en France au XVIe par François Hotman, et va avoir du succès jusqu'au début du XVIIe siècle. Il reprend la thèse allemande mais introduit une différence fondamentale : il ne dit pas que les Francs ont vaincu les Gaulois, mais qu'ils ont vaincu les Romains.
Cette thèse introduit en France le thème fondamental de l'invasion, thème qui apparaît à la même époque en Angleterre. C'est à partir de ce thème de l'invasion que vont se nouer tous les débats juridico-politiques, de sorte que le grand thème de la généalogie ininterrompue des rois ne va plus pouvoir fonctionner. Le grand problème du droit public va devenir la question de "l'autre suite" : qu'est-ce qui se passe lorsqu'un État succède à un autre État ? Et qu'en est-il alors du droit public et du pouvoir des rois ? Mais à travers ce problème se posait le problème des deux nations étrangères à l'intérieur de l'État.
Le problème de Hotman, c'est la délimitation interne du pouvoir monarchique. L'histoire qu'il raconte fournit un modèle juridique de gouvernement opposé à l'absolutisme romain :
Les Gaulois et les Germains sont à l'origine des peuples frères. Donc pour les Gaulois, les étrangers ne sont pas les Germains, mais les Romains. Ce sont les Romains qui ont imposé par la guerre un régime politique absolutiste : l'Imperium romain. Les Germains sont le peuple frère des Gaulois car ce sont eux qui ont chassé les Romains au Ve-VIe siècle, et par là, libéré les Gaulois. De sorte que Gaulois et Germains ne forment qu'un peuple et partagent donc les mêmes lois de la société germanique : la souveraineté du peuple qui se réunit régulièrement au champ de Mars, qui élit son roi comme il veut, et qui nomme des magistrats aux fonctions temporaires. Et c'est cette Constitution germanique que les rois ont violés pour bâtir leur monarchie absolue.
Dans cette histoire, Hotman raconte en fait son présent : les Romains envahisseurs sont le pape et le clergé, et les Germains libérateurs du mythe se transposent dans la religion réformée venant d'Allemagne, religion soutenue par les protestants qui ont le projet politique d'une monarchie constitutionnelle.
Dans le discours de Hotman, le roi et son peuple auraient eu originellement des droits réciproques, droits qui auraient été par la suite violés et oubliés. Cette thèse d'origine protestante a très vite circulé, et a été reprise par les catholiques dès qu'ils ont cherché une limitation au pouvoir royal.
Pour contourner cette idée de la fondation germanique de la France, il y a eu la mise en place du thème Gallo-centriste radical. À partir du XVIIe siècle, les Gaulois vont devenir le principe premier de l'histoire, et les Germains vont être présentés comme un simple épisode de l'histoire des Gaulois. Dans certaines thèses, les Gaulois sont présentés comme les
pères de tous les peuples d'Europe. De sorte que les Francs qui envahirent la Gaule au IVe et Ve siècle, n'étaient que des Gaulois qui voulaient revoir leur pays. En revenant, ils ont réabsorbé le droit romain implanté en Gaule, et la conversion de Clovis en est la manifestation. Et quand les Francs sont retournés en Gaule, ils ne se sont pas battus contre des Gaulois, mais contre des Goths hérétiques et des Sarrazins incroyants. Pour récompenser les guerriers qui avaient ainsi lutté, les rois leur ont donné des fiefs. Et c'est dans cette guerre que l'origine de la féodalité s'est fixée.
Cette fable permettait d'affirmer le caractère autochtone de la population gauloise, et l'existence des frontières naturelles de la Gaule décrites par César. Ces frontières étaient aussi l'objectif politique de Richelieu et de Louis XIV. Cette fable permettait aussi de dériver les privilèges de la noblesse, non pas de droits fondamentaux de la noblesse, mais de la volonté du roi. Enfin, elle permettait à la France de prétendre à la monarchie universelle.
L’importance de l’histoire dans la théorie du droit public
Le point commun entre le discours anglais et le discours Français sur l'origine de la monarchie, c'est l'invasion. L'invasion est devenue un problème historique, c'est à l'invasion de dire la nature et les limites du pouvoir monarchique, et de dire ce qu'est la noblesse et quels sont ces droits. Bref, c'est à partir d'une l'histoire de l'invasion qu'on formule les principes même du droit public.
À l'époque où Grotius, Pufendorf, Hobbes cherchaient du côté du droit naturel les règles de Constitution d'un état juste, commençait en opposition une énorme enquête historique sur l'origine et la validité des droits effectivement exercés.
L'histoire et le droit public vont de pair. Du XVIIIe siècle au XXe siècle on enseigne l'histoire en racontant le droit public. Encore au XXe siècle, l'histoire de France commençait par l'histoire des Gaulois (histoire que l'on apprenait aux Algériens et aux Africains). Et la phrase "nos ancêtres les Gaulois" a un sens très précis : c'est formuler une proposition qui a un sens dans la théorie du droit constitutionnel et dans les problèmes posés par le droit public. On a cru qu'on apprenait l'histoire, mais au XIXe siècle et encore au XXe siècle, les manuels d'histoire étaient en fait des manuels de droit public.
Le thème du dualisme national
La différence entre le discours anglais et le discours français résidait dans l'homogénéité de la nation. En Angleterre, la dualité raciale Normands/Saxons était le point d'articulation essentiel de l'histoire. En France, en revanche, le corps de la nation est homogène jusqu'au XVIIe siècle. Et c'est cette homogénéité qui va être cassée à la fin du XVIIe siècle par un nouveau discours qui a introduit le thème du dualisme national.
Le thème du dualisme national va apparaître à partir d'un problème de pédagogie politique : que doit savoir le prince ? Cette question se pose au moment de la succession de Louis XIV. Et toute une série de discours vont faire valoir la noblesse, vont critiquer les charges qui pèsent sur la noblesse appauvrie, vont critiquer la dépossession du droit de juridiction de la noblesse. Mais plus encore, il s'agit de protester contre le fait que le savoir du roi est fabriqué par la machine administrative elle-même. L'administration permet au roi d’avoir une volonté sans limite. Mais, inversement, l'administration règne sur le roi par la nature du savoir qu'elle lui impose.
La cible de tous ces historiens du discours pro-noblesse, c'est le mécanisme de savoir-pouvoir qui, depuis le XVIIe siècle, lie l'appareil administratif à l'absolutisme de l'État. La position à gagner par la noblesse, ce n'était pas la faveur du prince, mais le savoir du roi. Il s'agit donc d'un contre-savoir qui va chercher à attaquer le savoir juridique (tribunal, procureur, jurisconsulte, greffier), précisément parce que c'était le savoir juridique qui avait piégé et dépossédé les nobles. De plus, le savoir juridique protégeait le roi en masquant sous la forme du droit son absolutisme et ses vols commis contre la noblesse.
C'est contre ce savoir des greffiers que la noblesse va faire valoir une autre forme de savoir qui sera l'histoire. L'histoire ne sera pas le déroulement imagé du droit public, mais elle va essayer de replacer les institutions du droit public dans un réseau d'engagements plus profond : il s'agit de réveiller des engagements non écrits, de réactiver des thèses oubliées et le sang versé par la noblesse pour le roi. Il s'agit aussi de faire apparaître l'édifice du droit comme le résultat de toute une série d'injustices, de dépossessions, commises par le pouvoir royal à l'égard de la noblesse. L'histoire du droit sera donc la dénonciation des trahisons. L'histoire sera l'arme de la noblesse trahie et humiliée.
L'autre grand adversaire, c'est le bureau. C'est un savoir administratif, surtout économique : savoir des richesses effectives, savoir des impôts supportables et utiles. Contre se savoir des intendants et du bureau, la noblesse veut faire valoir une autre forme de connaissance : une histoire des déplacements des richesses, des exactions, des vols, des détournements, des ruines, et non plus une histoire économique. Une histoire qui montre comment le roi et la bourgeoisie ont ruiné la noblesse. Cette histoire racontera donc comment les nobles se sont ruinés dans des guerres sans fin, comment l'Église s'est fait donner par ruse des terres et des revenus, comment la bourgeoisie a endetté la noblesse, comment le fisc royal a volé les revenus des nobles.
Ces deux grands discours, celui du tribunal et celui du bureau n'ont pas eu la même chronologie. Le discours contre le savoir juridique a été très actif à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Le discours contre le savoir économique est devenu plus violent au milieu du XVIIIe, à l'époque des physiocrates. Mais, dans les deux discours, ce qui est en question, c'est le savoir de l'État, le discours de l’Etat. Et c'est à ce discours que se substitue le nouveau discours historique de la noblesse.
Jusqu'à présent, l'histoire c'était l'histoire du pouvoir par le pouvoir. Mais avec le discours de la noblesse réactionnaire de la fin du XVIIe siècle apparaît un nouveau sujet de l'histoire. Cela veut dire deux choses :
- Nouveau sujet parlant : c'est quelqu'un d'autre qui va raconter l'histoire. Quelqu'un d'autre va réorienter le passé, les droits, les injustices autour de lui-même et de son propre destin.
- Nouveau référentiel : il y a une modification dans l'objet même du récit. On parlera de quelque chose qui passe sous l'État, qui est plus ancien que les institutions.
Le concept de nation
Ce nouveau sujet de l'histoire, qui est à la fois celui qui parle dans le récit historique et ce dont parle ce récit historique, c'est “une société", c'est-à-dire un ensemble d'individus réunis par un statut, des usages et même une loi particulière. Ce quelque chose qui parle dans l'histoire c'est ce que le vocabulaire de l'époque désigne par le mot de "nation". Ce nouveau sujet parlant dans l'histoire, ce n'est donc plus l'État parlant de lui-même, c'est la nation.
La nation, à cette époque, n'est pas quelque chose qui se définirait par l'unité des territoires. La nation est sans frontières, elle est sans État. Les "nations", ce sont les groupements de gens qui ont en commun un statut, des usages, une certaine loi particulière. La noblesse, c'est une nation en face de bien d'autres nations qui circulent dans l'État et qui s'opposent les unes aux autres. C'est de ce concept de nation que va sortir le problème révolutionnaire de la nation et les concepts fondamentaux du nationalisme du XIXe siècle. C'est de là aussi que va sortir la notion de race, et la notion de classe.
Avec ce nouveau sujet de l'histoire, tous les processus qui se passent au niveau des groupes qui s'affrontent sous l'État et à travers la loi, remontent. C'est l'histoire des sombres alliances et des rivalités des groupes, l'histoire des fidélités et des trahisons. C'est une méthode de dénonciation perpétuelle de ce qui a été le mal dans l'histoire.
Du même coup, ce discours nouveau (qui a donc un sujet nouveau et un référentiel nouveau) s'accompagne aussi d'un pathos nouveau. Ce n'est plus le caractère cérémoniel du renforcement du pouvoir, mais un pathos nouveau qui va marquer de sa splendeur une pensée qui sera en grande partie la pensée de droite en France :
- La passion quasi érotique pour le savoir historique
- La perversion systématique d'une intelligence interprétative
- L'acharnement de la dénonciation
- L'articulation de l'histoire sur quelque chose qui sera un complot ou une attaque contre l'État.
Le discours de l’histoire : un instrument de lutte
Ce que j'ai voulu montrer, c'est comment s'était formé autour des fonctionnements du pouvoir un certain instrument de lutte. Cet instrument est un savoir nouveau : cette nouvelle forme de l'histoire. Le rappel de l'histoire est le coin que la noblesse a essayé d'enfoncer entre le savoir du souverain et les connaissances de l'administration. Le discours de l'histoire est donc un instrument de lutte contre l'absolutisme et le savoir-pouvoir administratif. Et c'est pourquoi ce type de discours se retrouvera aussi bien dans la droite que dans la gauche, dans la réaction nobiliaire, ou dans les textes des révolutionnaires d'avant ou d'après 1789.
Le ministère de l’histoire
Ce nouveau savoir historique, en jouant un rôle politique majeur, a attiré l'attention du pouvoir royal qui a cherché à se l'approprier. Et c'est ainsi qu'à partir de 1760, on voit le pouvoir royal essayer d'organiser ce savoir historique en créant des institutions qui sont une sorte de ministère de l'histoire ("bibliothèque des finances" en 1760 qui doit fournir tous types de renseignements aux ministres, "dépôt des chartes" en 1763 pour ceux qui voudraient étudier l'histoire et le droit public en France. Puis ces deux institutions sont réunies en 1781 dans la "bibliothèque de législation, d'administration, histoire et droit public", bibliothèque destinée aux ministres, aux jurisconsultes, aux employés de l'administration).
Le sens de ce ministère de l'histoire est assez clair : à l'époque où le savoir historique était une arme politique contre le savoir administratif de la monarchie absolue, la monarchie a voulu se réapproprier ce savoir. À travers le ministère de l'histoire, ce savoir historique est recodé sous une forme autoritaire, avec pour but d'établir d'une façon contrôlée la tradition ininterrompue de la monarchie.
Mais, de fait, la création du ministère de l'histoire apparaît comme la première concession implicite par le roi qu'il existe quelque chose qui peut se glisser entre son pouvoir et son administration. Et ce quelque chose, ce sera la Constitution, les lois fondamentales, la représentation du peuple. Et c'est précisément à partir de ces matériaux réunis par le ministère de l'histoire, que les États généraux vont être organisés en 1789.
18 février 1976
Le discours de la noblesse a donc introduit un principe d'éclatement dans l'organisation étatique du discours historique : la nation comme sujet-objet de la nouvelle histoire.
Pour comprendre cette nouvelle histoire qui débute au XVIIIe siècle, on peut la comparer avec ce qu'était le problème anglais au XVIIe siècle. En Angleterre, deux grands ensembles se faisaient face, d'un côté la nation normande représentant la monarchie et l'aristocratie, donc un droit de type absolutiste issu des invasions. Et contre cet ensemble, les pauvres et ceux qui n'étaient pas issus de l'aristocratie. Ces derniers revendiquaient le droit Saxon, c'est-à-dire le droit des libertés fondamentales et des premiers occupants. Il s'agissait donc de faire valoir le droit le plus ancien et le plus libéral contre le droit absolutiste issu de l'invasion.
Le problème de la noblesse française du XVIIIe siècle est plus compliqué car elle lutte sur deux fronts. D'une part, contre la monarchie et ses abus de pouvoir, de l'autre contre le tiers état qui profite de la monarchie absolue pour empiéter sur les droits de la noblesse.
Contre l'absolutisme de la monarchie, la noblesse va faire valoir les libertés fondamentales de leurs ancêtres qui ont envahi la Gaule. La noblesse va donc faire valoir les libertés. Et contre le tiers état, la noblesse va faire valoir les droits illimités gagnés grâce à l'invasion.
Donc contre le tiers état la noblesse se présente comme vainqueur absolu dont les droits ne sont pas limités, mais contre la monarchie elle fait valoir un droit constitutionnel qui est celui des libertés fondamentales. D'où la complexité du problème.
Discours historique de Boulainvilliers (discours de la noblesse)
Mais au XVIIIe siècle, le problème n'est plus de savoir si le régime romain ou le régime franc étaient légitimes. Le problème est de comprendre les causes de la grandeur et de la décadence de Rome. Et cette question a un sens très précis, car on fait pour la première fois une analyse de type économico-politique.
Dans ce nouveau discours de la noblesse, on trouve aussi un autre type d'argumentation. On montre que si les Francs ont été plus forts que les Romains, c'est parce qu'ils avaient une aristocratie guerrière, là où les Romains usaient de mercenaires.
De plus, cette aristocratie guerrière choisissait librement son roi. Effectivement, il n'y a qu'au moment des guerres qu'on se donne un chef. Le chef est un chef de guerre qui n'est pas forcément le roi de la société civile. On a donc une société où le pouvoir est minimal, au moins en temps de paix, et par conséquent une société où la liberté est maximale.
Or, cette liberté dont bénéficie cette aristocratie guerrière, ce n'est pas la liberté de la tolérance et de l'égalité pour tous, mais la liberté de l'égoïsme, de l'avidité, du goût de la bataille et de la rapine. C'est donc une liberté qui ne peut s'exercer que par la domination.
Ce discours de la noblesse ira jusqu'à dire que l'étymologie du mot "Franc" ne veut pas dire "libre", mais "féroce" du mot latin "ferox". Ainsi, “Franc” veut dire “fier”, “intrépide”, “orgueilleux”, “cruel”. Et c'est alors que commence ce grand portrait du "barbare" qu'on va retrouver jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusque chez Nietzsche où la liberté sera équivalente à une férocité qui est goût du pouvoir et incapacité de servir.
Discours de Boulainvilliers : Le roi des Francs n'est pas devenu le propriétaire de la terre de Gaule, chacun des guerriers a pris un morceau de terre et le roi a pris sa terre à lui, et c'est ça qui a marqué le début de la féodalité. Mais parce que l'occupation et l'état de guerre a perduré, le roi est resté roi. Les guerriers francs n'acceptant pas que la dictature militaire se prolonge jusque dans la paix, le roi a été obligé pour maintenir son pouvoir de faire appel à des mercenaires dans le peuple gaulois. Et l'aristocratie guerrière s'est peu à peu trouvée coincée entre le pouvoir monarchique qui essayait de maintenir son pouvoir absolu, et le peuple gaulois enrôlé par le monarque lui-même. Et l'ancienne aristocratie gauloise, qui avait perdu tous ses privilèges, s'est réfugiée dans l'église, a développé le droit romain absolutiste et est devenue par là l'alliée de la monarchie absolue. Peu à peu le latin est devenu la langue d'État et la noblesse ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Tout était fait pour que la noblesse reste ignorante. Et si l'Église a insisté autant sur la vie de l'au-delà, c'est essentiellement pour faire croire que rien de ce qui se passe ici n'est important. Et c'est ainsi que les guerriers germains ont été transformés en chevaliers croisés ne se souciant plus de leurs propres terres dans leur propre pays. Et c'est pendant les croisades, alors que cette noblesse était tournée vers le monde de l'au-delà, que le roi et l'église en ont profité pour les déposséder de leurs terres et de leurs droits.
Dans la société, la bataille passe par le savoir
D'où l'appel de Boulainvilliers qui invite la noblesse, non pas à la révolte comme l'ont fait les historiographes anglais du XVIIe siècle, mais à la réouverture du savoir, à la réouverture de sa propre mémoire. Car à l'intérieur de la société, la bataille ne passe plus par les armes mais par le savoir. Reprendre conscience de soi, déceler les sources du savoir et de la mémoire, cela veut dire dénoncer toutes les mystifications de l'histoire. Et c'est en reprenant conscience de soi, que la noblesse pourra redevenir une force dans l'histoire. Donc se poser comme une force dans l'histoire implique de reprendre conscience de soi et de se réinscrire dans l'ordre du savoir.
La guerre comme principe d’analyse de la société
Ces analyses de Boulainvilliers sont importantes pour comprendre cette place qui est faite à la guerre. Pour faire de la guerre le principe d'analyse de la société, Boulainvilliers fait trois généralisations :
- Généralisation de la guerre par rapport au droit
Dans les analyses traditionnelles, la guerre suspend le droit. Dans le nouveau discours, la guerre n'interrompt pas le droit. Au contraire, elle recouvre le droit naturel. Boulainvilliers en donne trois preuves :- Mise en œuvre historique :
Il n'y a jamais eu de droit naturel dans l'histoire, on n'y trouve que la guerre ou des inégalités qui traduisent des guerres. - Mise en œuvre théorique :
On peut concevoir une liberté primitive avant toute domination, mais cette liberté où tous les gens seraient égaux ne peut pas être en réalité la liberté. La liberté ne consiste pas à s'empêcher d'empiéter sur la liberté des autres. Au contraire, la liberté consiste à pouvoir prendre, profiter, commander, à pouvoir obtenir l'obéissance. Donc le premier critère de la liberté, c'est de pouvoir priver les autres de la liberté. Pour Boulainvilliers, la liberté est donc le contraire de l'égalité. - Mise en œuvre historique et théorique :
Admettons que le droit naturel ait existé dans une origine lointaine, et que les gens aient été libres et égaux. La faiblesse de cette liberté ne peut que disparaître devant la force historique d'une liberté qui fonctionne comme inégalité. La loi de l'histoire est toujours plus forte que la loi de la nature, donc le droit naturel est toujours vaincu.
- Mise en œuvre historique :
Donc première généralisation : la guerre recouvre entièrement l'histoire au lieu d'en n'être que l'interruption.
- Généralisation de la guerre par rapport à la bataille
Bien sûr, la bataille fixe un rapport de force. Mais en fait, ce rapport de force a été établi bien avant la bataille. Ce qui établit le rapport de force, c'est la nature et l'organisation des institutions militaires. Ce sont elles qui permettent de remporter des victoires. Donc ce qui est important dans une organisation sociale, c'est l'organisation militaire et la répartition des armes dans la société. C'est quand la répartition des armes devient flou que les altercations commencent à se produire. Or, ce problème de la répartition des armes est lié à des questions techniques, économiques et institutionnelles. L'organisation militaire a donc des effets sur l'ordre civil tout entier.
Ce qui sert alors d'analyseur de la société, ce n'est plus seulement la dualité vainqueur/vaincu, mais la guerre comme manière d'organiser la guerre, donc la guerre comme institution interne et non plus comme événement brut de la bataille.
- Généralisation de la guerre par rapport au système invasion/révolte
Boulainvilliers cherche à montrer comment le rapport de force manifesté par l'invasion s'est inversé peu à peu. Son problème est de savoir comment les forts sont devenus faibles, et comment les faibles sont devenus forts :
- L'aristocratie franque en Gaule occupée était propriétaire des terres et en tirait sa force. Or, ce qui faisait leur force est devenu leur faiblesse. Les nobles dispersés sur leur terre n'étaient plus proches du roi. De plus, en ne s'occupant que de la guerre, ils ont négligé l'éducation, le latin, la connaissance. Tout cet ensemble de choses est devenu le principe de leur impuissance.
Inversement, l'aristocratie gauloise chassée de ses terres par l'invasion Franque, s'est peu à peu réfugiée dans l'église. Cela leur a donné la connaissance du droit et une influence sur le peuple, et les a rapprochés du roi. Ils ont donc récupéré un pouvoir politique qu'ils avaient autrefois perdu.
- L'aristocratie franque en Gaule occupée était propriétaire des terres et en tirait sa force. Or, ce qui faisait leur force est devenu leur faiblesse. Les nobles dispersés sur leur terre n'étaient plus proches du roi. De plus, en ne s'occupant que de la guerre, ils ont négligé l'éducation, le latin, la connaissance. Tout cet ensemble de choses est devenu le principe de leur impuissance.
Le problème de ce nouveau discours n'est donc pas de savoir qui a été vainqueur et qui a été vaincu, mais de savoir pourquoi le fort est devenu faible et pourquoi le faible est devenu fort. L'histoire apparaît donc comme le calcul des forces.
Cette description des mécanismes de force met en lumière tout un réseau de luttes diverses avec renversements et alliances, au lieu de la simple dichotomie vainqueur/vaincu. Ce discours fait pénétrer le rapport de guerre dans tout le rapport social. Il y a une guerre de tous contre tous, mais pas au sens abstrait de Hobbes. Dans ce nouveau discours, la guerre parcourt tout le corps social, non comme guerre des individus contre les individus, mais comme guerre des groupes contre des groupes.
Cette triple généralisation de la guerre mène à ceci : pour les historiens qui racontaient la gloire du souverain, la guerre était la rupture du droit. Chez Boulainvilliers, la guerre permet de montrer les rapports de force qui font fonctionner le droit, et montre par là le caractère illégitime du droit. Et Boulainvilliers va étendre cette grille de lecture à toute la société. L'histoire, à partir du fait de la guerre, va donc être un principe d'intelligibilité de la société.
Le rapport de force devient un objet historique saisissable par un groupe
Ce nouveau discours permet de reprendre l'analyse qu'on trouve chez Machiavel, à la différence que chez Machiavel le rapport de force était une technique politique entre les mains du souverain, alors que désormais le rapport de force est un objet historique qu'une nation (un groupe, une minorité, une classe) peut déterminer à l'intérieur de son histoire. Donc le rapport de force qui était un objet politique devient maintenant un objet historico-politique. Et c'est en analysant ce rapport de force qu'une nation va pouvoir prendre conscience d'elle-même, retrouver son savoir et sa force politique.
Autre remarque
Il y a un lieu commun qui veut que ce soit les classes en ascension qui portent à la fois les valeurs de l'universel et la puissance de la rationalité. Mais on voit avec la noblesse que c'est lorsqu'elle était en pleine décadence, dessaisie de son pouvoir politique et économique, qu'elle a mis en place une certaine rationalité historique dont la bourgeoisie ensuite, le prolétariat après, se saisiront. La guerre étant le point de départ du discours, la condition de possibilité de l'émergence d'un discours historique, et l'objet vers lequel se tourne ce discours.
25 février 1976
Le pouvoir n’est pas une puissance, c’est une relation
C'est donc au XVIIIe siècle que s'est constitué, avec Boulainvilliers, un champ historico-politique. En prenant les nations pour objet, il faisait l'histoire des sujets (ce qui allait devenir au XIXe siècle l'histoire du peuple), et il découvrait que l'histoire ne doit pas être l'histoire du pouvoir, mais l'histoire du couple peuple/pouvoir : les forces originaires du peuple et la force constituée du pouvoir. Il définissait ainsi le caractère relationnel du pouvoir : le pouvoir, ce n'est pas une puissance, c'est une relation. On ne peut donc pas faire l'histoire des rois ou l'histoire des peuples, mais on doit faire l'histoire de ce qui constitue ces deux termes.
En faisant cette histoire, Boulainvilliers rejetait le modèle juridique de la souveraineté. Ce n'est pas en termes juridiques de souveraineté, mais en termes historiques de domination que l'on peut décrire le phénomène du pouvoir.
En revanche, pour Boulainvilliers, il n'y a pas d'histoire sans le rapport de force et le jeu du pouvoir. S'il y a des événements dont il faut garder la mémoire, c'est parce qu'il y a entre les hommes des rapports de pouvoir.
L’histoire n’est pas un analyseur, mais un modificateur des rapports de forces
Boulainvilliers a constitué un continuum historico-politique dans la mesure où il cherche à redonner à la noblesse une mémoire et un savoir. Par conséquent, prendre la parole dans le domaine de l'histoire ce n'est pas simplement décrire un rapport de force, mais bien plus encore, modifier les rapports de force. L'histoire n'est pas simplement un analyseur, c'est un modificateur. Donc dire la vérité de l'histoire, c'est occuper une position stratégique décisive.
La constitution d'un champ historico-politique se traduit par le fait que l'on est passé d'une histoire qui avait pour fonction de dire le droit en racontant les exploits des héros, à une histoire qui est devenue un savoir des luttes. Combat politique et savoir historique sont désormais liés.
Le savoir historique se construit sur l'analyse des forces : l'histoire nous a apporté l'idée que nous sommes en guerre, et nous nous faisons la guerre à travers l'histoire.
À propos de l'historicisme
La philosophie, les sciences humaines, l'histoire, ont été pour ainsi dire anti-historiciste, c'est-à-dire ont essayé de conjurer ce lien entre l'histoire et la guerre.
Selon cette idée (platonicienne), le savoir et la vérité ne peuvent pas appartenir à la guerre, mais ne peuvent appartenir qu'à l'ordre et qu'à la paix. L'État moderne a profondément réimplanté cette idée par la disciplinarisation des savoirs au XVIIIe siècle.
À la fin du XVIIIe siècle, l'histoire est devenue le discours général des luttes politiques. Et c'est au même moment que s'est créé un ministère de l'histoire. Le but de cette administration centrale de l'histoire était d'armer le roi dans cette bataille politique : coder le discours de l'histoire pour l'intégrer à la pratique de l'État.
La différence entre l'histoire des sciences et la généalogie des savoirs
Histoire des sciences : fonctionne sur l'axe connaissance-vérité.
Généalogie des savoirs : fonctionne sur l'axe discours-pouvoir (pratique discursive et affrontement de pouvoir).
On décrit souvent le XVIIIe siècle comme le progrès des lumières, c'est-à-dire l'émergence des savoirs techniques et la lutte de la connaissance contre l'ignorance. Mais il faut au contraire percevoir le XVIIIe siècle comme le combat des savoir entre eux.
Le secret du savoir technologique a été longtemps une richesse et la garantie de l'indépendance. Mais à mesure que les forces de productions se sont développées, le prix de ces savoirs a augmenté et la lutte des savoirs est devenue plus forte. Les plus petits savoirs, les plus artisanaux se sont fait confisquer par les plus grands savoirs, par les plus industriels.
Dans cette tentative de généralisation du savoir, l'Etat va intervenir par quatre grands procédés :
- Sélection des savoirs par l'élimination des petits savoirs jugés inutiles et coûteux.
- Normalisation des savoirs pour qu'ils communiquent, et pour abattre la barrière du secret. Ce qui permet de rendre interchangeables les savoirs et ceux qui les détiennent.
- Hiérarchisation des savoirs : les savoirs les plus matériels sont subordonnés aux savoirs les plus formels.
- Centralisation pyramidale qui permet le contrôle des savoirs : transmettre les contenus des savoirs de bas en haut, et transmettre les directions d'ensemble de haut en bas.
Quelques exemples
Il faut ainsi voir l'Encyclopédie non pas comme une opposition idéologique à la monarchie, mais comme une opération politique et économique d'homogénéisation des savoirs technologiques.
Les grandes enquêtes commencées au milieu du XVIIIe sur les techniques du travail ont servi la normalisation des savoirs techniques.
La création de grandes écoles, comme celles des ponts-et-chaussées, ont permis d'établir des niveaux entre les différents savoirs ainsi que leur hiérarchisation.
Le corps d'inspecteurs présent dans tout le royaume, a assuré la fonction de centralisation.
La mise en discipline des savoirs par la science
Pour toutes ces entreprises, il s'agissait de quatre choses : sélection, normalisation, hiérarchisation, centralisation. Ce sont les quatre opérations du pouvoir disciplinaire. Le XVIIIe siècle a été le siècle de la mise en discipline des savoirs.
Et c'est précisément cette mise en discipline des savoirs que l'on appelle la "science". La science n'existait pas avant le XVIIIe siècle, il existait des sciences, des savoirs. Et la philosophie était le système de communication des savoirs les uns par rapport aux autres. Et c'est dans cette mesure-là que la philosophie avait un rôle effectif dans le développement des connaissances.
C'est donc à ce moment-là que disparaît le rôle fondateur de la philosophie. Désormais, la philosophie n'aura plus aucun rôle effectif à jouer à l'intérieur de la science et des processus de savoir. De même, la mathesis (le projet cartésien de science universelle de la mesure et de l'ordre) disparaît aussi comme projet d'une science universelle.
La science a pris le relais de la philosophie et de la mathesis. La science va donc poser des questions de classification, hiérarchisation, etc.
Ce que le XVIIIe siècle a perçu comme progrès de la raison, a été en fait la mise en discipline de savoirs hétérogènes. Et c'est à partir de cette affirmation qu'on peut comprendre plusieurs choses :
- L'apparition de l'Université au XIXe. L'université napoléonienne est une sorte de grand appareil uniforme des savoirs :
- Rôle de sélection des savoirs : un savoir qui ne provient pas du champ institutionnel se trouve disqualifié à priori = disparition du savant amateur.
- Rôle de répartition des savoirs : répartition en différents niveaux.
- Rôle d'homogénéisation des savoirs par la constitution d'une communauté scientifique à statut reconnu : permet d'organiser un consensus.
- Centralisation des appareils d'État.
Il y a donc un changement dans la forme du dogmatisme. L'ancien contrôle sur le savoir opéré par l'église, portait sur les énoncés eux-mêmes et entraînait la condamnation de beaucoup d'énoncés scientifiquement féconds. La discipline des savoirs mise en place au XVIIIe siècle va substituer autre chose : le contrôle ne porte plus sur le contenu des énoncés, sur leur conformité à une certaine vérité, mais sur la régularité des énonciations. Le problème sera de savoir qui a parlé, s'il était qualifié pour parler, et dans quel ensemble peut se replacer l'énoncé.
Cela a permis une plus grande liberté dans le contenu des énoncés, et un contrôle plus rigoureux au niveau des procédures de l'énonciation = un grand renouvellement des énoncés, mais aussi une désuétude plus rapide des vérités.
Cette disciplinarisation a créé un nouveau mode de rapport entre pouvoir et savoir. La contrainte de la vérité a disparu et a été remplacée par la contrainte de la science.
Ces savoirs technologiques dispersés étaient l'enjeu d'une lutte économique et politique. Et l'État est intervenu avec un rôle de disciplinarisation (c'est-à-dire un rôle de sélection, d'homogénéisation, de hiérarchisation, de centralisation). De la même façon, le pouvoir royal a mis en discipline le savoir historique et a établi ainsi un savoir d'État. Avec une différence par rapport au savoir technologique, c'est qu'entre le savoir anti-étatique et le savoir disciplinaire de l'État, il y a eu un affrontement perpétuel qui n'a pas été réduit par la disciplinarisation. Et dans cette mesure-là, il y a perpétuellement deux niveaux de conscience et de savoir historique : un savoir disciplinarisé, et une conscience historique polymorphe, divisée et combattante, qui est l'autre face de la conscience politique.
3 mars 1976
Le moment de la Révolution française
Le savoir historique originairement lié à la noblesse, est devenu au XVIIIe siècle la forme commune à la bataille politique. Il y a donc généralisation du discours historique, mais en tant que tactique.
Cette tactique s'est déployée dans trois directions :
- Les nationalités : la question des langues (champ de la philologie = parler)
- Les classes sociales : la question de la domination économique (champ de l'économie = travailler)
- Les races : la question des spécifications biologiques (champ de la biologie = vivre)
Boulainvilliers avait fait de la dualité nationale le principe d'intelligibilité de l'histoire. Intelligibilité voulait dire trois choses :
- Retrouver le conflit initial à partir duquel tous les autres affrontements pouvaient dériver.
- Tracer la ligne des partages moraux : repérer les trahisons, les ruses, les alliances contre-nature. En somme, poser la question "à qui la faute ?"
- Retrouver le rapport de force historiquement vrai, dégagé de toutes les trahisons.
On fait donc de l'histoire pour rétablir la Constitution. Il s'agit de mettre en place une Constitution par une révolution des forces et non par le rétablissement de vieilles lois.
Ce qui a été possible à partir de Boulainvilliers, c'est le couplage de ces deux notions : la Constitution et la Révolution. Et puisque la Constitution devient un rapport de force, on ne peut rétablir ce rapport qu'à partir de l'idée d'un mouvement cyclique de l'histoire, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse ramener l'histoire à son point de départ. On a donc ce lien de trois thèmes : Constitution, Révolution, histoire cyclique.
La figure du barbare à la place de la figure du sauvage
En cherchant ce point constituant dans l'histoire, Boulainvilliers refuse de le chercher dans la loi (= anti-juridisme), mais refuse aussi de le chercher dans la nature (= anti-naturalisme). Le grand adversaire de ce genre d'analyses, c'est le sauvage.
D'une part, les théoriciens du droit conceptualisent l'homme de nature comme celui qui va constituer la société. Et d'autre part, les économistes conceptualisent l'homme de nature comme un homme sans histoire et sans passé uniquement mû par son intérêt, échangeant le produit de son travail.
Le discours historico-politique de Boulainvilliers a voulu conjurer à la fois le sauvage théorico-juridique qui sort de sa forêt pour fonder la société, et à la fois le sauvage homo-economicus qui vit de l'échange.
Ce sauvage, c'est essentiellement l'homme de l'échange, c'est l'échangeur des droits ou l'échangeur des biens. Et contre ce sauvage, le discours historico-politique inauguré par Boulainvilliers a fondé un autre personnage : le barbare.
- Dès qu'il est dans un rapport social, le sauvage cesse d'être sauvage. En revanche, le barbare ne peut être défini que par rapport à une civilisation contre laquelle il vient se battre. Le barbare ne repose pas sur un fond de nature auquel il appartient, mais il ne surgit que sur un fond de civilisation contre lequel il vient se heurter.
- Le barbare n'est pas vecteur d'échange comme le sauvage, mais il est essentiellement vecteur de domination.
- Le sauvage cède une partie de sa liberté pour garantir sa vie, sa sécurité, ses biens. Inversement, le barbare ne cède jamais sa liberté. Sa liberté ne repose que sur la liberté perdue des autres. Et s'il se donne un roi, c'est pour multiplier sa propre force. Donc pour le barbare, le modèle de gouvernement est nécessairement militaire.
On comprend alors très bien pourquoi dans la pensée juridico-anthropologique de nos jours et jusque dans les utopies bucoliques, le sauvage est toujours bon. Au contraire, le barbare n'est pas l'homme de l'échange et de la nature, il est l'homme de l'histoire, il est l'homme du pillage et de la domination. Chez le barbare, l'âme est grande, noble et fière, mais toujours associée à la cruauté.
La question va donc être de savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut écarter du barbare pour faire fonctionner une Constitution juste. Tout cet ensemble de discours historiques au XVIIIe siècle est surplombé par ce problème : révolution et barbarie. Comment faire l'économie de la barbarie dans la révolution ?
Premier type de discours sur le barbare
Dans ce premier retournement du discours de Boulainvilliers, il s'agit de ne rien laisser passer du barbare dans l'histoire, donc de faire disparaître le noyau barbare, et de faire de la noblesse une création la fois tardive et artificielle. C'est la thèse de la monarchie.
Il n'y aurait pas eu une aristocratie de type barbare, mais tout de suite une monarchie absolue. Les officiers délégués par le souverain se seraient de plus en plus arrogé de pouvoir, jusqu'à se créer des fiefs. Et c'est sur cette décomposition du pouvoir central que serait née la féodalité : "Le changement des offices en seigneurie produisirent des effets semblables à ceux de l'invasion étrangère, et élevèrent entre le roi et le peuple une caste dominatrice" (Dubos). Donc, dans ce discours, les nobles ne sont pas des barbares, ils n'ont obtenu aucune victoire militaire, ce ne sont que des escrocs politiques.
Second type de discours sur le barbare
C'est par une complicité entre les nobles qui ont fait le roi, et le roi qui a fait la féodalité, que sont nées, au-dessus de la démocratie barbare, la monarchie et l'aristocratie.
Troisième type de discours sur le barbare
C'est ce discours (thèse de Bréquigny et de Chapsal) qui aura la fortune historique la plus grande. Il s'agit dans ce discours de distinguer deux barbaries : la barbarie des Germains qui est la mauvaise barbarie dont il faut s'affranchir, et la barbarie des Gaulois porteuse de liberté.
Ce discours effectue donc deux opérations :
- Il dissocie liberté et germanité.
- Il dissocie la romanité et l'absolutisme.
Ça va devenir la thèse des historiens bourgeois du XIXe siècle. Cette thèse consiste à dire que le système politique des romains était à deux étages : le pouvoir absolu de l'empire romain, mais aussi les libertés originaires des Gaulois que les Romains leur ont laissé. De sorte que la liberté des Gaulois va continuer à fonctionner dans les villes de l'Empire. C'est donc l'idée que la liberté est un phénomène compatible avec l'absolutisme romain. Mais c'est surtout l'idée que la liberté est un phénomène urbain : la liberté appartient aux villes. Et c'est dans la mesure où elle appartient aux villes que cette liberté va pouvoir lutter et devenir une force politique et historique.
Cette histoire nous raconte qu'un tiers état s'est formé grâce à sa propre énergie, à sa richesse, à son commerce, et grâce à l'ancienne liberté, c'est-à-dire l'ancienne barbarie gauloise. On va donc voir pour la première fois la romanité se colorer de libéralisme. La bourgeoisie va pouvoir récupérer la romanité. La municipalité gallo-romaine, c'est la noblesse du tiers état. Et c'est cette municipalité, cette forme d'autonomie, de liberté municipale, que le tiers état va réclamer.
On peut donc revenir à la romanité, même si l'on est bourgeois. Et la Révolution ne s'en privera pas.
Tous ces discours historiques ont une trame commune très serrée. Or cela ne signifie pas que tout le monde pense de la même façon. Au contraire, c'est la condition pour que l'on puisse penser d'une façon différente, et que cette différence soit politiquement pertinente.
Plus le savoir est régulièrement formé, plus il est possible, pour les sujets qui parlent, de se répartir selon des lignes rigoureuses d'affrontement. C'est la régularité du champ épistémique qui va rendre le discours utilisable dans des luttes extra-discursives : la réversibilité tactique du discours est fonction directe de l'homogénéité des règles de formation de ce discours.
Au XVIIIe, la bourgeoisie est anti-historiciste
On voit aussi, à part pour le dernier discours, que les bourgeois étaient ceux qui avaient le moins intérêt à investir leur projet politique dans l'histoire, précisément parce que la bourgeoisie ne pouvait pas se repérer comme sujet historique dans le jeu des rapports de force.
La bourgeoisie a été au XVIIIe siècle anti-historiciste. C'est l'aristocratie qui a été historique. D'ailleurs, pendant toute la première partie du XVIIIe siècle, la bourgeoisie a été favorable au despotisme éclairé, à une certaine forme de modération du pouvoir monarchique. Et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la bourgeoisie a essayé d'échapper à l'historicisme en demandant une Constitution. Le rousseauisme de la bourgeoisie à la fin du XVIIIe siècle était une réponse à l'historicisme des autres sujets politiques. Être rousseauiste, faire appel au sauvage, faire appel au contrat, c'était échapper à tout ce paysage qui était défini par le barbare, son histoire et ses rapports avec la civilisation.
Et c'est ainsi qu'on a deux grandes formes historiques réactivées dans la Révolution. D'une part la réactivation de la cité romaine, donc la Rome archaïque, républicaine et vertueuse, et la cité gallo-romaine avec ses libertés et sa prospérité. Et d'autre part, la figure de Charlemagne, l'homme qui convoquait le peuple au champ de Mars. Charlemagne, souverain-guerrier et protecteur du commerce et des villes.
(Autre forme de réactivation historique à l'intérieur de la Révolution : l'exécration de la féodalité).
De sorte que les luttes politiques et sociales qui ont traversé la Révolution française sont interprétées en termes d'histoire des races.
10 mars 1976
La naissance de la nation
Au XVIIIe siècle, c'était le discours de l'histoire, et non le discours du droit, qui avait fait de la guerre l'analyseur principal des rapports politiques. C'est à partir de la Révolution que cet élément de la guerre va être éliminé du discours de l'histoire.
L'histoire telle qu'elle avait été racontée par Boulainvilliers avait fait surgir le péril d'une guerre indéfinie et le péril que tous nos rapports soient de l'ordre de la domination. Donc un double danger :
- la guerre indéfinie comme fond de l'histoire
- La domination comme principe de la politique
Et c'est ce double danger qui va être réduit dans le discours historique du XIXe siècle et retranscrit en crises et en violences, et enfin en réconciliation (le discours historique s’est embourgeoisé). Le rapport de guerre va réapparaître, non plus comme constitutif de l'histoire, mais comme protecteur et conservateur de la société. Ainsi, au XIXe siècle, la guerre va réapparaître, mais comme guerre interne qui défend la société contre les dangers qui naissent à l'intérieur de la société (c'est le grand renversement de l'historique au biologique).
Cette transformation du discours historique s'est produite à partir de la réélaboration politique de la notion de "nation" dont l'aristocratie avait fait le sujet et l'objet de l'histoire au XVIIIe siècle.
La thèse de la monarchie absolue était que la nation n'existait pas, ou n'existait que grâce à la personne du roi. Ce n'est donc pas le groupe qui fait la nation. Ce qui fait la nation, c'est qu'il y a des individus qui ont tous un rapport juridique et physique avec la personne du roi. Autrement dit, c'est le corps du roi qui fait le corps de la nation. Et c'est de cette nation que le discours de la noblesse avait tiré une multiplicité de nations, et avait établi entre elles des rapports de guerre et de domination. Le roi étant, dans ce discours, l'instrument de guerre et de domination que se donne une nation pour lutter contre les autres nations.
Discours de Sieyès
Sieyès donne deux types de conditions pour qu'existe la nation :
- Conditions juridico-formelles
Pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait un état juridique, donc une législature. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait un roi, ni même qu'il y ait un gouvernement. Il faut seulement que la nation se soit donné une loi commune par la législature. - Conditions historico-fonctionnelles
Mais pour que la nation subsiste et prospère, il faut en plus d'autres conditions :- Des fonctions (Sieyès appelle cela "des travaux") : l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, le commerce, les arts libéraux.
- Des appareils (Sieyès appelle cela "des fonctions") : l'armée, la justice, l'église, l'administration.
Tant qu'avait régné la définition juridique de la nation, l'agriculture, le commerce, l'industrie, etc. n'étaient pas les conditions pour que la nation existe, mais les effets de l'existence de la nation. L'agriculture, le commerce, l'industrie, étaient pensés comme la conséquence de la Constitution juridique.
Sieyès renverse cette analyse, et fait passer ces fonctions et ces appareils avant la nation, c'est-à-dire comme condition d'existence de la nation. Donc un groupe d'individus peut toujours se réunir, se donner des lois et une législature, s'il n'a pas les capacités de faire du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, de former une armée, une magistrature, il ne sera jamais, historiquement, une nation. Ce n'est donc ni le contrat, ni la loi, ni le consensus, qui peuvent être créateurs de nation.
C'est à partir de ce postulat que Sieyès va analyser la situation en France à la fin du XVIIIe siècle. C'est le tiers état qui assure pour les neuf dixièmes le fonctionnement des fonctions (agriculture, commerce, artisanat, industrie...) et des appareils (armée, église, administration, justice). Mais le tiers état, qui assume donc les conditions substantielles de la nation, n'en a pas reçu le statut formel. Il n'y a pas en France de loi commune, mais une série de lois dont les unes s'appliquent à la noblesse, les autres au tiers état, les autres au clergé, etc. Il n'y a pas de législature commune, car les lois sont fixées par l'arbitraire royale.
On peut tirer plusieurs conséquences de cette analyse :
- Conséquences politiques
La France n'est pas une nation puisqu'elle n’a pas les conditions formelles de la nation : lois communes, législature. Mais il y a pourtant en France une nation, c'est-à-dire un groupe d'individus qui a la capacité d'assurer l'existence substantielle et historique de la nation : le tiers état. En d'autres mots, le tiers état est une nation complète.
Cette formulation politique va être la matrice de tout un discours politique qui présente deux caractères :- Un rapport nouveau de la particularité à l'universalité, qui est exactement l'inverse du rapport caractérisé par le discours de la noblesse. La noblesse déduisait, extrayait, de l'unité monarchique, le droit singulier des nobles. Il s'agissait donc d'extraire de la totalité du corps social le droit particulier et singulier de la noblesse.
Au contraire, le discours du tiers état va dire que seul le tiers état a le pouvoir de constituer effectivement la nation, car seul le tiers état est susceptible d'universalité étatique. - Inversion de l'axe temporel de la revendication : la revendication va s'articuler sur une virtualité, sur un avenir qui est imminent, qui est déjà présent dans le présent puisque le tiers état assure déjà une fonction d'universalité étatique, et demande seulement que son statut de nation unique soit reconnu dans la forme juridique de l'État.
- Un rapport nouveau de la particularité à l'universalité, qui est exactement l'inverse du rapport caractérisé par le discours de la noblesse. La noblesse déduisait, extrayait, de l'unité monarchique, le droit singulier des nobles. Il s'agissait donc d'extraire de la totalité du corps social le droit particulier et singulier de la noblesse.
- Conséquences théoriques
Ce qui définit une nation, ce n'est pas son ancestralité, son rapport au passé, mais c'est son rapport à l'État. Ce qui veut dire plusieurs choses :- La nation ne se spécifie pas par rapport à d'autres nations. Donc la nation ne se caractérise pas par un rapport horizontal avec d'autres nations. La nation se caractérise par un rapport vertical allant de ce corps d'individus à l'État.
- Ce ne sont pas les aptitudes militaires, l'intensité barbare, qui caractérisent la force d'une nation. Ce qui constitue la force d'une nation, ce sont des capacités qui s'ordonnent à la figure de l'État. Plus une nation a de capacités étatiques, plus elle est forte. Donc le propre d'une nation n'est pas de dominer les autres, mais de s'administrer elle-même, de gouverner, d'assurer le fonctionnement du pouvoir étatique. Non pas domination, mais étatisation.
- Conséquences historiques
Le discours historique va donc réintroduire le problème de l'État. On va donc avoir un discours historique qui va se rapprocher du discours historique du XVIIe siècle qui était le discours de l'État qui tenait un discours sur lui-même établissant ainsi sa propre légitimité. Et c'était précisément contre ce type de discours que la noblesse avait lancé son propre discours.
On va donc avoir à présent un discours de l'histoire qui se rapproche de l'État et qui ne sera plus anti-étatique. Mais il ne s'agira pas de faire tenir à l'État un discours qui serait le discours de sa justification, il va s'agir de faire l'histoire des rapports entre la nation et l'État. Ce discours va permettre d'écrire une histoire qui ne sera pas prise dans le cercle de la Révolution et de la reconstitution à l'ordre primitif des choses, comme c'était le cas au XVIIe siècle.
On va donc avoir une histoire de type rectiligne, où le moment décisif sera le passage du virtuel au réel, le passage de la totalité nationale à l'universalité de l'État. Donc une histoire polarisée à la fois vers le présent et vers l'État.
Et ceci va permettre d'écrire une histoire où le rapport des forces ne sera pas un rapport de type guerrier, mais un rapport de type civil. La guerre pour la domination sera donc remplacée par une lutte qui n'est plus un affrontement armé, mais une rivalité, une tension vers l'universalité de l'État. C'est l'universalité de l'État qui va être l'enjeu et le champ de bataille de la lutte. De sorte que la lutte, n'ayant plus pour fin la domination mais l'état commun, sera essentiellement civile. Cette lutte va se dérouler essentiellement à travers l'économie, les institutions, la production, l'administration. Et la guerre civile sera vue uniquement comme un épisode de crise, un moment exceptionnel.
Et c'est là que se pose une des questions fondamentales de l'histoire et de la politique au XIXe et au XXe siècle : comment peut-on comprendre une lutte en termes proprement civils ? Est-ce que la lutte économique, la lutte politique, la lutte pour l'État peut être analysée en termes non-guerriers, c'est-à-dire dans des termes économico-politiques ? Ou faut-il retrouver derrière les luttes ce fond indéfini de la guerre et de la domination que les historiens du XVIIIe siècle avaient essayé de repérer ?
On a donc, à partir du XIXe siècle, une histoire qui va chercher le fond civil de la lutte dans l'espace de l'État.
La forme de cette nouvelle histoire : passé et présent
Cette nouvelle histoire va se caractériser par l'ajustement de deux grilles d'intelligibilité : La grille d'intelligibilité du XVIIIe siècle : c'est-à-dire qu'il y a toujours une guerre comme matrice d'une histoire. C'est toujours une guerre qui démarre l'histoire.
La grille d'intelligibilité tirée de la nouvelle idée de nation. Cette grille ne fonctionne pas à partir d'un point d'origine qui serait la première guerre, mais fonctionne à partir du présent. Ce n'est plus l'origine qui est le moment fondamental, mais le présent.
Dans le champ historico-politique du XVIIIe siècle, le présent était toujours le moment du négatif, c'était le moment du profond oubli. Le présent, c'était le moment où, à travers tout un tas de trahisons, l'état primitif de guerre avait été brouillé et se trouvait oublié par ceux qui auraient eu pourtant profit à l'utiliser. Le présent, c'était l'oubli du rapport de force qui définissait leur relation avec les autres habitants. Dans le discours de la noblesse du XVIIIe siècle, il fallait donc sortir du présent par un réveil violent et soudain, qui devait passer par la réactivation du moment primitif dans l'ordre du savoir.
Au contraire, à partir du moment où l'histoire est polarisée par le rapport nation/Etat, virtualité/actualité, le présent va être le moment solennel où l'universel entre dans le réel. Le présent, ce n'est plus le moment de l'oubli, mais c'est au contraire le moment où va éclater la vérité. Le présent devient donc, à la fois, le révélateur et l'analyseur du passé.
En fait, ces deux grilles ne fonctionnent jamais l'une sans l'autre. On a une histoire qui est écrite, d'un côté, en forme de domination, avec comme arrière-fond, la guerre. Et, d'un autre côté, en forme de totalisation, avec du côté du présent, l'émergence de l'État. Donc une histoire qui s'écrit à la fois en termes de commencement déchiré, et en termes d'achèvement totalisateur.
Et ce qui définit l'utilisabilité politique du discours historique, c'est la manière dont on fait jouer ces deux grilles l'une par rapport à l'autre : privilégier la première grille donnera une histoire réactionnaire, aristocratique, droitière. Privilégier la seconde grille donnera une histoire de type libéral ou bourgeois. Mais ces deux types d'histoire seront obligés d'utiliser d'une manière ou d'une autre les deux grilles.
Premier exemple : une histoire de type droitier qui cherche dans le passé des rapports de dominations (Montlosier XIXe siècle)
La monarchie, à partir des sujets germains, romains, gaulois, a constitué un autre peuple, une nouvelle classe à l'intérieur du corps social. Le roi se sert de cette nouvelle classe pour arracher à la noblesse ses privilèges économiques et politiques. Le roi utilise les révoltes : révoltes des paysans contre les propriétaires terriens, révoltes des villes contre les seigneurs, etc. Et derrière toutes ces révoltes, dit Montlosier, il faut bien sûr voir le mécontentement de cette nouvelle classe, mais il faut surtout voir la main du roi, car chaque révolte affaiblit le pouvoir des nobles et renforce ainsi le pouvoir du roi. Mais la monarchie, ayant ainsi récupéré tous les pouvoirs politiques de la noblesse, doit faire appel à cette nouvelle classe pour faire fonctionner le pouvoir. Elle confie donc sa justice et son administration à cette nouvelle classe. De sorte que le dernier moment du processus, c'est la révolte ultime : l'État est en tout entier dans les mains du peuple et échappe au pouvoir royal. Il n'y a plus qu'un roi face à une classe populaire qui a dans les mains tous les instruments de l'État. Et la dernière révolte, c'est contre celui qui a oublié qu'il était le dernier aristocrate à détenir encore du pouvoir : le roi.
La Révolution française, selon Montlosier, est donc le dernier épisode de ce processus de transfert. De sorte que la Révolution française n'a pas renversé le roi, elle a achevé l'œuvre des rois, elle en dit littéralement la vérité. La Révolution française doit être lue comme l'achèvement tragique, mais politiquement vrai, de la monarchie. On a décapité le roi, mais on a couronné la monarchie. Le peuple est donc l'héritier légitime des rois, il a suivi la route qui lui était tracée par les rois, par les parlements, par les hommes de loi et par les savants.
Dans ce discours, le point de départ, c'est un état de guerre. Il y a aussi l'affirmation que la noblesse doit retrouver ses droits, récupérer les biens nationalisés, et reconstituer les rapports de domination exercés autrefois à l'égard du peuple. Mais le discours historique dans son contenu central fait fonctionner le présent comme moment où tous les processus historiques arrivent à leur point ultime : le moment où se constitue une totalité étatique entre les mains d'une collectivité nationale.
Et dans cette mesure-là, ce discours, bien qu'il possède les éléments d'analyse des discours du XVIIIe siècle, fonctionne en réalité sur un autre modèle.
Second exemple : une histoire de type libéral et bourgeois dont le point d'intelligibilité de l'histoire est le présent (XIXe siècle, Augustin Thierry)
Pour Augustin Thierry, la Révolution c'est ce "moment plein", c'est le moment de la réconciliation.
Le moment actuel, c'est celui de la totalisation nationale dans la forme de l'État. Mais cette totalisation s'est faite dans le processus violent de la Révolution. Donc la réconciliation porte encore la trace de la guerre. La Révolution française est donc le dernier épisode d'une lutte qui a duré plus de treize siècles.
Augustin Thierry va chercher à montrer comment une lutte a pu traverser toute l'histoire et conduire à un présent qui n'a plus la forme de la guerre. Comment des deux parties, il a pu s'en trouver une qui a été porteuse d'universalité ? Ainsi, s'il y a eu des luttes jusqu'au moment actuel, ce n'est pas parce que des vainqueurs et des vaincus se sont affrontés à travers des institutions, ce sont en réalité deux types économico-juridiques de société qui sont entrés en rivalité pour l'administration et la prise en charge de l'État. Et c'est cet affrontement entre deux types de sociétés pour la constitution d'un État qui va être le moteur fondamental de l'histoire.
Jusqu'au Xe siècle, ce sont les villes qui sont perdantes dans cette lutte pour l'État. Et si la société urbaine l'emporte finalement, c'est parce qu'elle a plus de richesse, qu'elle a la capacité administrative, mais aussi une morale, une certaine manière de vivre et des instincts novateurs. Elle a assez de force pour que ses institutions cessent d'être locales, et deviennent les institutions du pays. Donc universalisation, non pas à partir d'un rapport de domination, mais par le fait que toutes les fonctions constitutives de l'État naissent entre ses mains. Et cette force de l'État, la bourgeoisie n'en fera pas un usage guerrier, sauf quand elle y sera contrainte. Et la Révolution, c'est précisément le dernier épisode de guerre violente, mais qui n'est que l'instrument d'une lutte qui n'est pas de l'ordre guerrier, mais de l'ordre civil, et qui a pour objet l'État.
La Révolution, c'est le moment où le tiers état, devenu la nation par absorption de toutes les fonctions étatiques, va prendre en charge à lui tout seul, la nation et l'État. La bourgeoisie, le tiers état, devient donc le peuple, devient donc l'État. Il a la puissance de l'universel. Et Augustin Thierry dit que le moment présent est précisément le moment de cette disparition des dualités, des nations, des classes. C'est une immense évolution qui a remplacé les anciens ennemis par un même peuple, une loi égale pour tous, une nation libre et souveraine.
Avec ce type d'analyse, on a l'évacuation de la fonction de la guerre comme analyseur des processus historico-politiques :
- La guerre n’est plus que momentanée et instrumentale, dans des affrontements qui ne sont pas de type belliqueux.
- L'élément essentiel, ce n'est plus ce rapport de domination d'un groupe à un autre, mais c'est l'État.
- On voit se dessiner un discours philosophique de type dialectique.
La philosophie de l'histoire au XIXe siècle, qui trouvera dans l'histoire et dans le présent le moment où l'universel se dit dans sa vérité, est déjà présente dans le discours historique. Et on peut voir, à partir de là, comment entre discours de l'histoire et discours de la philosophie, les rapports ont pu se nouer.
À partir du XIXe siècle, l'histoire et la philosophie vont poser cette question commune : qu'est-ce qui, dans le présent, est la vérité de l'universel ? C'est la question de l'histoire, et c'est la question de la philosophie. La dialectique est née.
17 mars 1976
À partir de la fin du XVIIIe siècle, la notion de guerre avait donc été éliminée de l'analyse historique par le principe de l'universalité nationale.
Un des phénomènes fondamentaux du XIXe siècle est la prise en compte de la vie par le pouvoir : une sorte d'étatisation du biologique.
Dans la théorie classique de la souveraineté, le droit de vie et de mort sont les attributs fondamentaux du souverain. Mais ce droit ne s'exerce que d'une façon déséquilibrée, toujours du côté de la mort. C'est au moment où le souverain peut tuer, qu'il exerce son droit sur la vie. La souveraineté n'est donc pas le droit de faire mourir et de faire vivre, ni le droit de laisser mourir et de laisser vivre, c'est le droit de faire mourir et de laisser vivre.
La grande transformation du droit politique au XIXe siècle va consister à compléter ce vieux droit de souveraineté par un nouveau droit qui va être un pouvoir inverse : le pouvoir de faire vivre et de laisser mourir.
Cette transformation ne s'est pas faite d'un coup, on peut la suivre dans la théorie du droit et dans les technologies de pouvoir :
- Dans la théorie du droit
Chez les juristes du XVIIIe siècle, les individus constituent un souverain pour protéger leur vie. Donc la vie ne peut pas entrer dans les droits du souverain. La vie doit être hors contrat puisque c'est la vie qui est le motif premier et fondamental du contrat.
Cette question de philosophie politique montre comment le problème de la vie commence à se problématiser dans le champ de la pensée politique.
- Dans les technologies de pouvoir : la discipline
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a vu apparaître des techniques de pouvoir centrées sur le corps individuel : distribution spatiale des corps individuels et organisation d'un champ de visibilité (leur séparation, leur alignement, leur surveillance). Ces techniques cherchaient à maximiser la force utile des corps. De plus, ces techniques cherchaient à maximiser leurs effets de la manière la moins coûteuse possible, par tout un système de surveillance, de hiérarchie, d'inspection, d'écriture de rapports. On peut appeler cela la technologie disciplinaire du travail.
Le bio-pouvoir
Or pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit apparaître une autre technologie de pouvoir qui n'exclut pas la technique disciplinaire, mais qui va l'utiliser en se couplant à elle.
Cette nouvelle technique de pouvoir ne s'adresse pas au corps de l'homme, mais à l'homme en tant qu'être vivant, c'est-à-dire à la population. La discipline régit la multiplicité des hommes en dressant les corps individuels, alors que la nouvelle technologie de pouvoir régie la multiplicité des hommes en tant qu'elle forme une masse globale affectée de processus d'ensemble (naissance, mort, production, maladie…).
On voit donc apparaître à la fin du XVIIIe siècle ce que Foucault appelle une "biopolitique" de l'espèce humaine. À partir des mesures statistiques des phénomènes tels que la naissance, la mortalité, la longévité, avec les premières analyses démographiques, on prévoit des schémas d'intervention.
L'exemple de la médecine
Par exemple, plutôt que se concentrer sur les épidémies, on va se concentrer sur les maladies qui règnent dans une population, et qui entraînent des facteurs permanents comme une baisse d'énergie et des coûts économiques. Donc la maladie non plus comme la mort qui s'abat brutalement sur la vie, mais la maladie comme phénomène de population, la maladie comme ce qui diminue et affaiblit la vie. La prise en compte de ces phénomènes a conduit à la mise en place d'une médecine qui va avoir comme fonction l'hygiène publique, entraînant des organismes de coordination des soins médicaux, de centralisation de l'information, de normalisation du savoir, mais aussi des campagnes d'apprentissage de l'hygiène et des campagnes de médicalisation de la population.
Le champ d'intervention de la biopolitique recouvre un large ensemble de phénomènes : le problème de la vieillesse, c'est-à-dire de l'individu qui tombe hors du champ d'activité, le problème des accidents, des infirmités. Concernant ces problèmes, la biopolitique va mettre en place des institutions d'assistance, d'épargne individuelle et collective.
Mais la biopolitique va aussi prendre en compte les relations entre les individus, ainsi que les individus dans leur milieu d'existence. C'est donc l'analyse des effets du milieu géographique, climatique, mais aussi le problème de la ville. C'est sur tout cela que la biopolitique va prélever son savoir et définir le champ d'intervention de son pouvoir.
Il y a dans tout cela plusieurs choses importantes :
- L'apparition d'un nouvel élément : la population
La théorie du droit ne connaissait que l'individu et la société : l'individu contractant et le corps social constitué par le contrat volontaire. Les disciplines ne connaissaient que le corps de l'individu. Mais la biopolitique a affaire à la population : la population comme problème scientifique et politique, c'est-à-dire comme problème biologique et comme problème de pouvoir. - La nature des phénomènes pris en considération : les phénomènes collectifs
Ces phénomènes ne deviennent pertinents qu'au niveau de la population. Ils sont aléatoires et imprévisibles individuellement, mais au niveau collectif ils ont des constantes faciles à établir. De plus, puisqu'ils se déroulent dans la durée, ce sont des phénomènes de série. La biopolitique s'intéresse donc à des phénomènes de série qui se produisent dans une population prise dans sa durée. - Mise en place de mécanismes de régulation
Prévisions, estimations statistiques, interventions au niveau de la détermination des phénomènes généraux (baisser la morbidité, allonger la vie, stimuler la natalité). Il s'agit d'établir des mécanismes régulateurs qui vont pouvoir maintenir une moyenne. Ce qui revient à installer des mécanismes de sécurité autour des éléments aléatoires inhérents à une population. Pour le dire autrement, il s'agit d'optimiser un état de vie. Il ne s'agit donc pas d'une discipline, mais d'une régularisation.
Donc, à côté du pouvoir absolu de la souveraineté, qui consiste à pouvoir faire mourir, apparaît avec cette technologie du biopouvoir, un pouvoir continu, savant, qui est le pouvoir de faire vivre.
Sur la mort
La manifestation de ce biopouvoir apparaît concrètement dans cette fameuse disqualification progressive de la mort. La grande ritualisation publique de la mort a disparu progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, la mort est devenue ce qu'on cache, elle est la chose la plus privée et la plus honteuse (ce n'est plus le sexe, mais la mort qui est aujourd'hui l'objet du tabou). Si la mort est devenue cette chose qu'on cache, ce n'est pas à cause d'un déplacement de l'angoisse ou d'une modification des mécanismes répressifs, mais c'est à cause d'une transformation des technologies de pouvoir.
- C'est la manifestation du passage d'un pouvoir à un autre qui donnait son éclat et sa ritualisation à la mort. La mort, c'était le moment où l'on passait du pouvoir du souverain d'ici-bas, au pouvoir du souverain de l'au-delà. On passait donc d'un pouvoir à un autre.
- La mort était une transmission du pouvoir du mourant à ceux qui survivaient. Mais maintenant que le pouvoir n'est plus le droit de faire mourir mais le droit d'intervenir pour faire vivre, la mort est la limite, le terme du pouvoir. Le pouvoir n'a pas de prise sur la mort, il a prise sur la mortalité. Le pouvoir n'a prise sur la mort que statistiquement. Il est donc normal que la mort retombe du côté du privé.
Dans le droit de souveraineté, la mort était le point où se montrait l'absolu pouvoir du souverain, au contraire, maintenant, la mort est le moment où l'individu échappe à tout pouvoir, retombe sur lui-même, sur sa part la plus privée. Au sens strict, le pouvoir laisse tomber la mort.
On a donc, depuis le XVIIIe siècle, deux technologies de pouvoir qui sont superposées :
- Une technique disciplinaire : elle est centrée sur le corps, elle produit des effets individualisants, elle manipule le corps pour le rendre à la fois utile et docile. C'est donc une technologie de dressage.
- Une technologie régularisatrice : elle est centrée sur la vie, elle cherche à contrôler les événements hasardeux propres à une population. C'est une technologie qui vise donc la sécurité de l'ensemble par rapport à ses dangers internes.
Pourquoi les mécanismes de pouvoir se sont transformés
Tout s'est passé comme si le pouvoir de la souveraineté s'était trouvé inopérant pour régir le corps économique et politique d'une société en voie d'explosion démographique et d'industrialisation.
Il a donc fallu transformer les mécanismes de pouvoir. D'abord par le bas, dans le détail, avec le pouvoir disciplinaire, ce qui était la transformation la plus facile à réaliser. C'est pour cela que cette transformation s'est réalisée en premier, au tout début du XVIIIe siècle. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une seconde transformation, cette fois sur les phénomènes de population. Cette accommodation était beaucoup plus difficile car elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation.
On a donc deux ensembles de mécanismes :
- L'organo-discipline de l'institution : corps, organisme, discipline, institutions.
- La bio-régulation par l'état : population, processus biologiques, mécanismes régularisateurs, État.
La norme (société de normalisation)
Ces deux mécanismes (disciplinaire et régularisateur) ne sont pas de même niveau, ce qui leur permet de ne pas s'exclure et de pouvoir s'articuler l'un sur l'autre. L'élément qui va circuler du disciplinaire au régularisateur, qui va s'appliquer de la même façon au corps et à la population, c'est la norme. La norme, c'est ce qui peut aussi bien s'appliquer à un corps que l'on veut discipliner, qu'à une population que l'on veut régulariser. La société de normalisation, c'est une société où se croisent la norme de la discipline et la norme de la régulation.
Nous sommes donc dans un biopouvoir qui a pris en charge la vie, aussi bien du côté du corps que du côté de la population.
Mais le biopouvoir est cerné de paradoxes. Exemple : Le pouvoir de la bombe atomique n'est pas simplement le pouvoir de tuer qu'a tout souverain, mais c'est le pouvoir de tuer la vie elle-même. Donc le pouvoir atomique est capable de se supprimer comme pouvoir d'assurer la vie.
Sur le racisme
Nous allons maintenant voir comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre dans cette technologie de pouvoir qui a pour objectif la vie. Comment exercer le pouvoir de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir ?
C'est là qu'intervient le racisme. Bien sûr, le racisme existait depuis longtemps, mais il fonctionnait ailleurs. C'est l'émergence du biopouvoir qui a fait du racisme le mécanisme fondamental du pouvoir.
Le racisme, c'est le moyen d'introduire, dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge, une coupure : la coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. La hiérarchie des races va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge. La première fonction du racisme est donc de fragmenter ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir.
La seconde fonction du racisme est d'établir une relation positive de type "plus tu laisseras mourir, et plus toi-même tu vivras". La relation guerrière disait que pour vivre il fallait massacrer ses ennemis. Mais le racisme fait jouer cette relation de type guerrière d'une manière nouvelle qui n'est plus de type militaire, mais de type biologique, et qui est compatible avec l'exercice du biopouvoir : "plus les espèces inférieures disparaîtront, plus moi, non pas en tant qu'individu mais en tant qu'espèce, je vivrai, je serai fort et je pourrai proliférer". Donc, la mort de l'autre n'est pas simplement ma vie, ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de la race inférieure, du dégénéré, de l'anormal, c'est ce qui va rendre la vie plus saine et plus pure.
Ce mécanisme fonctionne, car les ennemis ne sont pas des adversaires au sens politique, mais sont des dangers pour la population. Donc la mise à mort n'est recevable dans le système de biopouvoir que s'il tend, non pas à la victoire sur les adversaires politiques, mais à l'élimination du danger biologique et au renforcement de l'espèce elle-même. La race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation. Là où vous avez un biopouvoir, le racisme est indispensable comme condition pour pouvoir mettre les autres à mort. Dès lors que l'État fonctionne sur le mode du biopouvoir, la fonction meurtrière de l'État ne peut être assurée que par le racisme.
Donc, si le pouvoir de normalisation veut exercer le vieux droit souverain de tuer, il faut qu'il passe par le racisme. Et inversement, un pouvoir de souveraineté qui veut fonctionner avec la technologie de la normalisation, doit aussi passer par le racisme.
La mise à mort, ce n'est pas uniquement le meurtre direct, mais c'est aussi le meurtre indirect (le fait d'exposer à la mort, de multiplier le risque de mort, la mort politique, le rejet...).
À partir de là, on peut comprendre le lien qui s'est noué entre la théorie biologique du XIXe siècle et le discours du pouvoir. L'évolutionnisme au XIXe siècle n'est pas simplement une manière de cacher un discours politique sous un vêtement scientifique, mais c'est une manière de penser les rapports de colonisation, la nécessité des guerres, la criminalité, les phénomènes de la folie, l'histoire des sociétés avec leurs différentes classes. Chaque fois qu'il y a eu un affrontement, un risque de mort, c'est dans la forme de l'évolutionnisme qu'on a été contraint de les penser. Et le racisme va apparaître précisément là où le droit à la mort est requis :
- La colonisation : si l'on fonctionne sur le mode du biopouvoir, on ne pourra tuer des populations, des civilisations, que par un racisme construit sur les thèmes de l'évolutionnisme.
- La guerre : là aussi, le racisme va permettre de faire la guerre à ses adversaires, mais d'exposer aussi ses propres citoyens à la mort. La guerre ne sera plus simplement détruire l'adversaire politique, mais la race adverse, ce danger biologique. Mais plus encore, la guerre devient une manière de régénérer sa propre race : plus nombreux seront ceux qui meurent parmi nous, plus la race à laquelle nous appartenons sera pure (Le sacrifice sera ce qui purifie la race).
- Mais aussi la criminalité, la folie, les anomalies diverses.
Le racisme assure la fonction de mort dans le biopouvoir, selon le principe que la mort des autres, c'est le renforcement biologique de soi-même en tant que l'on est membre d'une race.
Ce n'est donc pas un racisme qui serait la haine des races entre elles. Ce n'est pas non plus un racisme de type idéologique mis en place par l'État pour détourner les hostilités vers un adversaire mythique. C'est donc beaucoup plus profond qu'une vieille tradition, beaucoup plus profond qu'une nouvelle idéologie, c'est autre chose. La spécificité du racisme moderne n'est pas liée à des mentalités, à des idéologies, au mensonge du pouvoir : la spécificité du racisme moderne est liée à la technologie du pouvoir. Le racisme est lié au fonctionnement d'un État qui est obligé de se servir de la race, de l'élimination des races et de la purification de la race, pour exercer son pouvoir souverain. Le vieux pouvoir souverain, pouvoir de faire mourir, ne peut continuer à fonctionner dans le biopouvoir qu'avec la mise en place du racisme.
Sur le régime nazi
On comprend alors pourquoi les États les plus meurtriers sont forcément les plus racistes. C'est le cas du nazisme qui est à la fois un État disciplinaire et un État de régulation biologique, donc une société régulatrice, disciplinaire, assurantielle, où règne pourtant le déchaînement du pouvoir meurtrier à travers tout le corps social.
Dans le régime nazi, la guerre est posée comme un objectif politique. La politique doit aboutir à la guerre, et la guerre doit être la phase finale qui va couronner l'ensemble. Donc, la destruction des autres races est l'une des face du projet, mais l'autre face est d'exposer sa propre race au danger absolu de la mort. Parmi les objectifs essentiels de la politique nazie, il y a cette idée que la population tout entière doit être exposée à la mort. Seule cette exposition à la mort pourra constituer la population comme race supérieure, et la régénérer définitivement face aux races qui auront été totalement exterminées ou asservies.
Dans la société nazie, il y a donc cette chose extraordinaire : c'est une société qui a généralisé le biopouvoir et qui a en même temps généralisé le droit souverain de tuer. Les deux mécanismes coïncident exactement. C'est un état absolument raciste, meurtrier et suicidaire.
Sur le socialisme
Seul le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du biopouvoir. Mais ce jeu est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les Etats modernes. Le socialisme est tout aussi marqué de racisme que l'État capitaliste. Le socialisme a été dès ses débuts au XIXe siècle un racisme. Non pas un racisme ethnique, mais un racisme de type évolutionniste, à propos des malades mentaux, des criminels, des adversaires politiques…
Chaque fois que le socialisme a insisté sur la transformation des conditions économiques pour passer de l'état capitaliste à l'état socialiste, il n'a pas eu besoin du racisme. En revanche, chaque fois que le socialisme a insisté sur le problème de la lutte contre l'ennemi, de l'élimination de l'adversaire à l'intérieur de la société capitaliste, le racisme a ressurgi, parce qu'il a été la seule manière pour une pensée socialiste de penser la raison de tuer l'adversaire. Quand il s'agit simplement d'éliminer économiquement l'adversaire, de lui faire perdre ses privilèges, on n’a pas besoin du racisme. Mais dès qu'il s'agit de penser qu'il va falloir se battre physiquement avec lui, risquer sa propre vie, il a fallu le racisme.
Par conséquent, chaque fois que vous avez des formes de socialisme qui accentuent le problème de la lutte, vous avez le racisme.
Avant l'affaire Dreyfus, tous les socialistes étaient fondamentalement racistes. Ils étaient racistes dans la mesure où ils ont admis comme allant de soi ces mécanismes de biopouvoir que le développement de la société et de l'État, depuis le XVIIIe siècle, avaient mis en place.
On ne peut faire fonctionner un biopouvoir et en même temps exercer les droits de la guerre qu'en passant par le racisme.
Video(s)
Photo(s)